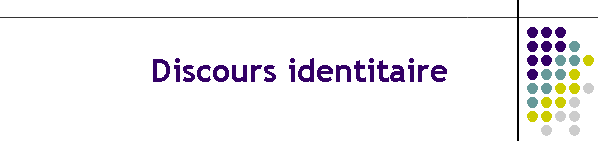
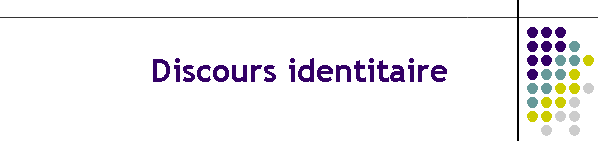 |
||
05/17/04 |
|
|
CHHIV Yiseang a le plaisir de vous présenter sur cette page sa Maîtrise intitulée "Discours identitaire".
|
Université de Paris III - Sorbonne-Nouvelle
UFR de Didactique de Français Langue Étrangère
Maîtrise de Français Langue étrangère
FS 4O4 Option de recherche
Le discours identitaire des étudiants d’origine cambodgienne de l’Institut national des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
Dossier de recherche présenté par M. CHHIV Yiseang
Sous la direction de M. Louis PORCHER
Année universitaire 1997 – 1998
Dès notre arrivée en France, nous avons été confronté au décalage manifeste de comportement entre les Cambodgiens de France et ceux du Cambodge. Nous avons observé une pratique langagière différente allant même jusqu'à l'incapacité pour certains de parler la langue maternelle. Nous avons été conforté dans ces constatations dès le début de notre travail comme enseignant de khmer à l’Institut national des Langues et Civilisations orientales (INALCO) pendant l’année universitaire 1997-1998 et par nos multiples rencontres avec des Cambodgiens de Paris.
À la suite de nos discussions avec ces Cambodgiens qui expriment leurs difficultés à éduquer leurs enfants, nous avons tout d'abord pensé étudier les problèmes d'identité des jeunes cambodgiens de la deuxième génération en choisissant comme champ de recherche la région parisienne. Mais, comme la diaspora cambodgienne parisienne est dispersée entre les banlieues telles que Lognes, Torcy … et les XIIIème et XIXème arrondissements de Paris, il nous a paru difficile de recueillir des informations dans ce secteur géographique étendu. De même, travailler sur les Cambodgiens de la deuxième génération nous aurait demandé un effort conséquent moins adapté à un simple dossier de recherche. Cependant, du fait de notre travail à l'INALCO au contact d'étudiants dont la moitié, soit 20, est d'origine cambodgienne, nous avons pensé limiter notre échantillon de recherche aux étudiants inscrits dans le cursus "langue et culture cambodgiennes".
Nous formulons donc le sujet suivant “ Le discours identitaire des étudiants d’origine cambodgienne de la section cambodgienne du département de l’Asie du Sud-Est de l’INALCO ”.
Ce dossier comprendra deux parties. La première sera consacrée à la définition de la position identitaire des étudiants.
La deuxième partie portera sur les motivations de l’apprentissage de la langue khmère.
Puisque notre travail insiste sur les discours, nous avons choisi comme outil de recherche l’entretien. Nous avons donc préparé un guide d'entretien semi-directif (cf. annexe) organisé autour de questions portant sur la conception identitaire des interviewés. Nous avons déterminé un temps de passation de 15 mn. Nous avons été conscient dans notre choix de l'incidence de notre position d'interviewer (Professeur) sur les réponses de nos étudiants.
Nos entretiens ont eu lieu avec quinze étudiants d’origine cambodgienne qui étaient inscrits dans les trois années du cursus. Notre travail est plus qualitatif que quantitatif étant donné que les quinze étudiants interrogés ne constituent pas un échantillon représentatif des jeunes cambodgiens de France.
Notre démarche s’apparente à une démarche ethnosociologique : nous ne partirons pas d’hypothèses destinées à être vérifiées par le travail de terrain mais nous tenterons de décrire l’objet social que nous avons délimité. Nous nous situerons dans la démarche des récits de vie pour lesquels Daniel Bertaux explique que
L’objet d’une enquête ethnosociologique est d’élaborer progressivement un corps d’hypothèses plausibles, un modèle fondé sur les observations, riche en descriptions de “ mécanismes sociaux ” et en propositions d’interprétation (plutôt que d’explication des phénomènes observés)
[1]L’entretien avait pour but d’amener les étudiants d’origine cambodgienne de l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à se définir sur le plan identitaire : se sentent-ils plutôt Français ou Cambodgien, et qu’est-ce que cela signifie pour eux de se définir ainsi ?
-
Un quart des étudiants se sentent plutôt Français et invoquent plusieurs raisons pour expliquer ce sentiment d’appartenance :· La langue dans laquelle ils s’expriment le plus souvent est le français.
· Une conception de l’individu et de la famille “ occidentalisée ” : ils se disent individualistes dans la mesure où ils sont attachés à leur liberté d’expression et à l’affirmation de leur personnalité au sein de leur famille. Ainsi, NR, étudiante 24 ans, nous l’a fait savoir :
Quand je veux faire quelque chose, je prends la liberté. Si jamais on ne me l’accorde pas, je la prends et je l’impose. Si je décide de faire quelque chose, j’avertis, j’écoute leur opinion mais c’est moi qui décide en dernier lieu.
Ils rejettent la conception cambodgienne de la famille qui repose selon eux sur l’inégalité des sexes, sur l’obéissance des jeunes envers leurs aînés, et l’obligation d’avoir de nombreux enfants. NR constate que
Les filles ont plus de devoirs que les garçons à la maison, [que] les enfants sont trop soumis aux parents.
Le même point de vue se retrouve chez KH, étudiante, 2O ans qui renonce à l’obligation d’obéir aux personnes âgées. Elle s’explique ainsi :
Je sais qu’au Cambodge, les jeunes doivent obéir aux personnes âgées mais moi, je respecte les personnes âgées quand elles me respectent. Si elles ne me respectent pas, je ne leur donne pas de respect non plus. Je pense que dans l’esprit cambodgien, quand c’est une vieille personne, on la respecte obligatoirement. Moi, je fais toujours un choix en fonction de la personne que j’ai en face de moi.
Ils sont opposés à l’idée de concevoir une grande famille parce que, pour NR, "une grande famille, c’est une tradition khmère qui existe au Cambodge". Ceci n’est pas le cas en France où l’on pense qu’une grande famille représente une tâche ou une charge lourde à assurer surtout pour la mère de famille suivant son niveau de vie. L’éducation des enfants empêche de réaliser les projets personnels, de mener une carrière professionnelle réussie.
Je veux concevoir une petite famille parce que je pense que pour avoir une grande famille, il faut avoir une certaine force de caractère dans la mesure où dans la famille khmère, c’est la mère qui est le pilier de la famille, c’est elle qui dirige tout. Je ne pense pas que je pourrais être à la hauteur de ce qu’a fait ma mère. NR, étudiante 24 ans.
Parmi ceux qui se sentent plutôt Français, deux ont invoqué le décalage de génération (entre la leur et celle de leurs parents et de leurs grands-parents) et la difficulté qui en découle. Il y a un décalage dans le fait qu’ils sentent que leurs parents et grands-parents appartiennent à une génération où la tradition
[2] jouait un rôle primordial dans tous les domaines, où les jeunes devaient obligatoirement se soumettre à la pensée de leurs aînés. Entre leur génération et celle de leurs parents ou de leurs grands-parents, il existe beaucoup de malentendus, d’incompréhension et même un manque de rapports. Ils ont précisé par ailleurs que ces deux générations sont complètement opposées. Il est évident que la solidarité avec leurs grands-parents n’existe presque pas.On retrouve cette pensée dans la bouche de KH qui explique :
Ma mère est Cambodgienne et moi, je suis plutôt Française ; il y a des choses que je voulais faire et elle ne comprenait pas pourquoi je voulais les faire.
NR, de son côté, ajoute que :
Avec ma grand-mère, j’ai une solidarité uniquement par devoir. Nous sommes complètement opposées, il n’y a rien à faire, il n’y a pas de compréhension qui passe entre nous deux.
· Leurs habitudes alimentaires les rapprochent des Français : ceux qui se disent plutôt Français mangent tout le temps français sauf pendant les grandes fêtes privées ou religieuses où ils se retrouvent entre Cambodgiens. · Sur le plan social, parmi ceux qui se sentent plutôt Français, certains n’ont que des amis français ; d’autres ont très peu d’amis cambodgiens parce que dans leur école, les Cambodgiens sont très rares. Ils préféreraient donc vivre plutôt en couple mixte, c’est-à-dire avec un conjoint français. Ils pensent également qu’il pourrait y avoir des problèmes de communication s’ils vivaient avec un conjoint cambodgien de France ou du Cambodge. Ils croient en effet que les Cambodgiens de France et du Cambodge sont majoritairement conservateurs de la tradition khmère, qu’ils n’ont pas la même ouverture d’esprit que les Français ou qu’eux-mêmes. Cette croyance est exprimée par CC, étudiante 22 ans :Je sais qu’il y aurait des problèmes de communication parce que je vois comment réagissent les hommes cambodgiens [mon cousin, mon oncle].
NR partage aussi cette idée :
Mon beau-frère [cambodgien], lui, il est très conservateur, il a du mal à accepter le fait que dans notre famille, chacun parle et donne son opinion à table même si on est cadet. On ne s’affirme pas, on donne son opinion. Un Cambodgien, non, je préfère un couple mixte.
Certains d’entre eux critiquent en outre le mariage cambodgien parce qu’ils jugent qu’il existe encore des mariages “ arrangés ” et que les cérémonies de mariage cambodgiennes sont “ trop longues et trop compliquées ”. D’autres rejettent le code de mœurs khmères qui impose les fiançailles, le mariage et après seulement la vie maritale.
De même, ils disent qu’ils préfèrent vivre en union libre. CC, étudiante 22 ans, explique cette préférence :
Je veux vivre en union libre parce qu’en fait, je n’ai pas une bonne image du mariage. Pour moi, le mariage, c’est un engagement qui emprisonne les gens, je n’ai pas l’impression que c’est quelque chose d’enrichissant et parfois, ça casse quelque chose dans la relation et puis je n’ai pas eu une vie sentimentale très stable jusqu’à présent donc c’est un peu difficile d’envisager quelque chose de durable. Je ne crois pas trop à une durée de relation.
Toutes les explications que ces étudiants avancent pour se dire Français nous permettent de percevoir leur représentation de la France et des Français : celle-ci se construit en opposition constante par rapport au comportement cambodgien qu’ils se représentent à partir de leur vie au sein d’une famille en exil et de la vie au Cambodge qu’ils imaginent sans l’avoir vraiment vécue.
Rappelons en effet qu’ils sont en général arrivés très jeunes en France à partir de 1970 ou qu’ils sont nés en France et y ont grandi. Deux des personnes interviewées qui se disent plutôt Françaises ne connaissent pas le Cambodge.
Notons également que ces étudiants ont soit une mère française et un père cambodgien, soit les deux parents cambodgiens qui ont fait des études supérieures et qui sont décrits comme étant “ très ouverts ”.
-
La moitié des étudiants se sentent plutôt Cambodgiens en raison de l’analyse qu’ils font de leurs comportements :· Sur le plan de la famille, ils insistent sur le respect qu’ils montrent envers leurs parents et qui est pour eux une “ valeur ” spécifiquement cambodgienne. Ils disent entretenir une relation de confiance avec eux. Ils précisent également qu’ils ont reçu une éducation cambodgienne très “ classique ” et que leurs parents insistent beaucoup sur le fait que leurs propres enfants reçoivent une culture qui véhicule les valeurs traditionnelles de la famille cambodgienne.
MSP, étudiant 24 ans, l’explique ainsi :
Vue la culture cambodgienne, dès notre naissance, nos parents font en sorte que la famille soit un cocon bien fermé pour que le fils ou la fille n’aille pas n’importe où. Ils nous apprennent à bien rester ensemble, et ils nous apprennent que la famille est une “ valeur sûre ”.
Cette idée trouve un écho dans le propos de PPM, étudiante 24 ans qui insiste également sur le fait que ses parents “ ne laissent pas leur fille s’éloigner d’eux ”.
Les étudiants qui se sentent plutôt Cambodgiens souhaitent se marier de préférence avec un conjoint cambodgien de France et fonder une famille nombreuse, ce qui signifie pour eux avoir quatre ou cinq enfants. Car d’après TST, étudiante 24 ans, une grande famille engendre des liens de solidarité, de complicité plus nombreux entre les frères et sœurs : il y a beaucoup plus d’ouverture d’esprit, d’échanges d’avis, d’idées, de discussions familiales sur des sujets d’ordre général.
Le mariage est une institution très importante au Cambodge. En effet, traditionnellement, les Cambodgiens qui vivent en union libre sont d’une part mal considérés par leurs familles et leur entourage et se sentent, par conséquent, mis au ban de la société. D’autre part, les enfants nés hors mariage sont considérés comme illégitimes.
C’est pour cette raison que MSP dit que, pour lui, le mariage représente la coutume, la tradition et un engagement qui serait l’équivalent d’une bourse scolaire avec une obligation de réussite ultérieure. C’est une conception du mariage identique qu’expose TST qui pense que le mariage est quelque chose de sacré, un lien plus fort que l’union libre. Par contre, PLS pense plutôt que le mariage, c’est “ donner une preuve d’amour à son conjoint ”.
Par ailleurs, trois d’entre eux se sentent cambodgiens par le fait qu’ils sont solidaires de leurs grands-parents cambodgiens qui habitent avec ceux. La solidarité avec leurs grands-parents passe par de bonnes relations, des échanges sur la culture ancestrale et la culture contemporaine. La solidarité passe également par les conseils que les grands-parents donnent en retour à leurs petits-enfants. Ils estiment que cette notion de solidarité est plutôt rare dans les familles françaises du fait de la séparation des générations.
Pour MSP, être Cambodgien s’incarne dans le fait qu’il ne se sent pas indépendant dans sa famille et dans sa vie privée :
Je ne pense pas que dans la famille cambodgienne, on puisse être indépendant. Ma mère est plutôt une “ mère poule ”, elle aime bien avoir ses enfants à côté ; même, à 24 ans, je suis obligé de dire “ bon, je vais par là et je reviens à telle heure ” parce qu’elle tient vraiment à nous. Je pense que même si j’étais marié, je serais encore à côté de ma mère.
· Sur le plan social, ils expliquent que c’est par le regard de leurs amis français qu’ils se sentent Cambodgiens ; les Français les renvoient à leur différence physique, comportementale et parfois vestimentaire.· Ils font aussi le lien entre identité et nationalité : deux étudiants n’ont pas demandé la nationalité française parce que pour eux, ce serait une trahison envers leurs origines. Changer de nationalité, c’est changer d’identité. Ils sont cambodgiens “ de cœur ” et vivent leur citoyenneté française comme un peu frustrante. Chez un interviewé, il y a une frustration dans le fait que dans l’apparence et au fond de lui, il est cambodgien, et pourtant, sur le papier, il est “ citoyen français ”.
Pour ceux qui ont dorénavant la nationalité française, cela ne représente qu’un bout de papier très pratique qui permet de faciliter les démarches au niveau administratif : c’est être en règle, par exemple, pour trouver du travail, bénéficier d’avantages sociaux (la sécurité sociale, les retraites …).
· Leurs habitudes alimentaires contribuent à ce qu’ils se sentent plutôt Cambodgiens parce que chez eux, la plupart du temps, ils mangent des plats typiquement cambodgiens. En effet, certains parents n’aiment pas les plats français. Même pendant les fêtes religieuses chrétiennes, par exemple Noël, il y a toujours des plats cambodgiens. Ceci résulte surtout du fait qu’ils n’ont pas appris à cuisiner français.
Nous constatons que les étudiants qui se sentent cambodgiens ont, tous, deux parents khmers. Les sources de leurs connaissances sur le Cambodge sont diverses : la majorité entre eux ont des représentations du Cambodge par transmission familiale, par les livres, par leurs propres amis français et cambodgiens qui ont voyagé au Cambodge et par les médias. Ils soulignent qu’ils prennent du recul par rapport à tout ce que diffusent les médias parce qu’ils pensent que ce sont de mauvaises images. Ils précisent, en outre, que chaque fois que les médias parlent du Cambodge, c’est pour citer des événements qu’ils qualifient d’anormaux, à savoir une prise d’otage d’étrangers, la prostitution, … D’autre part, deux parmi les étudiants qui se disent plutôt Cambodgiens ont déjà effectué des voyages au Cambodge : ils ont affirmé que leur voyage leur permet de mieux connaître leurs racines (pouvoir connaître les grands-parents, les oncles et tantes et même leur village natal), et de mieux connaître la culture quotidienne cambodgienne. Par ailleurs, ils fréquentent également toutes les manifestations culturelles telles que expositions – exposition sur l’art khmer au Grand Palais l’année dernière – films khmers projetés dans des cinémas …
-
Un quart d’étudiants se disent moitié Cambodgien, moitié Français. Ils n’opposent pas mais associent les deux aspects cambodgien et français, c’est-à-dire qu’ils vivent, ont grandi et ont été éduqués “ à la française ” en France et en même temps, ils recherchent leurs racines. Ils se sentent de culture française avec une origine cambodgienne, vivent comme des Français et essayent en même temps de se comporter comme des Cambodgiens. Ils adoptent tout ce qu’ils trouvent bon dans la culture française et gardent les valeurs cambodgiennes que leurs parents leur ont inculquées et qu’ils trouvent bonnes.Il s’agit à présent de voir comment ils vivent ces diverses appartenances dans un contexte où le discours politique dominant tend à figer la notion d’identité collective en un bloc monolithique et à présenter les phénomènes d’acculturation sous un jour menaçant
[3].Ce concept a beaucoup évolué depuis son apparition aux États-Unis dans les années 50 : il s’agissait alors pour les chercheurs de trouver un outil adéquat permettant de penser les problèmes d’intégration des immigrants. On estimait alors que la conduite des individus était largement déterminée par une identité culturelle assimilée à un patrimoine culturel hérité, plus ou moins immuable et fondateur de la nation ou du groupe. Cette conception largement figée de l’identité a pu servir des revendications identitaires mais s’est aussi accompagnée d’une tendance au repli sur soi des groupes concernés.
Aujourd’hui prévaut une conception plus dynamique de l’identité culturelle : Sélim Abou rappelle que l’identité culturelle ne se réfère pas à un dépôt culturel mais à une culture vivante
[4].Denys Cuche souligne aussi qu’il n’y a d’identité que relationnelle : l’identité se construit en permanence dans notre relation aux autres, la rencontre avec l’Autre nous permettant de nous définir
[5].La réflexion sur l’identité culturelle du groupe ne doit pas masquer la composante sociale de l’identité et donc son caractère mouvant et pluriel :
Dans la mesure où l’identité résulte d’une construction sociale, elle participe de la complexité du social. Le fait de vouloir réduire chaque identité culturelle à une définition simple, c’est ne pas tenir compte de l’hétérogénéité de tout groupe social. Or, aucun groupe, aucun individu n’est enfermé à priori dans une identité “ unidimensionnelle ”. Ce qui est plutôt caractéristique de l’identité, c’est son caractère fluctuant qui se prête à diverses interprétations ou manipulations. C’est précisément ce qui fait la difficulté de définir l’identité
[6]Chez la plupart des étudiants, on note une évolution de leur perception identitaire depuis leur enfance : la plupart ont affirmé que dans leur enfance ils se sentaient écartelés ou déchirés par une double identité parce qu’ils ne savaient pas exactement comment concilier ces deux éducations ou ces deux points de vue. NR, étudiante 24 ans, l’explique ainsi :
Comme j’ai une double identité, au début je me suis sentie écartelée ; c’est durant mon enfance que je me suis sentie écartelée entre les deux parce qu’à l’école, il fallait que je sois française, que j’efface tout ce qui est khmer parce que le Cambodge, tout le monde ne connaît pas ; tout ce que les Français connaissent, c’est le Japon et la Chine
Le malaise identitaire des jeunes atteint parfois un tel niveau qu’ils changent leur prénom. C’est le cas d’une étudiante qui disait que quand elle était à l’école, elle ne supportait pas que les gens ne prononcent pas correctement son prénom. Elle a décidé d’en changer lors de sa demande de nationalité.
On peut se demander si ce malaise ne résulte pas des analyses qui tentent de considérer l’identité comme monolithique et qui disqualifient de ce fait la prétendue “ double identité ” des jeunes issus de l’immigration.
Cette conception négative de la “ double identité ” permet de disqualifier socialement certains groupes, notamment les populations issues de l’immigration par exemple les Cambodgiens de France.
Inversement, certains qui voudraient réhabiliter ces groupes, élaborent tout un discours faisant l’apologie de la “ double identité ” comme représentant un enrichissement identitaire
[7]. Cette idée se retrouve dans l’esprit de la majorité des étudiants adultes :Je me sens enrichie par cette double appartenance. Enrichie parce que le fait que j’ai deux points de vue, français et cambodgien, ça me permet de juger et critiquer avant d’agir. ?a me permet de faire des comparaisons donc c’est un peu plus facile de faire des sélections. TST, étudiante 24 ans.
PLS, étudiant 22 ans, l’explique ainsi :
D’une certaine manière, je me sentais enrichi parce que j’ai une vision un peu plus large sur une seule chose. Mais dans ma tête, je prends donnant-donnant, la culture française et cambodgienne.
Denys Cuche explique que
Comme chacun le fait à partir de ses diverses appartenances sociales (de sexe, d’âge, de classe sociale, de groupe culturel …), l’individu qui participe de plusieurs cultures fabrique, à partir de ces différents matériaux, son identité personnelle unique en opérant une synthèse originale. Le résultat est donc une identité syncrétique, et non double, si l’on entend par l’addition de deux identités en une seule personne. L’identité syncrétique est une identité intégrant plusieurs “ références identificatoires ” sans qu’il y ait un conflit intérieur
[8].Nous avons constaté que les étudiants interviewés se sentant moitié Cambodgien et moitié Français vivent leur identité comme une identité syncrétique. KH, étudiante 20 ans le dit ainsi :
Déjà, on vit en France, on est obligé de changer un peu, partiellement. Pour s’adapter aux autres, il faut devenir un peu comme eux sans vraiment être tout à fait comme eux, les copier (la façon de vivre) et en plus ma mère m’a inculqué des valeurs cambodgiennes que je trouve bonnes et donc que je garde.
La manière dont les étudiants définissent positivement ou négativement leur identité est largement le reflet des courants idéologiques qui traversent la société française ; on peut aussi se demander si lorsque la double appartenance ne pose pas de problème, cela n’est pas lié au niveau d’études supérieur qui prouve une intégration sociale satisfaisante.
Les propos de NR confirment cela :
Et après, quand je suis en fac, j’ai commencé à faire connaître mon côté cambodgien à des gens qui s’y intéressaient. Et c’est vraiment à l’INALCO que j’ai découvert les gens qui s’intéressaient au Cambodge et qui connaissaient le Cambodge et c’est là que je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Soit j’efface tout et je garde un côté, soit je garde les deux. Donc, j’ai gardé ce qui est bon des deux côtés. En effet, J’en suis fière.
L’acculturation est
“ l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu et direct entre des groupes d’individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes ”[9].L’assimilation serait
“ la phase ultime de l’acculturation, phase rarement atteinte. Elle implique pour un groupe la disparition totale de sa culture d’origine et l’intériorisation complète de la culture du groupe dominant ”[10].Nous avons constaté que plusieurs étudiants interviewés avaient tenté de s’assimiler quand ils étaient jeunes parce que c’était pour eux la condition indispensable d’une réussite scolaire et professionnelle. C’était aussi le souhait des parents d’oublier les traumatismes vécus au Cambodge et de tenter une nouvelle naissance symbolique. Rappelons en effet que la plupart des Cambodgiens vivant en France ont fui leur pays pendant le régime des Khmers Rouges ou sous le régime communiste provietnamien mis en place en 1979. Ils ont transité par le Viêt-nam ou par les camps de réfugiés en Thaïlande. Parmi les quinze étudiants interviewés, la majorité est arrivée en France entre 1975 et 1983 alors qu’ils étaient enfants.
Ainsi CSS, étudiante 25 ans, explique :
Quand j’étais petite, ma mère nous avait tenus à l’écart de la culture cambodgienne parce qu’elle avait peur que nous ayons envie de retourner au Cambodge. Pour elle, le Cambodge est dangereux. Elle a perdu son mari et elle a peur de perdre ses enfants.
Aujourd’hui, ces étudiants constatent que l’assimilation est impossible ou non souhaitable. Ils s’inscrivent à l’INALCO pour retrouver leurs “ racines ” et s’approprier la culture cambodgienne.
CSS explique ce processus :
Avant je ne connaissais rien sur le Cambodge, j’étais complètement Française. Mais, depuis deux ans, je me suis dit, mon père est Cambodgien, bien que je ne le connaisse pas et que ma mère nous ait tenus à l’écart de la culture cambodgienne, je suis d’origine cambodgienne. Depuis deux ans que je cherche, j’ai lu beaucoup de choses sur le Cambodge. J’ai fait beaucoup de recherche. Plus je cherche, plus je me sens cambodgienne, vraiment je recherche mes racines.
Les étudiants semblent donc se situer dans un processus d’acculturation dans lequel ils disent accepter d’abandonner une partie des traditions cambodgiennes pour s’intégrer mais vouloir garder les “ valeurs cambodgiennes ”.
Il s’agit de voir comment par-delà les discours, l’identification à la communauté cambodgienne ou française s’opère à travers des engagements collectifs.
-
La demande de la nationalité française peut être considérée comme une manifestation du sentiment d’appartenance à la communauté française.Parmi les étudiants qui ont la nationalité française, certains pensent que la nationalité n’est qu’un bout de papier mais d’autres disent le contraire, par exemple, pour SV, étudiante 25 ans, la nationalité, c’est appartenir à une nation, à une culture, à un pays, à un mode de vie : “ il faut savoir dans sa tête à quel système on appartient, quelle identité on a ”.
-
Parmi les étudiants qui ont une activité associative, la plupart sont membres d’une association qui a un rapport avec le Cambodge : Accueil Cambodgien, Groupe Artistique des Jeunes Khmers (GAJK), Association des Femmes cambodgiennes, Radio cambodgienne de Marne-la-Vallée.Les raisons semblent moins tenir à un réflexe communautaire qu’à une volonté d’aider les Cambodgiens à s’intégrer à la société française. Ainsi, PLS explique que
Accueil Cambodgien est une “ association impeccable ” qui aide des Cambodgiens à venir en France pour les vacances ; elle organise des centres de vacances, elle aide des familles cambodgiennes en difficulté, elle prévoit des soutiens scolaires, elle accueille les gens de passage, les Cambodgiens en difficulté.
Deux autres étudiants sont membres d’associations ouvertes sur l’étranger : une association internationale des étudiants de sciences économiques et de commerce de Nancy et un club français de danse brésilienne (la Capura) ; CSS qui fait partie de ce club explique que c’est pour elle une ouverture sur une autre culture qui est la culture brésilienne et que cela la met en contact avec la mémoire des esclaves noirs emmenés au Brésil.
On peut peut-être voir là le besoin de rapprochement avec d’autres peuples de l’exil sans tomber dans le réflexe de repli identitaire sur sa propre communauté d’origine.
-
La pratique religieuse montre un attachement majoritaire à la religion bouddhique : parmi les sept étudiants qui se disent bouddhistes, trois sont pratiquants réguliers à la pagode et pratiquent le culte également chez eux. Pour les pratiquants festifs (fête des morts, anniversaire du Bouddha …), la pression familiale est la principale explication qu’ils apportent à leur démarche (faire plaisir à leur parents), mais ils reconnaissent aussi que, s’ils ne comprennent pas les rites, ils prennent néanmoins du plaisir à participer aux cérémonies où ils retrouvent les Cambodgiens.Les étudiants qui se définissent comme agnostiques disent participer quand même à la fête du Nouvel An khmer qui associe à la cérémonie proprement religieuse des jeux folkloriques et populaires.
Une seule étudiante s’est déclarée protestante.
Les entretiens n’ont pas été assez approfondis pour permettre de déceler le lien entre pratique religieuse individuelle et sentiment d’appartenance à une communauté française ou cambodgienne.
-
Leur participation à la vie politique révèle quelques tendances :La plupart des étudiants s’intéressent à la vie politique française ; parmi les interviewés qui ont la nationalité française, neuf disent qu’ils votent régulièrement parce qu’ils pensent que c’est leur droit civique ou de citoyen, que cela fait partie des devoirs et que leur vie est ici [en France], leurs références culturelles sont ici, et voter c’est choisir ceux qui gouvernent le pays “ auquel ils appartiennent ”. Ils jugent qu’il est important que chacun donne son avis qui permettrait de faire changer des choses. Ils estiment que le fait de voter, c’est les impliquer dans la société, c’est un moyen de manifester ses choix.
Ceux qui au contraire ne votent pas sont des étudiants qui soit n’ont pas le droit de voter car ils n’ont pas la nationalité française, soit ne s’intéressent pas à la politique française. D’autres enfin, ont une vision négative du vote parce qu’ils pensent que voter, c’est défendre les intérêts de chacun et que c’est une sorte d’égoïsme. MSP, étudiant 23 ans, illustre cette idée :
Si j’étais riche, je voterais plutôt pour la droite parce que les riches, ils paient moins d’impôts. Si j’étais pauvre, je voterais pour les socialistes parce que là, ils partagent de l’argent. Si j’étais raciste, je voterais pour le Front National.
En ce qui concerne la politique cambodgienne, la plupart des étudiants interviewés ne s’y intéressent pas parce qu’ils disent que c’est trop compliqué et qu’ils ne cherchent pas à comprendre.
En revanche, quatre entre d’eux s’intéressent à la politique cambodgienne parce qu’ils ont un projet soit d’aller vivre, soit d’aller travailler au Cambodge. Ils précisent également qu’ils ont beaucoup de difficultés à la suivre car d’une part, il manque cruellement de livres ou de documents qui traitent de la politique cambodgienne. D’autre part, en France, il existe peu de moyen pour pouvoir la suivre de façon assidue.
Pendant les élections législatives de 1993, aucun entre eux n’a voté.
En revanche, nous avons constaté que la politique cambodgienne intéresse la plupart des parents des étudiants interviewés. Ils écoutent la radio RFI diffusée en khmer, certains ont voté pendant les élections de 1993 et d’autres non mais ils participent à des manifestations, des conférences organisées en France sur ces élections.
Il semble donc que par leur choix d’engagement collectif, les étudiants interviewés s’identifient largement à la communauté française.
Nous avons demandé aux étudiants d’expliquer les raisons pour lesquelles ils apprennent le khmer. Leurs réponses ont fait apparaître différentes motivations.
Nous entendons par motivation utilitaire une nécessité scolaire ou universitaire : le khmer est une des langues présentées au baccalauréat, ou une langue intégrée dans un cursus universitaire. Ce peut être aussi une nécessité professionnelle : le projet de retourner travailler au Cambodge ou travailler en France avec des sociétés ayant des contacts avec le Cambodge.
Parmi les étudiants interviewés, l’une dit qu’elle s’inscrit à l’INALCO parce qu’elle étudie dans une école spécialisée dans la mode. Le khmer est pour elle un cursus secondaire mais compte quand même comme deuxième langue dans le cursus de l’école de mode. Deux étudiants ont répondu que le fait de s’inscrire à l’INALCO a pour but d’avoir un diplôme ; pour eux, le khmer est un cursus principal. PPM dit que :
Le diplôme de l’INALCO est important puisqu’il représente un certain prestige ; sortir diplômé des Langues Orientales, ce n’est pas n’importe quoi ; à l’INALCO, on rencontre des gens qui ne sont pas n’importe qui, ce qui n’est pas le cas dans les petites écoles de cambodgien ”.
Sept d’entre eux apprennent le khmer parce qu’ils souhaitent et espèrent fortement aller travailler au Cambodge dans les différents secteurs suivant leurs spécialités dans les années à venir. CSS, étudiante 25 ans, ingénieur en agronomie, explique :
J’apprends le khmer parce que je voudrais travailler au Cambodge ou pour le Cambodge et je pense que c’est plus facile de connaître la langue plutôt que de passer par un interprète. Quand on passe par un interprète, il y a des informations et des questions qui sont un peu moins guidées. Je pense faire du développement rural car je veux avoir plus de contacts avec les paysans et agriculteurs.
MSP, étudiant 23 ans, qui a fait des études d’arts plastiques, ajoute, pour sa part :
J’aimerais bien aller travailler au Cambodge, comme j’ai fait des études d’arts plastiques, je pourrais emmener tout ce qui est l’art français au Cambodge parce qu’au Cambodge, au niveau de l’art, ils sont un peu figés par rapport au début de la guerre. Donc pour mieux expliquer tout ça, savoir parler la langue est indispensable.
DLSB, étudiante 25 ans, diplômée d’une école du Commerce, ajoute :
Je crois que le fait d’apprendre le khmer, ça peut me servir si un jour, je vais travailler au Cambodge, faire du commerce entre le Cambodge et d’autres pays de la région.
En ce qui concerne l’idée d’apprendre le khmer pour trouver du travail dans des sociétés en France qui ont des rapports avec le Cambodge, nous remarquons que cette idée n’est peut-être pas fondée car d’une part, il existe très peu de commerce entre la France et le Cambodge et d’autre part, la langue khmère n’est pas une langue qu’on utilise dans le commerce.
Elle correspond au fait que la langue étudiée est la langue maternelle, ou la langue actuelle de la famille installée en France
Concernant cette motivation, les étudiants interviewés donnent des explications assez diversifiées. D’une part, certains disent qu’ils s’inscrivent aux cours de khmer à l’INALCO parce qu’ils trouvent que quand leurs parents parlent khmer et qu’eux répondent en français, cela gène la communication.
Ils voient une contradiction dans le fait d’avoir une apparence physique khmère et de ne pas parler le khmer. KH, étudiante 20 ans, l’explique ainsi :
[…] je sais que quand on [ma mère et moi] discutait, ma mère me disait qu’elle ne comprenait pas ce que je venais de dire ”.
CC, étudiante 22 ans, ajoute, de son côté :
Chaque fois que j’entends parler khmer à la maison, je regrette de ne pas comprendre parce que j’ai l’impression que ça fait partie de moi, il me manque une clé, c’est à moi d’avoir la clé pour pouvoir communiquer plus avec eux et surtout avec ma grand-mère. […] c’est pourquoi j’apprends le khmer.
Les étudiants précisent que la condition d’une double appartenance est la connaissance du khmer en plus de celle du français.
Le voyage au Cambodge est aussi un des critères qui motive l’apprentissage du khmer. C’est le cas de CSS et CC :
J’apprends le khmer, parce que quand je suis allée au Cambodge, mes tantes ne parlaient pas français et on ne pouvait pas communiquer ; curieusement, c’est le mari de ma cousine qui parlait français, donc il faisait la traduction mais ça me gênait parce que j’avais envie de parler directement à ma tante et c’est pour ça que je me suis mise à apprendre le khmer. CSS
En fait, je me suis décidé à apprendre le khmer surtout parce que je suis allée au Cambodge il y a trois ans et je ne connaissais pas du tout la langue ; j’étais frustrée de dire que mon père était Cambodgien et que personne ne comprenait pourquoi je ne parlais pas le khmer. CC
Quant aux étudiants qui savent déjà parler un peu khmer car chez eux, leurs parents les obligent à parler, en général ils ne l’écrivent pas, ni ne le lisent. Ils s’inscrivent à l’INALCO pour combler cette lacune et ne pas se sentir gênés, lorsque leurs amis français leur demandent s’ils maîtrisent bien le khmer.
C’est le cas de KH et TST :
J’apprends le khmer parce que je parle un peu, et je trouve que c’est dommage de parler sans écrire, ni lire. KH
J’apprends le khmer pour savoir lire et écrire et pour aussi ne pas me sentir gênée par rapport aux Français lorsqu’ils me demandent si je sais lire, si je comprends la langue écrite. TST
Si la langue est conçue comme représentation du monde, apprendre une langue, c’est avoir accès à la culture du pays concerné.
La majorité des étudiants interviewés disent qu’ils apprennent le khmer à l’INALCO parce qu’en plus des cours de langue, il y a des cours de civilisation et d’histoire du Cambodge, ce qui leur permet de mieux connaître le Cambodge et sa culture dans ses dimensions littéraire, religieuse, historique …
TST, étudiante 24 ans, explique que son grand-père lui a donné des romans khmers qu’elle regrettait de ne pas pouvoir lire.
Neuf étudiants disent s’intéresser à l’histoire du Cambodge dont quatre à l’époque angkorienne qu’ils considèrent comme l’apogée de l’histoire de ce pays. Cinq veulent mieux connaître l’époque contemporaine pour comprendre les difficultés actuelles du Cambodge. L’un entre eux précise qu’il veut mieux connaître le Cambodge dans lequel ont grandi ses parents et les raisons de leur exil en France. On voit par là que des motivations culturelles peuvent rejoindre des motivations affectives. Des raisons linguistiques sont aussi évoquées par deux étudiantes. CC explique que
La langue khmère est une langue qui n’a pas du tout les mêmes racines que les langues européennes ; on a l’impression que les mots sont formés sur des métaphores, c’est vraiment très beau !
Nous voudrions, au terme de cette étude, mettre l'accent sur les deux points qui nous paraissent caractériser la perception de l’identité des jeunes d’origine cambodgienne : l’articulation entre la culture d’origine et la culture française et le rapport entre langue et culture.
D’une part, nous constatons que les étudiants ont évolué depuis leur enfance dans leur perception de leur identité : ils avaient tendance à se sentir écartelés entre deux cultures dans leur enfance et à se sentir enrichis aujourd’hui par cette double appartenance. Ils sont passés d’une volonté d’assimilation jugée aujourd’hui irréaliste à un processus d’acculturation dans lequel ils veulent choisir des valeurs et des comportements à la fois cambodgiens et français ;
D’autre part, il semble que les étudiants cherchent leurs racines à travers l’apprentissage de la langue : cet apprentissage leur permet de découvrir leur culture d’origine qu’ils ne connaissent souvent jusque-là qu’indirectement par la transmission familiale ou les médias.
Il serait intéressant de prolonger ce travail par une analyse des appartenances régionales et ethniques afin de repérer les éventuelles différences de comportement. En effet, les apparences ethniques sont considérées comme suffisamment importances au Cambodge pour figurer sur les cartes d’identité.
Ouvrages
|
ABOU, S., L’identité culturelle, Anthropos, Paris, 1981 |
|
ALBARELLO, L. et al., Pratiques et méthodes de recherches en sciences sociales, Cursus, Armand Colin, Paris, 1995 |
|
BERTAUX, D., Les récits de vie, 128 Sociologie, Nathan Université, Paris, 1997 |
|
BERTRAND, D., Projet d’exil et acquisition de la langue étrangère. La crise identitaire des réfugiés du sud-est asiatique en camp de transit, Doctorat, Toulouse 2, 1992 |
|
CABANEL, C., Les mécanismes de réappropriation de la mémoire collective : l’exemple du Cambodge, DEA de didactologie des langues et des cultures, Paris III, 1997 |
|
CALVIER, J., L’immigration cambodgienne au Val-Maubuée : un regroupement communautaire ?, Mémoire de Maîtrise de Géographie, Paris I, 1997 |
|
COSTA-LASCOUX, J., Paris–XIIIè, lumières d’Asie, Série Français d’ailleurs, peuple d’ici, Autrement, Paris, 1995 |
|
CUCHE, D., La notion de culture dans les sciences sociales, La Découverte, Paris, 1996 |
|
GROSSER, A., Les identités difficiles, Presses de Sciences Po, Paris, 1996 |
|
LADMIRAL, J.-R. et LIPIANSKY, E.-M., La communication interculturelle, A. Colin, Paris, 1989 |
|
LÉVI-STRAUSS, C. (dir.), L’identité, Grasset, Paris, 1977 |
|
NEPOTE, J., Parenté et organisation sociale dans le Cambodge moderne et contemporain, Ed. Olizane, Genève, 1992 |
|
PORCHER, L. (dir.), La civilisation, Didactique des langues étrangères, CLE International, Paris, 1986 |
|
SAEZ, J.-P. (dir.), Identités, cultures et territoires, Desclée de Brouwer, Paris 1995 |
|
SO, H., Cambodgiens de la deuxième génération et perspectives de retour : le cas de jeunes diplômés, Mémoire de DEA de Sociologie, Paris V, 1997 |
|
ABDALLAH-PRETCEILLE, M., “ Compétence culturelle, compétence inter-culturelle ” dans Le Français dans le monde, n° spécial, (coordonné par L. Porcher), 1996, pp. 28-38 |
|
ABDALLAH-PRETCEILLE, M., “ La perception de l’Autre ” dans Le Français dans le monde, n°181, 1983, pp. 40-44 |
|
AUGE, M., “ Culture et imaginaire : la question de l’identité ” dans Revue de l’Institut de sociologie, n° 3-4, 1988, pp.51-61 |
|
BEATA NEVES FLORES, L.-F., “ Mémoires migrantes ; migration et idéologie de la mémoire sociale ” dans Ethnologie française, n° XXV, 1, 1995, pp. 43-49 |
|
COSTA-LASCOUX, J., “ Il n’y a pas de culture monolithique ” (propos recueillis par M. Abdallah-Pretceille), dans Le Français dans le monde, n° spécial (coordonné par L. Porcher), 1996, pp. 39-46 |
|
CUCHE, D., “ Nouveaux regards sur la culture ”, dans Sciences Humaines, n°77, 1997, pp. 20-27 |
|
WEBER R. : “ De la réalité multiculturelle à la démarche interculturelle : quels défis pour le conseil de l’Europe ? ” in Saez J.P. (dir.) : Identités, cultures et territoires, Paris, Desclée de Brouwer, 1995, pp. 79-92. |
|
ZARATE, G., “ Objectiver le rapport culture maternelle / culture étrangère ” dans le Français dans le monde, n° 181, 1983, pp. 34-39 |
Guide d’entretien
*vie familiale : rapport avec les parents
-
signification ou conception de la famille-
solidarité, grands-parents-
degré d’indépendance et de vie privée*habitude alimentaire
*vie sociale :
-
conception de l’amitié-
amour (vivre en union libre ou mariage, vivre en couple mixte)-
profession : le but de travail ? (voir différences éventuelles entre homme et femme)*vie citoyenne
-
Pour ceux qui ne sont pas nés en France, demande ou non de la nationalité française.-
Pour ceux qui ont la nationalité française, demander s’il y a un lien entre la nationalité et le sentiment d’appartenance.*Degré d’intégration dans la société française
-
Perception de l’appartenance (plutôt française ou cambodgienne). Est-elle vécue comme un écartèlement ou comme un enrichissement ?*vie associative
*vie religieuse
*vie politique
*Raisons de l’apprentissage de khmer.
I. La position identitaire des étudiants
A. La définition de leur identité
B. Identité double ou identité mixte ?
1. Bref aperçu du concept d’identité culturelle
2. Vers une identité syncrétique
C. Acculturation ou assimilation ?
D. Manifestations collectives du sentiment d’appartenance
II. Signification de l’apprentissage de la langue khmère
A. Motivation utilitaire.
B. Motivation affective
C. Motivation culturelle
Conclusion
Bibliographie
Annexe
Table des matières
![]()
[1] BERTAUX D., Les récits de vie, Paris, Nathan Université, 1997, p. 17
[2] Quand un jeune parle de tradition, il entend les règles et les interdits liés à la culture khmère et transmis prioritairement par les parents.
[3] Voir COSTA-LASCOUX J. : “ Il n’y a pas de culture monolithique ”, (propos recueillis par M. Abdallah-Pretceille) dans le Français dans le monde, janvier 1996, n° spécial (coordonné par L. Porcher), p. 44
[4] Sélim ABOU définit la culture vivante comme l’ensemble des activités qui ont pour fonction souterraine d’actualiser et de réinterpréter le patrimoine pour y trouver des réponses adéquates aux défis que constituent les événements nouveaux, in L’identité culturelle, Paris, éd. Anthropos, 1981, p. XIV
[5] CUCHE D., La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, 1996, p. 86
[6] CUCHE D., op. cit. (1996) p. 91
[7] Voir CUCHE D., op. cit. (1996) p. 92
[8] CUCHE D., op. cit. (1996) p. 93
[9] Mémorandum pour l’étude de l’acculturation, États-Unis, 1936, citée dans D. Cuche, op. cit. 1996, p. 54
[10] CUCHE D., Ibid.
This site was last updated 05/16/04