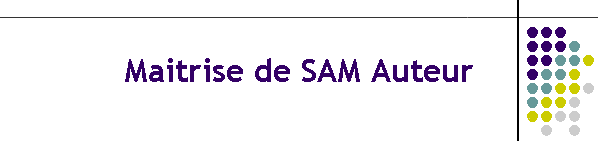
|
|
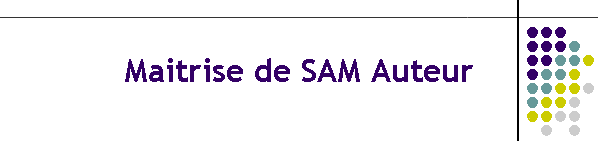 |
|
05/17/04 |
|
|
SAM Auteur a le plaisir de vous présenter sur cette page son travail de Maîtrise.Son talent sur le verlan khmer impressionne toujours ses amis mais son coeur impénétrable reste encore une question obscure. SAM Auteur est pour nous un vrai personnage mystérieux voire mythique ! |
UNIVERSITE PARIS-X NANTERRE
DEPARTEMENT DES SCIENCES DU LANGAGE
Maîtrise de Sciences du Langage
ETUDE DU FONCTONNEMENT DE
ruoc
rYc
EN KHMER CONTEMPORAIN
Mémoire présenté par Mr. SAM Auteur
Sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Jacques FRANCKEL
Année universitaire 1997-1998
ETUDE DU FONCTIONNEMENT DE
/
ruoc/rYc
EN KHMER CONTEMPORAIN
Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Jean-Jacques FRANCKEL qui a bien dirigé mon travail de recherche et qui l'a orienté autant dans sa construction que dans son contenu.
Nous remercions également l'Ambassade de France de Phnom Penh et plus particulièrement Monsieur Sylvain VOGEL, attaché linguistique et professeur de linguistique à l'Université de Phnom Penh, qui nous a permis d'obtenir une bourse du gouvernement français pour mener à bien ce travail.
Nos remerciements s’adressent à toutes les personnes qui nous ont aidé dans cette recherche et en particulier à Monsieur KING Hoc Dy qui a bien voulu accepter d’être jury de notre soutenance.
SOMMAIRE
Introduction
I. «ru
oc» dans la langue khmèreA. Présentation succincte de la langue khmère
B. Définitions lexicographiques de «ru
2c»II. «ru
oc», UNITE LEXICALEA. « Ruoc » en construction transitive directe.
B. « Ru
oc » en construction transitive indirecte.C. « ru
oc » en construction transitive fusionnelleIII. «ru
oc», unité grammaticaleA. «ru
oc», CONJONCTIONB. «RUoC», ADVERBE
1. Fonction modale
2. Fonction temporelle
Conclusion
Bibliographie
Dans le domaine de la linguistique khmère, nous avons constaté que l’étude sur le fonctionnement des particules spécifiques s’avère peu nombreux. Or, la langue khmère est une langue riche en particules dont nous citons les plus courantes : «ruoc», « ba:n », « haej », « kaet », etc. Il est donc intéressant de mener un travail de recherche, qui est conduit dans le cadre d'une théorie linguistique développée en France, sur ces particules.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi la particule «ruoc». Ce choix s’explique par :
-
L'emploi de «ruoc» semble, malgré certaines constantes, un sujet de recherche très large et permet de mener des investigations multiples qui peuvent servir à l'élaboration d'une étude approfondie et systématique de la langue khmère.-
«Ruoc», autant à l’oral qu’à l’écrit, est d’un emploi fréquent. Son omniprésence ainsi que son association étroite à d'autres unités comme /ba:n/ et /haej/ ouvre en conséquence un champ de recherche important.-
Du point de vue grammaticale, «ruoc» peut être employé comme verbe, conjonction et adverbe.Notre travail consiste, tout d’abord, à constituer un corpus à partir des énoncés khmers recueillis dans des romans, des magazines, des presses écrites… Ces énoncés contiennent la particule «ruoc» employée dans de différentes constructions dans lesquelles elle se trouve mise en jeu. Ensuite, nous allons effectuer un classement d’emplois de «ru2c» selon la catégorie lexicale et grammaticale. Notre objectif sera, enfin, d'essayer de façon non exhaustive de cadrer le mieux possible les emplois de «ruoc», de dégager ses constantes, d'étudier à partir d'énoncés différents, les changements de sens quand «ruoc» est en interaction avec des lexèmes différents, les influences réciproques de contamination.
Après avoir présenté brièvement la langue khmère et les définitions lexicographiques de «ruoc», nous étudierons les différentes fonctions de ce « terme » : dont, d’une part, l’unité lexicale (en construction transitive directe, indirecte et fusionnelle), et d’autre part, l’unité grammaticale (verbe, conjonction et adverbe).
Le khmer
[2] est la langue officielle du Cambodge. C'est la langue principale du groupe linguistique khmer-mon (ou mon-khmer). Elle est parlée au Cambodge bien sûr, mais également dans d'autres pays par quelques minorités (Chine, Birmanie, Laos, Thaïlande, Viêt-nam, etc.).Les écrits les plus lointains qui attestent la langue khmère remontent au IIIème siècle de l'ère chrétienne. D'après les linguistes, c'est une langue qui est difficile à classer. Beaucoup d'entre eux se sont efforcés de lui trouver des liens de parenté avec des groupes linguistiques plus importants sans obtenir des résultats consistants. Les influences les plus marquées semblent être le sanskrit et le pâli. Ces influences trouveraient leurs origines au début du XIVème siècle à partir de l'introduction du Bouddhisme par les Indiens. Tout le vocabulaire culturel, intellectuel, religieux, administratif ou militaire est d’origine indienne. Par exemple, «Angkor», provient de «nagara» qui signifie «ville» dans les langues indiennes.
On se plaît à dire que la langue khmère est aujourd'hui en danger parce que très peu d'études linguistiques ont été réalisées et qu'il n'y a pas de dictionnaire de traductions vers une langue internationale importante. Nous utilisons depuis l'année 1967 la même édition du dictionnaire unilingue du vénérable CHUON Nath, Dictionnaire cambodgien, en 2 volumes, 5e éd. (Tome I : 1967, Tome II : 1968), de l’Institut bouddhique à Phnom Penh. Il faut savoir aussi qu'actuellement la langue khmère s’enrichit abondamment de termes d'introduction récente.
Cependant, malgré ce que l'on peut considérer comme un affaiblissement, la langue reste aujourd'hui, même chez les jeunes, un élément solide de l'identité khmère. A priori, la grammaire est d’une grande simplicité, mais on ne peut pas dire pour autant que c'est une langue simple.
En effet, sauf quelques rares exceptions, tous les mots sont invariables : ni déclinaisons, ni genre, ni conjugaisons. Le khmer dans le cas de la conjugaison, par exemple, recourt à des procédés qu'ils lui sont propres. La fonction grammaticale du mot n'est pas définie par sa forme mais par sa place dans la phrase. Beaucoup de mots sont polysémiques et peuvent avoir des fonctions différentes : verbe, adverbe, conjonction, etc.
En ce qui concerne l'écriture, les mots, formés par des signes, se succèdent, dans une phrase, sans intervalle. Les consonnes sont réparties en deux registres totalisant 33 signes différents. Il y a 13 voyelles de base qui forment, accompagnées d'autres signes, un ensemble de 28 voyelles qui se prononcent différemment suivant le registre de la consonne à laquelle la voyelle est attachée (/b/ + /a/ peut se prononcer /ba/ ou /bi2/). La phonologie de la langue khmère ne peut se comparer avec la phonologie d'aucune autre langue. En effet, si la phonétique d'une voyelle change suivant la consonne avec laquelle elle est employée les mots aussi changent de fonction et de sens suivant les autres mots ou les autres particules auxquels ils sont associés.
Tout ceci pour dire qu'il nous paraît illusoire de vouloir transférer à l'étude de la langue khmère sur une grille d’analyse systématique propre à l’étude linguistique d'une autre langue quelle qu'elle soit. Cependant illusoire ne veut pas dire impossible et notre tentative d’analyse, objet de notre mémoire, ne peut qu’enrichir et servir à l’élaboration d’une méthode d’analyse de notre langue.
Nous tenterons donc de réaliser l'analyse d'une des nombreuses particules, particulièrement mobile et polysémique de la langue khmère, même si le champ d'investigation est si large que prétendre à une analyse exhaustive peut paraître ambitieux.
Dans cette partie, nous nous limitons à relever les définitions essentielles du mot «ruoc» dans les deux dictionnaires suivants :
Selon le Dictionnaire pratique Cambodgien-Français de Monsieur Alain DANIEL, publié en 1985 par l’Institut de l'Asie du Sud-Est, pages 412 et 413, «ruoc» est traduit en français ainsi :
« ru2c » : 1). Achevé, fini.
2). Ensuite, après quoi, alors.
3). S'échapper, s'en tirer, réussir, pouvoir.
4). Exprime qu'une action est achevée.
Lorsque «ruoc» est employé avec d’autres lexèmes, par la contamination de ces derniers il a différentes significations.
« ruoc khluon » : 1). S’échapper, se libérer.
2). A l’égalité (dans un jeu).
« ruoc roal » : Achever entièrement.
« ruoc ci:vit » : Survivre, sauver sa vie.
« ruoc phot » : S’échapper, s’esquiver, obtenir sa liberté, réussir à traverser.
« ruoc pi:daij » : Être achevé.
« ruoc pi:moat » : Avec frivolité, sans sérieux.
« ruoc mork » : Ensuite, après.
« ruoc roal » : Finir, achever.
« ruoc srac » : Complètement achevé, fini.
« ruoc haej » : Fini, déjà, c’est fini.
L’autre dictionnaire unilingue du vénérable CHUON Nath., Dictionnaire cambodgien, en 2 volumes, 5ème édition (tome I : 1967, tome II : 1968), de l’Institut bouddhique à Phnom Penh, page 1089, donne des explications plus complexes :
« Ru2c » ayant fonction grammaticale de verbe, veut dire approximativement :
- rbUtput
/robo:t phot/ échapper, rbUtputBIéd /robo:t phot pi: dai/ = rYcBIéd/ruoc pi: dai/ échapper à la main.- redaH
/rodâh/ s’échapper, être libéré ; redaHBITukç /rodâh pi: tuk/ = rYcBITukç /ruoc pi: tuk/ s’échapper du malheur.« Ruoc » ayant fonction grammaticale d’adverbe, veut dire :
- eRsc
/srac/ exécuté, achevé, fini, terminé ; eFVIkareRsc /thveu ka: srac/ = eFVIkarrYc /thveu ka: ruoc/ avoir fini de travailler.- ekIt
/kaet/, )an /ba:n/, dac; /dac/, capable de, possible de ; niyayekIt /ni:jiej kaet/ = niyayrYc /ni:jiej ruoc/ être capable de parler ; eTA)an /tov ba:n/ = eTArYc /tov ruoc/ possible d’y aller ; Gandac; /a:n dac/ = GanrYc /a:n ruoc/ capable de lire.Nous constatons que «ruoc» est donc un mot polysémique.
Pour pouvoir dégager le rôle central, la propriété pertinente, le mécanisme de «ruoc» dans le cas où «ruoc» est mis en jeu comme verbe plein, nous allons présenter les principaux emplois de «ruoc», à travers des énoncés de différentes structures syntaxiques. On peut trouver aussi des éléments du contexte qui ont des effets sur l'interprétation des énoncés dans lesquels l'unité « ruoc » se trouve employée, mais on peut également faire l'hypothèse que certains éléments sont particulièrement mis en relation par cette unité même.
En tant que verbe plein, «ruoc» s'emploie dans deux structures syntaxiques différentes : transitive directe et transitive indirecte. Les expressions dans lesquelles où «ruoc» est mis en jeu peuvent prendre des valeurs qui, dans une traduction approximative en français, mobiliseraient des verbes ou des expressions aussi varié(e)s que :
-
échapper à / s'échapper de / se libérer de / se débarrasser de (ses engagements) / se tirer de / se sortir de /se dégager de /s'évader de …-
sauver (sa) vie / survivre / être survivant …-
récupérer (sa) mise de départ(qqch. de perdu) …-
être quitte envers qqn. de qqch. / s'acquitter de (ses dettes, ses engagements) …-
finir qqch. …-
être capable de / réussir à / arriver à …Nous étudions d'abord «ruoc» dans des expressions où il se trouve employé dans une construction transitive directe (notée : C
0 + ruoc + C1), puis dans un deuxième temps, dans une construction transitive indirecte (dans le cas où le verbe est suivi de la préposition /pi:/ (notée : C0 + ruoc + pi: + C2), et enfin dans la construction de la forme (notée : C0 + ruoc + pi: + C2) que nous appellerons transitive «fusionnelle».C0
[3] + ruoc + C1[4]porte sur
C
0 + ruoc + C1rapport étroit (intime)
sous forme de contrat
(d'engagement nécessaire)
Dans la cas où «ruoc» se trouve employé comme verbe plein dans la construction transitive directe, «ruoc» porte systématiquement sur le terme C
1, complément d'objet direct. Il marque le passage de C0 d'un état de contraintes et d'instabilité P', à un état de référence P, stable et sans contrainte.Il faut souligner au préalable que «ruoc» ne peut pas porter sur n'importe quel terme puisque la nature même de ce terme sera en partie déterminée par «ruoc». nous emploierons avec le terme mis en relation au lexème dans notre développement.
|
(1) |
suxa |
rYc |
xøÜn . |
|
|
Sokha |
ru2c |
khlu2n[5] |
|
|
PREN. |
PART. |
Corps |
Traduction approximative possible :
Sokha a échappé ou Sokha a sauvé sa peau (suivant le contexte et la situation).
A toutes fins utiles, il est à noter que, dans le langage courant (voire populaire), on utilisera cet énoncé comme en français « j'ai sauvé ma peau».
En écoutant cet énoncé, le locuteur khmérophone comprend effectivement que Sokha (C
0) a échappé à une contrainte et que Sokha se trouvait auparavant dans une situation problématique. Cette interprétation provient de la propriété de «ruoc» mis en relation au lexème /khluon/ (corps). «Ruoc» marque le fait que C0 en relation intime avec C1 est passé d'un état de chose sous contrainte à un état de chose sans contrainte.Notons bien que, dans cette expression, le terme /khluon/ est le propre corps de Sokha. Cette expression peut être rendue en français par une forme réfléchie : « Sokha s’est libéré de … », mais en khmer /khlu2n/ conserve bien sa valeur de corps.
Selon l'énoncé (1), on ne sait toujours pas quel genre de contraintes affectait C
1. Notre curiosité nous rend susceptible de vouloir poser une question supplémentaire pour que l'énoncé (1) soit clair et précis en fonction du contexte avec : >>>BIGVI ? : … /pi: av�j ?/ : …à quoi ? suxarYcxøÜnBIGVI ? : A quoi Sokha a-t-il échappé ?L'énoncé (1), dans sa forme présente, peut apparaître dans des contextes ou des situations multiples et variées.
La situation :
Sokha, surpris près du corps d'un homme, est accusé de crime puis menacé de peine de mort. Au cours des audiences au tribunal, son avocat apporte, dans ses plaidoiries, les preuves de son innocence. En réalité, il n'a pas commis ce crime ; il est innocent.
A présent, nous voudrions présenter d'autres énoncés dans lesquels le procès «ru2c» est mis en relation [dans la même construction que l'énoncé (1)] à d'autres lexèmes, afin de nous faire une idée de changement du sens liée à l'environnement lexical et contextuel.
Notons bien que, dans cette construction (transitive directe), malgré la contamination lexicale mise en relation par le procès «ruoc», le mécanisme de cette unité reste toujours le même, et garde un fonctionnement constant.
|
(2) |
suxa |
rYc |
CIvit. |
|
|
Sokha |
ruoc |
ci:vit[6] |
|
|
PREN. |
sauver |
vie |
|
|
|
échapper (belle) |
|
|
|
|
sortir (sain et sauf) |
|
|
|
|
échapper (à une contrainte «mortelle») |
|
Traduction approximative possible :
Sokha a sauvé sa vie.
C0 est dans une relation intime avec C1 puisque C1 (vie) appartient à C0 (Sokha). Cette vie, auparavant menacée, garde son intégrité.
En écoutant cet énoncé, le locuteur khmérophone comprend effectivement que Sokha a échappé à une contrainte, correspondant ici à un danger mortel (sa vie était menacée). Le sens de cet énoncé (2) paraît plus clair et plus précis que celui de l'énoncé (1), grâce au lexème /ci:vit/ (vie) ; c'est l'environnement lexical qui donne le sens et informe de la situation et du contexte. La mise en relation du terme /ci:vit/ (vie) à Sokha par «ru2c» renvoie effectivement à la propre vie de Sokha [le sujet syntaxique (C0)].
L'énoncé (2) dans sa forme présente peut se placer dans des contextes ou des situations multiples et variées.
Par exemple :
Un bateau a fait naufrage et tout le monde est mort, sauf Sokha qui reste vivant ; il a sauvé sa vie ; il a échappé à cet accident « mortel ».
Autre exemple d'énoncé où «ruoc» est mis en relation à un autre lexème (C1), élément matériel concret qui appartient à C0.
|
(3) |
suxa |
rYc |
edIm. |
|
|
Sokha |
ruoc |
daem[7] |
|
|
PREN. |
récupérer |
mise de départ (somme d'argent : capital perdu) |
Traduction approximative possible :
Sokha a récupéré sa mise de départ.
C'est-à-dire que Sokha, avant de récupérer sa mise de départ, se trouvait dans la situation de perdre sa mise. En fait, la mise de départ pouvait lui échapper définitivement.
Dans cet énoncé, «ruoc» marque la levée d'un état anormal chez le sujet (C0). «Ruoc», dans ce cas, marque le retour à la situation de référence (avoir une certaine somme d’argent) après le passage à une situation instable et anormale de perte.
Un autre exemple d'énoncé intéressant où C
0 représente deux personnes en interaction, où «ruoc» définit la nature de cette interaction.
|
(4) |
cab;BI \LÚvenH eTA EGðg nig Gj |
eyIg |
rYc |
Kña . |
|
|
cabpi: eilov nih tov[8] hèng neung anh |
jeung |
ruoc |
knie[9] |
|
|
à partir de maintenant aller toi et moi |
nous |
être quittes. |
|
Traduction approximative possible
A partir de maintenant, toi et moi, nous sommes quittes.
Dans ce cas, le complément d'objet direct n'est pas explicité mais sous entendu dans l'énoncé.
Dans le même contexte de l'énoncé (4), nous trouvons aussi un autre énoncé dans lequel le procès «ru2c» joue toujours le même rôle, mais le sujet syntaxique est seul.
(5) cab;BI \LÚvenH eTA Gj rYc Kña
cabpi: eilov nih tov anh ruoc knie
à partir de maintenant PART. je PART. PART.
CamYy nWg Ég ehIy Na+ ¡
cie muoj neung èng haej
[10] na:[11] !avec toi PART. PART.
Traduction approximative possible :
A partir de maintenant, je suis quitte envers toi.
Tous les énoncés dans lesquels l'unité «ruoc» se trouve employée comme verbe plein dans la construction transitive directe ; nous conduisent à d'autres questions sur ses emplois.
(6) caM Gj rYc kargar Gj nwg eTA CYb Ég.
cam anh ruoc ka ngea anh neung[12]
tov courb èngattendre je PART. travail je PART. aller rencontrer toi
Traduction approximative possible :
Attends que je finisse mon travail, je vais aller te voir.
A travers cet énoncé, le locuteur khmérophone comprend que C0 (sujet syntaxique) est en train d'accomplir un travail dont il n'a pas la possibilité de se libérer immédiatement ; il n'a pas non plus le choix de se libérer pour quelque raison que ce soit : raisons objectives et raisons subjectives.
-
Raisons objectives. Par exemple : un pilote d'avion en manœuvre d'atterrissage ne peut quitter les commandes. Il ne pourrait pas objectivement se déplacer.-
Raisons subjectives. Par exemple : X considère que ce qu'il est en train de faire est plus important que ce qui lui est demandé de faire d'autre.Dans l'énoncé (6), «Ruoc» est mis en relation à /ka:ngea/ (travail). Ce lexème par contamination donne le sens du procès «ruoc» soit «finir». Ce qui implique que la levée de la contrainte est une condition à la réalisation de l'action demandée.
Dans le cas où le sujet n'est pas sous une contrainte mais où il peut décider pour lui même, on pourrait remplacer «ruoc» par :
bBa©b; /banh câb/ «arrêter» ce qui pourra avoir la même traduction mais qui donnera en réalité un autre sens à la phrase.Dans le même contexte, nous trouvons un autre exemple d'énoncé correspondant à une expression très familière. Cet énoncé est présenté ici pour introduire la mis en relation à un autre lexème couramment utilisé dans la langue khmère. Cet exemple est identique à l'énoncé (6) mais propose une autre formulation.
(7) caM Gj rYc éd Gj nwg eTA CYb Ég Pøam.
cam ah ruoc daij
[13] anh neung tov cuob èng phleamattendre je PART. main je PART. aller rencontrer toi tout de suite
Traduction littérale :
Attends que je finisse les mains, je vais aller te voir tout de suite.
Traduction approximative possible :
Attends que j'aie les mains libres, je vais te voir tout de suite.
En écoutant cet énoncé, le locuteur comprend effectivement que la personne que désigne C0 est en train d'accomplir son travail avec ses mains.
A travers cet énoncé, nous nous rendons compte que C
0 se trouvait auparavant lié nécessairement à son travail par un contrat ou un engagement : «ruoc» marque ici la levée de cet engagement (cette contrainte). A partir du moment où il aura effectivement fini son travail et il aura éliminé la contrainte, il sera en mesure d'aller voir son interlocuteur.Comme l'énoncé précédent, l'énoncé suivant (8) est proposé ici parce qu'il est souvent utilisé dans le quotidien au Cambodge.
Situation :
Maman est en train de discuter avec ses invités. L'un de ses enfants lui demande de l'aider à faire ses devoirs. La maman demande à son fils de bien vouloir attendre quelques secondes pour qu'elle finisse sa discussion et se rende disponible pour venir l'aider.
Un exemple d'énoncé sous forme d'une expression courante :
(8) caM Gj rYc mat; sin Gj nWg eTA CYb Ég Pøam.
cam anh ruoc moat
[14] sen[15] anh neung tov coub èng phleamattendre je PART. bouche PART. je PART. aller rencontrer toi tout de suite
Traduction littérale :
Attends que je finisse la bouche d'abord, je vais aller te voir .
Traduction approximative possible :
Attends que je finisse de discuter et je vais te voir tout de suite
L'exemple suivant (9) se caractérise par le fait que «ruoc» est mis en relation au terme /phnék/ (yeux).
Comme l'énoncé précédent, il est souvent utilisé dans le quotidien au Cambodge.
Situation :
Papa est en train de lire son journal. L'un de ses enfants lui demande de l'aider à faire ses devoirs. Le papa demande à son fils de bien vouloir attendre quelques secondes pour qu'il puisse finir ce qu'il était en train de lire afin de se rendre disponible venir (ou aller) l'aider.
(9) caM Gj rYc EPñk sin Gj nwg eTA CYy Ég Pøam.
cam anh ruoc phnék
[16] sen anh neung tov cuob èng phleamattendre je PART. yeux PART. je PART. aller aider toi tout de suite
Traduction littérale :
Attends que j'aie les yeux libres d'abord, je vais aller t'aider tout de suite.
Traduction possible :
Attends que je finisse ma lecture, je vais t’aider tout de suite.
Dans les énoncés précédemment où «ruoc» est employé dans la forme transitive directe, nous pourrions dire que «ru2c» permet des raccourcis de langage lorsque le sujet (C0) est une personne physique et qu'elle utilise une partie de son corps pour réaliser une action dont il sera nécessaire de se libérer pour entreprendre une autre action (voir exemples ci-dessous).
(7.1.) caM Gj lag can¬k,an¦ rUc Gj nwg eTA CYb Ég. (sans le mot «main», avec «ruoc»).
cam anh leing ca:n(kba:n) ruoc anh neung tov cuob èng
attendre je laver vaisselle PART. je PART. aller rencontrer toi
Traduction littérale :
Attends que je lave la vaisselle finie, je vais aller te rencontrer.
Traduction approximative possible :
Attends que je finisse de faire la vaisselle, je vais te voir (c’est-à-dire : attends que je sois « libéré » de la vaisselle pour que je sois disponible pour aller te voir).
(7.2.) caM Gj TMenr éd Gj nwWg eTA CYb Ég.
(sans «ruoc», avec «main»).cam anh tum né dai anh neung tov courb èng
attendre je libre main je PART. aller rencontrer toi
Traduction littérale :
Attends que je libère les mains, je vais aller te voir.
Traduction approximative correcte possible :
Attends que j'aie les mains libres, je vais te voir.
(7.3.) caM Gj rYc éd Gj nwg eTA CYb Ég. (avec «main», et «ruoc»).
cam anh ruoc dai anh neung tov cuob èng
attendre je PART. main je PART. aller rencontrer toi
Traduction littérale :
Attends que je finisse les mains, je vais aller te voir.
Traduction approximative correcte possible :
Attends que j'aie les mains libres, je vais aller te voir.
(8.1.) caM Gj CECk Kña rYc Gj nwg eTA CYb Ég.
(sans le mot «bouche», avec «ruoc»).cam anh cor cék khnea ruoc anh neung tov cuob èng
attendre je discuter PART. PART. je PART. aller rencontrer toi
Traduction approximative correcte possible :
Attends que je finisse de discuter avec quelqu'un, je vais te voir.
(8.2.) caM Gj TMenr mat; Gj nwg eTA CYb Ég.
(sans «ruoc», avec «bouche»).cam anh tum né moat anh neung tov cuob èng
attendre je libre bouche je PART. aller rencontrer toi
Traduction littérale :
Attends que je libère la bouche, je vais aller te voir.
Traduction approximative correcte possible :
Attends que je finisse de discuter, je vais te voir.
(8.3.) caM Gj rYc mat; Gj nwg eTA CYb Ég.
(avec «ruoc» et «bouche»).cam anh ruoc moat anh neung tov cuob èng
attendre je PART. bouche je PART. aller rencontrer toi
Traduction littérale :
Attends que je finisse la bouche, je vais aller te voir.
Traduction approximative correcte possible :
Attends que je finisse de discuter, je vais te voir.
(9.1.) caM Gj emIl kaEst cb; Gj nwg eTA CYb Ég.
(sans «yeux», sans «ruoc»).cam anh meul ka: sèt câb anh neung tov cuob èng
attendre je regarder journal finir je PART. aller rencontrer toi
Traduction approximative incorrecte :
Attends que je regarde le journal finir, je vais aller te voir.
Traduction approximative possible :
Attends que je finisse de lire mon journal, je vais te voir.
(9.2.) caM Gj TMenr EPñk ¬BIkarGankaEst¦ Gj nwg eTA CYb Ég.
(sans «ruoc», avec «yeux»).cam anh tum né phnék anh neung tov cuob èng
attendre je libre yeux (PREP. lect. du journ.) je PART. aller rencontrer toi
Traduction littérale :
Attends que je libère les yeux libres de la lecture, je vais aller te voir.
Traduction approximative possible :
Attends que je finisse ma lecture, je vais aller te voir.
(9.3.) caM Gj rYc EPñk ¬BIkaremIlkaEst¦ Gj nwg eTA CYb Ég.
(avec «ruoc», avec «yeux»).cam anh ruoc phnék anh neung tov cuob èng
attendre je PART. yeux je PART. aller rencontrer toi
Traduction littérale :
Attends que j'aie les yeux de ma lecture, je vais aller te voir.
Traduction approximative possible :
Attends que je finisse ma lecture, je vais te voir.
B. « Ruoc » en construction transitive indirecte
C0 + ru2c + pi: + C2
porte sur
terme indiquant le type ou le genre de contraintes
Dans le cas où «ruoc» se trouve employé comme verbe plein dans la construction transitive indirecte (notée : C0 + ruoc + pi: + C2), ruoc porte systématiquement sur le terme C0. Dans ce cas, C0 se trouve délivré d'une contrainte et passe à un état de non contrainte (nous avons vu que, dans la forme transitive directe, « ruoc » portait systématiquement sur C1 : complément d'objet direct).
Pour les énoncés suivants, nous ne présenterons que des énoncés qui nous semblent intéressants et qui peuvent nous donner des idées pour notre recherche sur les mécanismes du fonctionnement du procès « ru2c » dans la construction transitive indirecte.
A présent, nous reprenons l'énoncé (6) que nous adapterons à une forme transitive indirecte (C0 + ru2c + pi: + C2).
(10) caM Gj rYc BI kargar Gj nwg eTA CYb Ég.
cam anh ruoc pi ka: ngea anh neung tov cuob èng
attendre je PART. PREP. travail je PART. aller rencontrer toi
Traduction approximative possible :
Attends que je me débarrasse de mon travail, je vais te voir.
Cet énoncé (10) et l'énoncé (6) sont souvent l'un comme l'autre, produits par les khmérophones sans différence de sens bien repérable.
En ce qui nous concerne, nous sentons plus ou moins une nuance, mais elle apparaît si ténue que l'on a du mal à la distinguer et surtout à l'expliciter pour la préciser. Nous essaierons de proposer des cas où la différence de sens entre ces deux constructions (transitive directe pour l'énoncé (6) ; et transitive indirecte utilisée avec le terme /pi:/ pour l'énoncé (10)) apparaît assez nettement.
A travers cet énoncé (10), comme l'énoncé (6), le locuteur se rend compte que C
0 était sous la contrainte (l'engagement) d'accomplir un travail dont il ne peut se libérer au moment T0 (où il parle). «Ruoc» dans ce cas (cas où «ruoc» se construit avec la préposition /pi:/) porte systématiquement sur le sujet syntaxique et en même temps marque le fait que le sujet syntaxique est libéré d'une contrainte ou d'un engagement dans la mesure où ce procès «ruoc» est validé, actualisé.Pour ce qui concerne la nuance que nous proposons de faire ressortir plus haut, nous ferons appel à la structure française.
Dans l'énoncé (6), la traduction était « Attends que je finisse mon travail, je vais aller te voir » mais le sens était : il est impossible de quitter mon travail mais ce n'est qu'une affaire de quelques minutes.
Dans l'énoncé (10), on peut avoir la même traduction, mais ici, le travail peut être considéré comme un prétexte. Cela sous entend un refus diplomatique à la demande de l'interlocuteur.
(11) RbeTs eGora:k; rYc BI TNÐkmµ esdækic© GnþrCati.
prâ téh irak ruoc pi tuon ne kam séthe kec ân ta rak ceat
pays Irak PART. PREP. sanction économie international
Traduction approximative possible :
L'Irak s'est libérée de (l'imposition) l'embargo.
Ou : L'Irak s'est débarrassée de la mise sous embargo.
En écoutant cet énoncé, le locuteur se rend compte que l'Irak, auparavant, se trouvait sous embargo (sous une contrainte), et à partir du moment où cet embargo est levé, l'Iraq se trouve libérée de cette situation de contrainte.
Dans ce cas, «ru2c» marque la levée de contrainte sur le sujet syntaxique en désignant effectivement sa libération.
Remarque : dans la forme transitive indirecte, le complément (C
2) précédé de la préposition /pi:/ est susceptible de caractériser le type ou le genre de contraintes sous lequel C0 ou C1 se trouvait (P') bloqué.Aussi, est-il susceptible de donner des informations supplémentaires, claires sur le contexte de la situation donnée.
Avertissement : nous éviterons de répéter systématiquement par la suite le principe régulier que nous avons dégagé (celui du passage d'une situation de contrainte à une situation de non contrainte), afin d'alléger notre développement, puisque c'est une constante au mécanisme du fonctionnement de «ruoc».
Toutefois, nous allons voir qu'il s'agit d'un principe directeur que l'on retrouve sous des formes diverses dans les autres emplois de «ruoc», y compris ceux dont la fonction est plus spécifiquement grammaticale.
C0 + ruoc + C1 + pi: + C2 porte sur
C
0 + ru2c + C1 + pi: + C2rapport étroite (intime) sous terme indiquant forme de contrat (engagement nécessaire) le type ou le genre de contraintes.
Pour introduire la forme transitive que nous avons appelée fusionnelle, nous ferons un parallèle avec la langue française en utilisant la traduction des autres formes, c'est-à-dire transitive directe et transitive indirecte, en les comparant à chacune.
a) Prenons l'énoncé (1) : xøÜn /khluon/ (corps)suxa rYc xøÜn.
Sokha ruoc khluon
PREN. PART. corps
Traduction :
Le corps de Sokha a échappé.
Ou plus précisément :
Sokha a échappé.
suxa rYc BI KuK.
Sokha ruoc pi: kuk
PREN. PART. prép. prison
Traduction approximative possible :
Sokha a échappé à la prison.
suxa rYc xøÜn BI KuK.
Sokha ruoc khluon pi: kuk
PREN. PART. corps prép. prison
Traduction :
Sokha a échappé à la prison.
Il semble en apparence que la traduction de (3) est identique à la traduction de (2) et pourtant le sens est différent. Dans le cas de (3), Sokha est libéré de la sanction que représente la prison.
1). Cas (2) : Sokha était déjà en prison et la sanction (pour raison X) a été levée (soit par lui-même en s'évadant, soit il a exécuté la sanction).
2). Cas (3) : Sokha pensait avoir un an à l'issue de son procès il n'a que dix milles riels d'amande; il échappe à la sanction.
Finalement, la traduction de (3) pourrait être : Sokha échappe à la sanction de la prison. Cette différence de sens entre (2) et (3) reposent uniquement sur l'utilisation de lexème /khluon/ : corps. (voir exemple (1)).
suxa rYc CIvit.
Sokha ruoc ci:vit
PREN. PART. vie
Traduction littérale :
La vie de Sokha a échappé.
Ou plus précisément : traduction approximative correcte possible :
Sokha a sauvé sa vie. (voir exemple (2))
suxa rYc BI ¬kar¦lg;TWk.
Sokha ruoc pi: (ka:) lung teuk
PREN. PART. PREP. noyade
Traduction approximative possible :
Sokha a échappé à la noyade.
suxa rYc Civit BI karlg;TWk.
Sokha ruoc ci:vit pi:(ka:) lung teuk
PREN. PART. vie prép. noyade
Traduction approximative correcte possible :
Sokha a échappé à la noyade.
Il semble en apparence que la traduction de (3) est identique à la traduction de (2) et pourtant le sens est différent.
1). Cas (2) : Sokha a échappé à la noyade grâce à un événement extérieur.
2). Cas (3) : Sokha a échappé à la noyade par lui-même (en nageant).
Finalement, la traduction (3) pourrait être : Sokha échappe à la noyarde. Cette différence de sens entre (2) et (3) reposent uniquement sur l’utilisation de lexème /ci:vit/ (vie).
Dans la forme transitive fusionnelle, on s'aperçoit que «ruoc» porte autant sur C
0 (sujet syntaxique ) que C1 (complément d'objet direct). En plus le rapport entre C0 et C1 est étroit (ou intime) et indispensable.Dans cet énoncé suivant, nous sommes dans le contexte particulier où la levée de la peine de mort tient à un rapport intersubjectif : c'est la cours qui « délivre » Sokha de la peine de mort. Mais c'est grâce à la bonne plaidoirie de son avocat.
«Ruoc» s'actualise dans cette intersubjectivité.
(12) suxa rYc xøÜn BI eTas RbharCivit edaysar kartv:a
Sokha ruoc khluon pi: to:h prâ hha: ci: vit daoj sa: ka: tâ va:
PREN. PART. corps PREP. peine tuer vie grâce à plaidoirie
d¾biunRbsb; én emFavI rbs; va.
dâ pen prâ sâb nei mé thea vi: ro: bâh vie
très habile PREP. avocat PREP. il
Traduction approximative possible :
Sokha a échappé à la peine de mort grâce à la bonne plaidoirie de son avocat.
Cet énoncé implique que l'actualisation de «ruoc» affecte C0
et C1. Notons que ce passage à un état de référence (libre de contraintes) peut correspondre à l'idée du retour à la normale, assimilable, dans notre exemple à un état original.«Ruoc» peut donc fonctionner comme verbe plein (cas des emplois lexicaux). Il correspond alors à un procès de type inchoatif qui marque, plus précisément, que l'on passe de la présence de contraintes bloquant P (ce qui fait qu'on part de P'),à l'absence de contraintes (ce qui fait que P est validé). Donc «ruoc» valide P en marquant la levée des contraintes qui, au départ, entraînaient P'. Ce passage de P' à P affecte un terme X (qui correspond à C
0 ou C1).Positionnement de «ruoc» dans la phrase :
Dans le cas où la particule «ruoc» s'emploie comme conjonction, elle se trouve placée toujours en tête de la proposition subordonnée. Dans cet emploi, elle joue, en même temps, deux rôles (très importants).
1). D'une part, elle introduit un aspect verbal qui définit l'achèvement effectif de l'action dans la proposition principale (la première proposition).
2). Et d'autre part, elle introduit une chronologie entre la proposition principale à la proposition subordonnée, à condition que l'action du procès de la proposition principale soit réalisée. A partir de cette réalisation, la conjonction «ru2c» est susceptible d'articuler une autre proposition, considérée comme proposition subordonnée dans une chronologie sous forme de séquences de phrases narratives ou descriptives.
Remarque :
-
«Ru2c» en fin de proposition principale aura fonction d'adverbe.-
«Ru2c» en début de proposition subordonnée aura fonction de conjonction.C'est sa position dans la phrase qui détermine sa fonction.
ru2c
proposition principale proposition subordonnée
(13) suxaebIk TVar ehIy rYc va k¾ ecjeTAedayKµan la mYy ma:t;.
Sokha baek thvea ruoc vie kâ[22] cenh tov daoj kkmean lea muoj moat[23]
PREN. ouvrir porte PART. PART. il alors sortir aller sans dire au revoir un PART.
Traduction approximative possible :
Sokha a ouvert la porte, puis il est parti sans dire au revoir.
La traduction du «ruoc» par le mot «puis» doit être considéré comme approximative parce qu'elle ne donne pas un sens précis à la phrase. En effet, «puis», dans la langue française, pourrait être remplacé par le mot «et» ce qui n'est pas possible en khmer.
«Ruoc» implique une chronologie qui met en œuvre le principe directeur dégagé à travers les emplois en tant que verbe plein: c'est-à-dire pour que la deuxième action puisse se réaliser, il faut que la première action l'ait déjà été. Autrement dit, l'accomplissement de cette première action lève la contrainte qui empêcherait la seconde, alors que dans les autres traductions le mot «et, ehIy /haej/, nig /neung/ ou ehIy nig /haej neung/» cette fonction n'est pas obligatoire.
«Ruoc» peut être employé avec d'autres lexèmes qui peuvent exprimer une idée «centrifuge» ou «centripète» de repère temporel dans la continuation de la narration d'une histoire ou d'une action.
Exemple : - rYc mk /ru2c mork[24]/
Traduction approximative : «Et puis»
Cette traduction est plus évidente en anglais ou lorsque le narrateur s’arrête provoquant l'impatience de celui qui l'écoute, celui-ci dira «come on» ou «viens» sous entendu «continues (ton histoire) !»
On a donc un contexte du type blocage (quelque chose empêche la narration de se poursuivre) et «ru2c» renvoie à la levée de blocage afin que la narration reprenne.
- rYc eTA
/ruoc tov/PART. PART.
Traduction approximative : «Et puis»
- rYcehIy
/ruoc-haej/PART. PART.
Traduction approximative : «Et alors»
Par cette traduction en anglais, on dira «go on» c’est-à-dire en «continue (ton histoire) !».
La classification de «ruoc» selon les critères de son appartenance catégorielle s'avère un peu illusoire, problématique.
Dans le cas où «ruoc» est associé à un verbe, il peut être considéré soit comme un adverbe, soit comme un modificateur déterminatif.
«ru2c», en tant qu'adverbe sera utilisé dans trois contextes :
1). Dans une phrase exprimant la capacité du sujet à réaliser une action (fonction modale de «ruoc» sur C
0).2). Dans une phrase exprimant l'accomplissement de l'action en terme de temps (fonction temporelle de «ruoc» sur P.
3). Dans une phrase exprimant que l'action est finie.
P + ruoc
fonction modale porte sur C
0 en indiquant et en se référant à la capacité physique de C0C
0 + P + C(…) + ru2cfonction temporelleporte sur le procès P en se manifestant et en désignant l'accomplissement du procès P
Note : - ceci est valable pour une phrase à la forme négative ou positive. Dans d'autre contexte, on emploiera d'autres adverbes (particules polysémiques) comme : «)an / ba:n[25]/, ekIt /ka2t[26]/, cb; /câb[27]/, etc. »
ta2:
[28] + C0 + P + C(…) + ruoc + rü te[29]?(14) etI Ég elIk tuenH rYc bJueT ?
tae èng leuk tok nih ruoc té ?
PART. tu soulever table ce PART. ou non ?
Traduction approximative correcte possible :
Es-tu capable de soulever cette table ?
Est-ce que tu lèves l'obstacle que constitue le poids de la table par rapport à l'objectif qui est de la soulever ?
En écoutant cet énoncé, nous comprendrons qu'il s'agit d'une personne qui demande à son interlocuteur de soulever une table. Le locuteur veut connaître, en fait, la capacité physique de son interlocuteur, à qui il adresse cette question. Cette compréhension provient de la propriété du marqueur «ruoc» dans la question.
A priori, soulever la table est un «défi», son poids fait obstacle au fait de la soulever, de sorte que «ru2c» est ici associé à l'idée de vaincre un obstacle, ce qui était a priori difficile voire impossible, est posé comme possible dans une question à un individu.
On comprend aussi que «ruoc» puisse être massivement traduit par « capable de » ; d'autre part, on comprend aussi la description donnée par : Franklin E. Huffman :
«viC¢aexmrPasa /vicie -khemrak-phiesa:/ Modern spoken cambodian «, Yale University, New York, 1970, pp. 188-189Extraits :
3) * ruoc ‘to be able,to finish’ occurs in two contexts:
a.
physical capabilityknom leuk tok nih min ruoc tee. I can't lift this table.
La fonction temporelle de « ruoc » est ici induite par son association à la particule « haej ».
Exemple :
tae + C
0 + P + C(…) + ruoc + haej + rü nov ?(15) etIÉgelIktuenaHrYcehIyb¤enA ?
tae èng leuk tok nuh ruoc haej rii nov?
PART. tu soulever table ce PART. PART. PART. ?
Traduction littérale :
As-tu soulevé cette table ou pas encore ?
Traduction approximative possible :
As-tu déjà soulevé cette table ?
«Haej» est un mot polysémique qui renvoie en particulier au temps passé et que l'on peut parfois et approximativement traduire par «déjà». Cette traduction se réalise quand «haej» est précédé immédiatement par «ruoc».
L'assemblage des deux particules «haej» et «ruoc» porte sur le procès P en induisant une valeur temporelle.
Pour résumer, nous avons dans cet exemple où «ruoc» est utilisé en tant qu'adverbe le passage d'une contrainte ( le poids de la table) à une situation libre de contrainte (affirmation de capacité physique) dans une temporalité (de /haej/ (déjà)).
«Ruoc», particule polysémique, affirme et relève l'un des sens d'une autre particule polysémique (exemple précédent : «ruoc-haej»). Ce groupe des particules en interaction porte sur le procès P ainsi que sur le sujet (C
0).Dans les cas de composition de «ruoc» avec d’autres particules, différentes interactions se mettent en place. L’analyse linguistique supposerait une étude détaillée de chacune des particules en jeu.
Remarque
Pour être plus clair sur l’association de «ruoc» avec d’autres particules, il est nécessaire d’apporter un complément d’information.
«Ruoc» Peut être mis en interaction à d’autres particules dans une même phrase. Sa fonction se déterminera par rapport à sa place dans la phrase ainsi qu’à la place des autres particules.
Exemples
1. « ruoc et ba:n » : placés l’un à côté de l’autre formeront une conjonction de coordination.« ba:n ruoc » : placé après « ba:n », «ruoc» aura fonction de verbe et ba:n déterminera le passé et aura fonction d’auxiliaire.
2.
« ru2c eo tov » : dans ce cas ou « tov » est placé avant, il occupe la fonction de verbe et «ru2c» la fonction adverbe.Dans le cas où «ruoc» est placé avant « tov », les deux particules forment une conjonction de coordination
3.
« ruoc et mok » : mok placé avant «ruoc» est un verbe et «ruoc» est adverbe.«ruoc» placé avant mok : l’ensemble formera une conjonction de coordination.
4.
« ruoc et ha2j » : «ruoc» est placé avant « haoj ». Ce groupe de particule placé entre deux propositions aura fonction de conjonction de coordination. Ce groupe particule placé après le verbe d’une phrase aura fonction d’adverbe.« Haej ruoc » n’est pas possible.
Ces quatre exemples pourraient permettre à priori de formuler l’hypothèse que dans le cas où «ruoc» est associé à une autre particule, il aura fonction d’adverbe si la 2ème particule est placé avant et fonction de conjonction de coordination, si la 2ème particule est placée après. Pour confirmer cette hypothèse, il nous faudrait approfondir notre recherche.
Étudier le fonctionnement de «ruoc» dans la langue khmère contemporaine est une entreprise très ambitieuse. Nous n'avons pas l'ambition de prétendre à une analyse exhaustive. En effet, le fait que «ru2c» soit une particule polysémique qui possède la caractéristique de pouvoir s'utiliser en tant que verbe, groupe nominal, conjonction, adverbe, ouvre un champ de recherche très vaste qui nécessiterait certainement beaucoup plus de temps pour arriver à une étude qui pouvait considérer comme suffisante pour dégager toute la diversité des caractéristiques de son fonctionnement.
Ce que nous pouvons proposer comme constantes, malgré tout, semble ressortir de façon pertinente de notre analyse, et ceci, quel que soit le contexte.
«Ruoc» marque le passage d'une situation de contrainte à une autre situation libérée de cette contrainte : cette situation peut correspondre en particulier à un état de disponibilité, un état de référence ou final, un état de libération, ou encore un état de réussite.
«Ruoc» permet des raccourcis de langage (ex.: (6), (7), (8), (9), (10)).
«Ruoc» peut entrer en résonance avec d’autres particules dans des interaction dont l’étude reste à approfonfir (remarque pages 38-39).
|
ANTELME M. (1996), La réappropriation en khmer de mots empruntés par la langue siamoise au vieux khmer, Prince of Songkla Universiry, Bangkok |
|
CAMBEFORT G. (1950), Introduction au cambodgien, Les langues d’orient, G. P. Maisonneuve et Cie, Paris |
|
CHUON Nath., Dictionnaire Cambodgien, (unilingue) 2 volumes, 5e éd. (Tome I : 1967, Tome II : 1968), Institut bouddhique, p. 1089, Phnom Penh |
|
CULIOLI A. (1994), Pour une linguistique de l'énonciation, Ophrys. |
|
DANIEL A. (1985), Dictionnaire pratique Cambodgien-Français, Institut de l'Asie du Sud-Est, pp. 412-413, Paris |
|
DUBOIS J. et ali. (1994), Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, Paris |
|
FRANCKEL J.-J. (1989), Etude de quelques marqueurs aspectuels en français, Droz, Genève-Paris |
|
FRANCKEL J.-J. (1997), Approche de l'identité d'un préverbe à travers l'analyse des variations sémantiques : le cas de RE- en Français, in French Language Studies 7, pp. 47-68 |
|
FRANCKEL J.-J. et PAILLARD D. (1985), Bulletin de Linguistique Générale et Appliquée, n° 12, Université de Besançon. |
|
FRANCKEL J.-J. et VOGEL S. (Octobre 1996), Etudes de linguistique, in Cahiers d'études Franco-Cambodgiens, n° 7, CCCL, Phnom Penh |
|
FUCHS C. et VICTORRI B. (1996), La polysémie, Hermes. |
|
HUFFMAN F. (1970) viC¢aexmrPasa / vici¶-khemrak-phi¶sa: / Modern spoken cambodian, Cornell University Asia Program Ithaca, pp. 188-189, 266, New York |
|
KHIN S. (1993), Les marqueurs du temps et de l'aspect en cambodgien, INALCO, Paris |
|
KHING H-D. (1997), TidæPaBTUeTAénGkSrsaRsþExµr : Aperçu général sur la littérature khmère, Harmattan, Paris |
|
MALHERBE M. (1983), Les langues de l’Humanité, Seghers, Robert Laffont, Paris |
|
Ministère de l’Éducation nationale, Centre de rédaction de programmes et de manuels scolaires (1983), Grammaire de la classe de 7ème, pp.113-119, 123, 147-152, Phnom Penh |
|
POU S. et VOGEL S. (Janvier 1995), Introduction à l'étude du khmer, in Cahier d'études Franco-Cambodgien, n° 4, CCCL, Phnom Penh |
|
VOGEL S. (1995), Linguistique et Pédagogique, Université de Phnom Penh, Cambodge |
|
VOGEL S. (1996), Le préfixe verbal BAN- en khmer moderne, in Journal Asiatique, Tome 284, n° 1, pp. 213-262 |
Mémoires de recherche sur la linguistique
|
CHAN S. (1997), Etude du fonctionnement de Ba:n en khmer contemporain, Université Paris-X Nanterre, département des Sciences du Langage |
|
SAMBATH V. (1998), Etude du fonctionnement de Ka2t en khmer contemporain, Université Paris-X Nanterre, département des Sciences du Langage |
Romans
|
M. Pheakdey. (1993)*, RBHkMcay : preah kamcay, Phnom Penh |
|
NHOK Thaem. (1983)*, kulabéb+lin : kulab paylin (La rose de Païlin), éd. vb,Fm’ vappethoa (culture), Phnom Penh |
|
NOU Hac. (1960)*, páaRseBan : phka: sr1po:n (La fleur fanée), Phnom Penh |
|
SIN Dy et Soreyak Kunthak Bopha. (1971)*, écdnüvasna : Cayd1n-veah-sna: (Le hasard de destin), Phnom Penh |
Bibliographie complémentaire
Il s'agit d'ouvrages dont il est important de connaître l'existence, mais que nous n'avons pu consulter directement à l'occasion de la rédaction de ce mémoire.
|
AU CHHIENG, 1968, Etudes de philologie indo-khmer (V). A propos de la statue du 'roi lépreux, Journal Asiatique. |
|
AU CHHIENG, 1974, Etudes de philologie indo-khmer (VIII). Un récit ethnographique sur 'popil', Journal Asiatique, fasc. 1 et 2. |
|
AYMONIER Etienne, 1878, Dictionnaire khmêr-français, autographié par Son Diép, Saïgon. |
|
COEDES George, 1915,CR de Joseph GUESDON, Dictionnaire cambodgien-français, Fascicule premier - Paris, Plon-Nourrit, 1914; in 8°, BEFEO, XV, 4-13. |
|
GUESDON Joseph, 1930, Dictionnaire cambodgien-français, Plon-Nourrit, 2 vol., Paris |
|
HEADLEY Robert K. et al., 1977, Cambodian-English Dictonary, Washington, 2 vol. |
|
HUFFMAN E. Franklin et al., 1978, English-Khmer Dictionary, Yale University. |
|
JACOB M. Judith, 1974, A concise Cambodian-English Dictionary, London, Oxfoerd University Press. |
|
JENNER N. Philip (ed.), A Lexicon of Khmer Morphology, Mon-Khmer Studies, IX-X, 1980-1981. |
|
MOURA Jean, 1878, Vocabulaire français-cambogien et cambodgien- français, Challamel aîné, Paris |
|
PINNOW Heinz-Jürgen, 1979, Reflections on the historiy of the khmer phonemic system, Mon-Khmer Studies. |
|
PINNOW Heinz-Jürgen, 1979, Remarks on the structure of the khmer syllabe and wor, Mon-khmer Studies. |
|
POU Savros, 1979, Une description de la phrase en vieux-khmer, Mon-Khmer Studies. |
|
SACHER Ruth, 1978, Die inhärenten widersprüche in systen des khmer, Mon-Khmer Studies. |
|
TANDART S., 1938, Dictionnaire cambodgien-français, Albert Portail, Phnom Penh |
|
VARASARIN Uraisi, 1984, Les éléments khmers dans la formation de la langue siamoise, Selaf (Société d'études linguistiques et anthropologique de France), Paris |
|
VICKERY Michaël, 1982, L'inscription K. 1006 du Phnom Kulên, BEFEO. |
Thèses
|
JENNER Philip Norman, 1969, Affixation in Modern Khmer, Thèse. Ph. D., University of Hawaï, (dactylographiés) |
|
KHUON Skhamphu, 1968, Le système phonétique de la langue khmère, Thèse, Humbololt-Universitat Zu Berlin, (dactylographiés). |
|
MIDOUX Marcel, 1974, La dérivation en langue cambodgienne, Thèse, Université de Paris VII |
|
PRUM Male, 1975, Problèmes d'interférences sémiologiques entre le français et le cambodgien, Thèse de 3° cycle, Université de Haut Bretagne (sous la direction de J. Gagnepin), (polycopié). |
![]()
[1] Cf. les ouvrages : - MALHERBE M. (1983), Les langues de l’Humanité, Seghers, Robert Laffont, Paris
- CAMBEFORT G. (1950), Introduction au cambodgien, Les langues d’orient, G. P. Maisonneuve et Cie, Paris
[2] Ce terme peut avoir deux significations : l’une est la langue officielle du Cambodge et l’autre est le peuple.
[3] C0 : c’est le terme qui représente ici le sujet correspondant au sujet syntaxique.
[4] C1 : c’est le terme choisi qui représente ici le complément d’objet direct convoqué systématiquement par le procès P (ru2c). Chaque COD associé à ce procès peut être représenté par C1 différent.
[5] Un marqueur khmer est généralement polysémique. Mais dans notre travail, nous ne tiendrons compte que de son interprétation en tant que complément d’objet direct. Dans ce cas, ce marqueur peut être traduit approximativement en français : corps
[6] Cf. note 5.
[7] Cf. note 6.
[8] Voir le mémoire de D.E.A. de Monsieur CHAN Somnoble, Université Paris X, Département des Sciences du Langage (juin 1998)
[9] Cf. note 7.
[10] Une particule polysémique. En effet, selon le Dictionnaire pratique cambodgien-français de Monsieur Alain Daniel publié par l’Institut de l’Asie du Sud -Est en 1985, page 555, la traduction de cette particule est : 1. Et, et puis, ensuite, en outre. 2. Déjà, indication du passé.
[11] Idem. page 164, ce terme est une particule euphonique.
[12] Une particule de futur (n2h + Verbe). Exemple : ´ nwg sresr sMbuRtmYyc,ab; . /khnhom neung sor sé sâm bot muoj cbab/ (j’écrirai une lettre)
[13] Ce terme se trouve systématiquement associé à un procès "ru2c" dans une expression très particulière et courante où l’unité "ru2c" est mise en jeu. Dans ce cas, ce terme peut pendre une traduction approximative en français : main. Notons bien que, dans l’expression où ce terme est convoqué et associé à ce propos (ru2c), l’effet sémantique de ce terme est susceptible de renvoyer à toutes les activités concernant la (les) main (s) exprimé par des verbes : travailler avec les mains : écrire, taper à l’ordinateur, etc.
[14] Idem. Voir note 13.
[15] Une particule khmère qui est susceptible d’être un mot polysémique. Voir, Alain DANIEL, Dictionnaire pratique cambodgien-français, Institut de l’Asie du Sud-Est, 1985, p. 502.
[16] Idem. Voir note 13.
[17] Dans cet emploi, ce terme est susceptible d’être considéré comme une préposition
[18] C’est le terme choisi qui représente ici le complément d’objet indirect qui indique le type de contraint dont « ruoc » marque la levée.
[19] Il s’agit de la structure déjà commentée en II, A., p. 12
[20] Il s’agit de la forme déjà commentée en II, B. p. 24
[21] Il y a présence d’un complément direct entre « ruoc » et « pi: »
[22] Une particule polysémique. En effet, selon le Dictionnaire pratique cambodgien-français de Monsieur Alain Daniel publié par l’Institut de l’Asie du Su-Est en 1985, page 17, la traduction de cette particule est à savoir, alors, donc, ainsi.
[23] Idem. La traduction de cette particule est : 1. Bouchée, 2. Mot, classificateur pour des mots.
[24] Une particule qui est considérée comme polysémique. Dans cet emploi, ce terme mhk est susceptible d’être pris un sens de centrifuge et il peut être traduit approximativement en français : « viens : continue, (l’histoire) ! ».
[25] Voir le mémoire de maîtrise de Monsieur CHAN Samnoble, Etude du fonctionnement de Ba:n en khmer contemporain, Université Paris-X Nanterre, département des Sciences du langage, 1997.
[26] Voir le mémoire de maîtrise de Monsieur SAMBATH Vireak, Etude du fonctionnement de Ka2t en khmer contemporain, Université Paris-X Nanterre, département des Sciences du langage, 1998.
[27] Voir Franklin E. Huffman, viC¢aexmrPasa /vicie khemrak phiesa:/ Modern spoken cambodian, Yale University, New York, 1970, pp. 188-189
[28] « ta2: … », un terme considéré ici comme particule interrogative. Notons bien qu’en langue khmère soutenue, dans la phrase interrogative, il est toujours placé en tête de la phrase.
[29] « Rü te», une autre particule interrogative qui est susceptible d’être traduite approximativement en français « ou non » mais elle est toujours placée en position finale de la phrase interrogative.
* Il s'agit de la date de l'édition consultée, non pas celle la première édition qui n'est pas indiquée.
This site was last updated 05/16/04