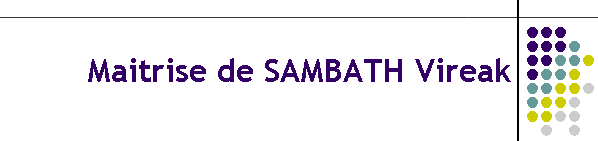
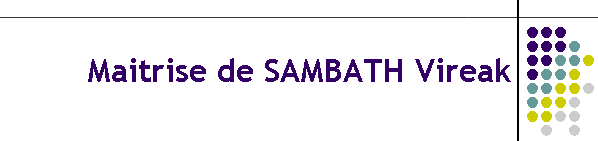 |
||
05/18/04 |
|
|
SAMBATH Vireak a le plaisir de vous présenter sur cette page son travail de Maîtrise.Célibataire endurci, SAMBATH Vireak est connu surtout pour ses habitudes nocturnes et son feeling auprès des vendeuses de "teuk krâlok". Son choix de vie intrigue encore sa famille et ses amis ! |
UNIVERSITE PARIS-X NANTERRE
DEPARTEMENT DES SCIENCES DU LANGAGE
ETUDE DU FONCTIONNEMENT DE
«ka¶t»
«
ekIt»EN KHMER CONTEMPORAIN
Mémoire de Maîtrise
présenté par
SAMBATH Vireak
Sous la direction de Monsieur le Professeur Année universitaire
Jean-Jacques FRANCKEL 1997 – 1998
ETUDE DU FONCTIONNEMENT DE
Kaet
EN KHMER CONTEMPORAIN
Remerciements
Je commence d'abord par remercier Monsieur le Professeur Jean-Jacques FRANCKEL qui m'a beaucoup aidé à travers ses conseils, ses remarques pertinentes sans lesquels mon travail n'aurait pas vu le jour. Je présente aussi ma gratitude envers mes collègues : CHAN Somnoble, SAM Auteur, Hamidou DJAE, Gaël EL BAHI, CHHIV Yiseang et particulièrement à Monsieur KHING Hoc Dy qui m'a donné des suggestions sur le corpus et des exemples auxquels je n'avais pas pensé et accepté de participer à mon jury de soutenance.
Et je tiens enfin à exprimer ma reconnaissance à Monsieur Sylvain VOGEL, Professeur de linguistique à l'Université Royale de Phnom Penh et attaché linguistique de l'Ambassade de France à Phnom Penh.
Sommaire
INTRODUCTION
I. « Ka¶t » EN TANT QU'UNITE LEXICALE
En cas de «ka¶t», verbe plein
A. « Ka¶t » dans une construction transitive :
B. «Ka¶t» dans la construction intransitive associée à certains verbes adjoints
II. « Ka¶t » EN TANT QU'UNITE GRAMMATICALE
A. «Ka¶t» en postposition verbale : ( P + Ka¶t )
1. «Ka¶t» dans un énoncé dont le sujet est une chose
2. «Ka¶t» dans un énoncé dont le sujet est humain
3. P + Négation + Ka¶t
B. «Ka¶t» en position postnominale. (N + Ka¶t)
1. « Ka¶t » associé à un sujet nominal humain et animalier
2. «Ka¶t» associé à un sujet nominal (chose)
C. «Ka¶t» en position antépréfixale /- ka: /
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Annexe
Le Khmer[1], langue nationale du Cambodge est une langue qui n'est pas vraiment isolée puisqu'il y a d'évidentes parentés avec d'autres langues de la péninsule indochinoise, dont la plus importante est le Mon du Sud de la Birmanie. On trouve également la présence des langues môn-khmères en Thaïlande, au Laos, au Viêt-Nam et dans les îles de Nicobar qui appartiennent actuellement à l'Inde.
La langue khmère est attestée par des écrits qui remontent au VIIème siècle. En ce qui concerne l'histoire, l'empire khmer a connu son apogée au XII è siècle, à l'époque d'Angkor. Le pays a toujours été soumis aux pressions thaïs et vietnamiennes. Ce qui a conduit à des interférences linguistiques entre les langues de ces trois pays. Nous constatons, en particulier que le vietnamien dispose d'un stock de vocabulaire ancien commun avec le khmer et que l'écriture thaï est dérivée de l'écriture khmère, elle-même d'origine indienne. En effet, le khmer a subi lui-même une forte influence du sanscrit puis, à partir de l'introduction du Bouddhisme «theravada» au XIV ème siècle, du pâli. Tout le vocabulaire culturel, intellectuel, religieux, administratif ou militaire est donc d'origine indienne. Regardons le nom même «Angkor» provenant de nagara qui signifie «ville» en indien. Mais, cela ne veut pas dire encore une fois que le vietnamien et le thaï ont une source commune avec le khmer et non plus que le khmer a totalement connu l'influence indienne. Mais le khmer a simplement emprunté au sanscrit et au pâli, qui appartiennent à l'Inde, pour compléter certains besoins de la langue khmère, existant déjà, qui manquaient dans certains domaines spécifiques comme la religion à titre d'exemple.
Du fait de cette influence indienne, le khmer est une langue qui est marquée par l'absence de ton par rapport aux autres langues asiatiques comme le thaï, le vietnamien, le laotien, le chinois qui sont toutes marquées par la polytonalité et qui nécessitent différents tons dans la prononciation en vue de mettre en œuvre leurs différents sens. Par exemple en thaï /ma (en français : venir) ; / mâ (en français : cheval) ; etc. Et d'ailleurs, à l'instar du khmer, on trouve dans divers domaines de la langue thaï des mots khmers transformés et prononcés à peu près analogues aux mots originaux (du khmer) et dont la seule tonalité se différencie à l'image de : RbCaCn /brhci¶cün/ en khmer /praktxa:txô:n/ en thaï qui signifie en français «peuple», neya)ay/ nojobaj en khmer /nojoba:j en thaï qui signifie en français « politique », etc.
En raison de cette caractéristique particulière, selon «LES LANGUES DE L'HUMANITE»[2], la langue khmère pose aux linguistes un problème de classement dans le cadre d'une parenté dans des groupes plus importants. Au niveau de la grammaire, le khmer a une structure phrastique variée qui entraîne des valeurs polysémiques en fonction de la position ou de l'ordre des éléments syntaxiques.
A propos du marqueur khmer, son rôle est variable selon la phrase dans laquelle il est employé, c'est à dire qu'il peut être, de manière traditionnelle un verbe, un adverbe ou un adjectif, etc. De plus, il dispose de plusieurs valeurs selon ses entourages et le contexte. En fait, le sens d'un terme entre de temps en temps en concurrence avec d'autres termes si bien que les nuances de ces termes lorsqu'ils sont employés dans la même phrase, même pour les Khmérophones, ils ont beaucoup de mal à mettre en évidence la nuance : c'est le cas des trois marqueurs «ba:n», «ru¶c» et «Ka¶t» par exemple. C'est dans cette optique que nous entamons nos recherches sur la valeur sémantique d'un de ces trois marqueurs (Ka¶t), afin d'établir un manuel grammatical de base pertinent et dans l'espoir que d'autres chercheurs (natifs) poursuivent cette piste jusqu'à ce que notre langue nationale, marquée par le souvenir d'un passé prestigieux, trouve la reconnaissance qu'elle mérite en Asie du sud-est.
Notre travail (de recherches) consiste à analyser les valeurs sémantiques de cette unité selon sa position et sa fonction grammaticale dans la phrase.
Signalons au préalable que cette étude de «Ka¶t» n'est que notre premier travail. Elle peut être incomplète en raison en particulier de la constitution du corpus. Nous l'avons majoritairement trouvé sa fonction de verbe dans des romans, journaux…etc. Nous remarquons à partir de cette fonction verbale que «Ka¶t» seul peut jouir d'un sens purement lexical selon les éléments qui l'entourent et qui ont une fonction grammaticale différente.
Partant de cette première fonction, nous avons constaté, en collaborant avec nos collègues[3] et avec les cambodgiens qui vivent à Paris, qu'outre la fonction verbale, «Ka¶t» peut jouer d'autres fonctions grammaticales.
Ainsi, notre travail est en gros divisé en deux parties : La première sera consacrée à «Ka¶t» en tant qu'unité lexicale (verbe). Le deuxième, nous étudions «Ka¶t» en tant qu'unité grammaticale.
Le terme «ka¶t» en tant que verbe plein s’emploie dans des contextes syntaxiques très différents et touche à plusieurs sens selon ses entourages. Lorsque «ka¶t» relève de la catégorie du verbe plein, il marque que le sujet devient le localisateur d’un terme sans qu’il ait un rôle d’agent actif dans cette localisation. Le sujet se trouve dans une attitude «passive» par rapport à cette localisation. Cela n’exclut nullement qu’il s’agisse d’un événement visé ou envisagé. Mais il n’est pas agent de l’actualisation de cette localisation.
Lorsqu'il est employé comme verbe plein, «Ka¶t» fonctionne avec une série des noms limités. Cette combinaison (Ka¶t + N) permet à «Ka¶t» d'avoir des sens très variables selon le nom avec lequel il se trouve.
Grammaticalement, cette série de noms joue le rôle d'un complément nominal direct du verbe «Ka¶t» qui entre alors dans une construction transitive. La série des noms qui fonctionne avec le verbe «Ka¶t» est :
- cumhü (maladie).
- ko:n (bébé).
- c¶:t (cœur) .
- tû:k (tristesse).
- ka: (intérêt).
- ka:i¶ :n (honte).
- ka:mont¶ l shhsaij (doutes).
- ka:pd¶h pdhl (plainte en justice).
Cette construction transitive incarnée par «Ka¶t» est donc réduite à une liste de termes limités. Nous allons aborder les principaux emplois représentatifs de «Ka¶t» en tant que verbe plein à partir de la construction transitive suivante :
1°/- X «Ka¶t» cumhü (X attraper la maladie).
X est le sujet du verbe « Ka¶t » et «cumhü» est le terme (complément direct) qui veut dire en français «maladie». « Ka¶t » marque que la localisation de «cumhü» par X relève d’un événement. Il ne s’agit pas de dire que X est malade mais bien qu’il soit tombé malade. Il s’agit d’un événement qui se produit d’une manière accidentelle, en liaison ici avec le sémantisme de « cumhü ». On a affaire à la survenue d’un événement.
2°/- X « Ka¶t » ko:n ( X accoucher d’un bébé ).
3°/- X «Ka¶t» c¶ :t[4] ® [ srh la:h ][5] ( X avoir un coup de foudre ).
® [ kh¶h ][6] ( X se mettre à être en colère ).
4°/- X «Ka¶t» tük ( X être triste ).
5°/- X «Ka¶t» k` ( X avoir l’intérêt ).
6°/- X «Ka¶t» ka:i¶ :n ( La honte embarrasser X ).
7°/- X «Ka¶t» ka:mont¶ l shhsaij ( X avoir des doutes).
8°/- X et Y «Ka¶t» ka:pd¶h pdh l ( déposer plainte en justice).
(1)
bþIÉgekItCMgWRKuncaj;./pdei èng kaet cum ngii krun canh/
/Mari-toi-ka¶t-maladie-malaria /
è Ton mari a attrapé la malaria.
En écoutant cet énoncé (1), on comprend que le mari qui était, auparavant en bonne santé est devenu à un moment donné le siège de la localisation de la maladie «malaria». «Ka¶t» marque que «la malaria» lui «tombe dessus», sans qu’il puisse intervenir : le mari n’attend ni ne souhaite la «malaria». « Ka¶t» ici marque le surgissement d’un état de la maladie «malaria» qui s’actualise sur le plan temporel de façon indépendante de toute agentivité.
Le terme «Ka¶t» dans cet énoncé (1) peut entrer en concurrence avec le terme «man / mi¶:n». Mais cela ne veut pas dire que ce terme soit toujours interchangeable comme le montre la comparaison de l'énoncé suivant :
(2)
bþIÉgmanCMgWRKuncaj;./pdei èng mean cum ngii krun canh/
/Mari-toi-avoir-maladie-malaria/
è Ton mari a la maladie de la malaria.
A travers cet énoncé, on comprend que le «mari» a déjà été contaminé par la «malaria» et que le locuteur fait une description de l’existence de la maladie après la contamination. Donc, «mi¶:n» dans cet énoncé marque simplement l’existence de la maladie qui se trouve déjà dans le corps du mari par rapport au moment de l’énonciation ( To ).
(3)
RbBnæ´ekIt ¬)an ¦kUnRbusmYyl¶acmSil./prâ pon khnhom kaet ban koon proh muoj lngeac msel/
/femme-moi-ka¶t-(obtenir)-enfant-masculin-un-hier soir/
è Ma femme a accouché d’un bébé (garçon) hier soir.
Dans cet énoncé (3), le locuteur asserte un événement : «ma femme» vient d'accoucher d'un bébé. Le terme « Ka¶t» marque que «la femme» est considérée comme le localisateur de l'événement par lequel le bébé, à un moment donné, survient. La naissance du «bébé» est certes prévisible et attendue, mais ce que marque «Ka¶t», c'est que la «femme» n'est pas maître du moment où cet événement s'actualise dans le temps.
La structure grammaticale permet de comprendre que le sujet (ma femme) est le support de l'action. Mais «Ka¶t» marque que l'actualisation de cette action (accouchement) est hors de son contrôle : il s'agit de l'accouchement qui survient.
«Ka¶t» dans cet énoncé a un double rôle : il marque d'une part la localisation du «bébé» à un moment donné par rapport à la «femme» : il s’agit de la naissance du bébé. Et d’autre part, il marque que la «femme» est considérée comme la localisation de cet événement qui donne naissance au bébé. La « femme » joue ici le rôle d'un agent actif par rapport au complément «Kôn / bébé». Mais, elle subit en quelque sorte l’événement de la naissance du bébé du fait que, du point de vue temporel cet événement surgit à un moment indéterminé, à son insu.
En ce qui concerne l'énoncé (3), il y a deux interprétations possibles :
(4)
RbBnæÉgekItGgáal; ?/prâ pon èng kaet âng kal/
/femme-toi-Ka¶t-quand./
è Quand est-ce que ta femme accouche ?
- Première interprétation :
Dans un contexte où un personnage (A) sait que la femme de B est enceinte et il veut savoir la date de l’accouchement de la femme de B, alors il lui demande : quand est-ce que ta femme accouche ? La réponse correspond bien à l'énoncé (3).
- Deuxième interprétation :
Dans un contexte où un personnage (A) cherche la femme de sa vie pour
se marier. Malheureusement, il ne l’a jamais trouvée, alors (B) lui demande :
quand est-ce que ta femme va naître ?
(5)
RKan;EteXIjnagPøam suxk¾ekItcitþRsT,aj;EPøt./kraon tè kheugn neang phleam sok kâ kaet cet srâ lanh phlèt/
/Au moment où-obtenir-voir-elle-immédiat-Sok-PART-ka¶t-cœur-aimer-immédiat/
è Au moment où Sok a vu la jeune fille , il eut le coup de foudre.
Le terme «Ka¶t» dans cet énoncé (5) s’emploie particulièrement dans le langage soutenu tel que : romans, poésies, fables, recueils des conseils khmers traditionnels…etc. Dans la langue parlée moderne, l’énoncé peut aussi s’employer sans «Ka¶t» à l’image de :
(6)
RKan;EteXIjnagPøam suxk¾mancitþRsT,aj;EPøt./kraon tè kheugn neang phleam sok kâ mean cet srâ lanh phlèt/
/Au moment où-obtenir-voir-elle-immédiat-Sok-PART-avoir-cœur-aimer. immédiat/
è Au moment où Sok a vu la jeune fille , il est tombé amoureux d’elle.
Si l’on analyse ces deux énoncés en fonction de la valeur aspectuelle, on se rend compte que l’énoncé (5) implique plutôt un surgissement de l’événement : «le coup de foudre» qui survient de façon inattendue et non prévisible. Cela correspond au sémantisme même de «coup de foudre». Tandis que l’énoncé (6) implique une description de l’état de Sok qui est dans la situation d’ « être amoureux d’elle ». On peut dire aussi que cet énoncé a la valeur d’un événement qui n’est lié qu’à la consécution : (l’amour n’a d'existence qu’après avoir vu la jeune fille). Remarquons que ces deux termes peuvent s'employer ensemble. Nous allons aborder plus tard la combinaison «Ka¶t-mi¶:n». «mi¶:n» ici n'a pas le rôle comme un nom mais comme un verbe adjoint (cf B, à la page 17).
(7)
sIufaekItTukçeRBaHEtsVamIunage)aHbg;ecal./si tha kaet tuk proh tè sva mei neang bâh bâng caol/
/PRENOM-Ka¶t-tristesse-PART-parce que-mais-mari-elle-abondonner-jeter/
è Sitha est triste car son mari l’a quittée.
Dans cet énoncé (7), «Ka¶t» marque que la tristesse correspond non pas à un état mais à un événement qui provient d’un fait dit externe : « son mari l’a quittée » qui s’est manifesté comme cause conduisant à l’actualisation de l’événement qui est « être triste».
(8)
´minnwksµanfaRbdab;buraN´ekItkaresaH./Khnhom men neuk sman tha prâ dab bo raan khnhom kaet ka sâh/
/Moi-NEG-imaginer-dire-appareil-ancien-moi-Ka¶t-NEG/
èJe n’imaginais pas que mon appareil génital se mette à fonctionner !
En écoutant cet énoncé, on comprend que le locuteur exprime sa surprise à propos d’un événement inattendu, non-prévisible (et en l’occurrence inespérée) : »son appareil génital fonctionne».
Ainsi «Ka:» ici est un nom qui suit le verbe « Ka¶t». Il désigne un avantage, un intérêt, une utilité, un profit et un résultat positif.
«Ka¶t-Ka:» dans cet énoncé forme un bloc qui implique le caractère bénéfique du fonctionnement retrouvé. « Ka¶t» marque une survenue d’un événement, qui s’actualise ici encore purement sur le plan temporel et cette actualisation intervient indépendamment du sujet.
La présence du terme « Ka: » qui suit le verbe «Ka¶t» est nécessaire pour que cet énoncé soit compréhensible et naturel. Rappelons que ce type d'énoncé formé de «Ka¶t-Ka:» est, d’après notre enquête, moins utilisé par notre génération. Cependant il est majoritairement exprimé par une certaine classe d’âge des Khmérophones, c’est à dire la génération de nos parents que nous, dit la nouvelle génération, n’avons même pas remarqué ou pensé à s’exprimer cet énoncé spécifique. Cela ne veut pas dire que cet énoncé soit maladroit ou ne soit pas acceptable, mais on en parle rarement.
(9)
sþab;karerobrab;rbs;GñkRKUEdlTak;Tgdl;GnaKtxøÜn nagk¾ekItkarxµas;eGon./sdab ka rieb roab ro bâh neak krou dèl teak torng dâl a na kot khluon neang kor kaet ka khmah ien/
/Ecouter. raconter. possessif. institutrice. PRON-REL. concerner. arriver.
avenir. corps. elle. PART. Ka¶t. honte/
è Ecouter l’institutrice raconter l’histoire concernant son avenir[7], la honte embarrasse la jeune fille.
En écoutant cet énoncé, on comprend que la jeune fille n’a honte qu’après avoir écouté raconter l’histoire qui concerne son avenir par l’institutrice. On peut dire d’une autre manière que l’événement de «avoir honte» provient de l’histoire qui a été racontée par l’institutrice et qui explicite que l’état de la «honte» a justement surgi comme un événement résultatif après le fait dit causatif de «raconter l’histoire» relative à son avenir. C’est ici que «Ka¶t» intervient et marque le passage de l’absence à la présence «la honte embarrasse la jeune fille». Ce passage a été actualisé au moment où l’institutrice racontait l’histoire concernant son avenir. C’est ici un facteur externe qui déclenche cette actualisation du procès : avant cette légende, ce procès «la honte embarrasse la jeune fille» était absent. Il s’agit d’une valeur inchoative du procès «la honte embarrasse la jeune fille», après la légende.
(10)
suxnigdara:eQøaHdeNþImpÞHKñarhUtdl;ekIt (man )karbþwgpþl;./
sok neung da ra chhuoh dân daem phteah khnea ro hot dâl kaet mean ka pdeung phdâl//Sok-et-Dara-disputer-se battre pour-maison-PRON.RECIP-jusqu'à ce que-arriver-Ka¶t-(avoir)-plainte en justice/
è Sok et Dara se battent pour une maison jusqu'à ce qu'ils déposent une plainte en justice.
A travers cet énoncé, on comprend que l'acte de «se battre» entre Sok et Dara est un effet original qui déclenche l'événement «déposer plainte en justice». C'est à ce moment-là que «Ka¶t» intervient pour marquer que le procès «déposer plainte en justice» s'actualise en fonction du facteur externe : «se battre pour une maison».
(11)
eBlenaHFavI manTwkmuxxusBIFmµtaEdlCaehtueFVIeGay kMeT,aHeyIg ekItkarmnÞilsgS½yPøammYyrMeBc/pél nuh thea vy mean teuk muk khoh pi thoam m da dèl cea hèt thveu aoj kâm lâh jeung kaet ka mun tiil sang sai phleam muoj rum pic/
/Temps-là-Theavy-avoir-eau-visage-faute-PREP-normal-PRON.REL-être-faire-donner-jeune homme-notre-Ka¶t-doutes-un-soudain/
è A ce moment-là, Theavy eût une expression bizarre sur son visage, ce qui fit avoir des doutes au jeune homme.
En écoutant cet énoncé, on comprend que la manière de se comporter «expression bizarre du visage» faite par Theavy déclenche le procès «avoir des doutes» par le jeune homme. Donc, «Ka¶t» marque le procès «avoir des doutes» s'actualise à partir du facteur externe «expression bizarre du visage».
Rappelons que le mécanisme de «Ka¶t», dans l'énoncé (10) et (11), fonctionne de la même manière que l'énoncé (9) c'est à dire «Ka¶t» marque, en résumé, que la construction du procès s'actualise en fonction des effets externes qui la déclenche.
Ce que nous appelons «verbe adjoint» ici, c’est un terme qui suit le verbe «Ka¶t» et qui a pour fonction de compléter le sens du verbe « Ka¶t », avec un sens précis mais variable selon les divers éléments de l'énoncé qui l’entourent. Les verbes adjoints qui peuvent suivre le verbe «Ka¶t» dans cette construction sont : «
ecj / cenh- sortir», «mk / mok - venir», «man / mean - avoir» «eLIg / laeng - monter », etc. La traduction que nous avons faite, ici n'est qu'une illustration qui peut être correcte lorsque ces verbes adjoints sont employés comme verbes pleins. Quand ce n'est pas le cas, ils peuvent être employés après le verbe «Ka¶t». Et dans cette construction où ils sont considérés comme les verbes adjoints, il n'est plus nécessaire qu'il y ait des compléments (directs ou indirects ® cf. I., A.). Mais nous tenons à signaler que ces quatre verbes adjoints n’ont pas pour fonction propre de modifier le verbe «Ka¶t». Et d’ailleurs, ils changent de rôle (ils deviennent des verbes pleins) lorsqu’ils se retrouvent seuls, sans que le verbe «Ka¶t» ou autres les précèdent.Voici quelques exemples d'emplois de «Ka¶t» avec ces verbes adjoints :
7°/- Y «Ka¶t» cenh ( verbe adjt ) pi ( prép) A et Z.
8°/- Y «Ka¶t» mok ( verbe adjt ) pi (prép) Z.
9°/- Y «Ka¶t» mean ( verbe adjt ).
10°/- Y «Ka¶t» laeng ( verbe adjt ).
11°/- Y «Ka¶t» ha¶j[8].
12°/- X thveu aoj «Ka¶t» c
ea Y. è Y «Ka¶t». (Voir l'énoncé 20)(12)
zan³nigCIvPaBekItecjBIKMnitnigsmtßPaBmnusS./t
ha nak neung ci veak pheap kat cenh pi kum niit neung sa ma tha pheap mnuh//statut social-et-vie quotidienne-Ka¶t-venir de-idée-et-capacité-personne/
è Un bon statut social et une agréable vie quotidienne proviennent de la volonté d’y parvenir et des capacités des personnes.
(13)
esckþIesakesAekItmkBItNða esckþIPitP½yekItmkBItNða ebImnusüral;rUb ecosputBItNðaenaH lTæplTaMgenaHnwgmkBINa./sa:ckdaijsh ksâv-Ka¶t-mhk-h mpi-thnaha:-sa:ckdaijph¶tph�j-Ka¶t-mhk-pi-th naha:-ba¶ -monûs-r¶lrou:b-ci¶:s-phôt-pi-thnaha:-nû-lâtpho¶l-ti¶h nû-n¶ h -mh k-pi:-na:/
/chagrin-Ka¶t-venir-PREP-convoitise-crainte-Ka¶t-venir-PREP-convoitise-si-personne-tout-éviter-PREP-convoitise-ce-résultat-tout-ce-MARQ-de TEMP- venir-PREP-où /
è La convoitise vient du chagrin et de la crainte. Si l’on n’est point tyrannisé par ses appétits, on n’a ni chagrin ni crainte.
Dans l'énoncé (12), «Ka¶t» a à voir avec ce que nous traduisons approximativement par le verbe «venir de» en français. La raison qui nous conduit à traduire ici «Ka¶t» par ce verbe, c’est que l’énoncé, en khmer donne l’idée de « volonté d’y parvenir » et de «capacités des personnes » qui sont conçues comme un point d’origine qui font que «bon statut social» et «agréable vie quotidienne» se manifestent. Autrement dit, avant de parvenir à ces deux qualités, la « volonté d’y parvenir » et les « capacités » des personnes sont exigés et prioritaires pour que un « bon statut social » et une « vie quotidienne » soient réalisables comme un événement effectif.
Dans cet énoncé (12 ), «
ecj / cenh » est un verbe adjoint du verbe «Ka¶t» qui désigne en français «partir de» (dans le sens d'avoir pour origine). Et «pi» est une préposition qui se place après le verbe adjoint «cê:Õ». Elle a une valeur comparable à celle de la préposition en français « de ».Ces trois termes «Ka¶t-cê:h-pi:» lorsqu’ils sont combinés, expriment l’origine de quelque chose qui a une valeur négative ou positive (peu importe la valeur) et qui donne une signification évoquée en français par une série des verbes telle que «provenir de, partir de, résulter de». Mais, quoi qu'il en soit, ces traductions ne sont pas à prendre en considération que relativement au commentaire que l'on peut en faire et aux gloses qu'elles permettent.
Au niveau des emplois, cet énoncé peut s’employer sans le verbe adjoint « cê:h » sans que pour l'instant, la différence de sens soit nette a priori.
Dans cet énoncé (12), le locuteur laisse entendre que la condition de vie suppose certaines exigences à partir desquelles on peut parvenir à ce stade social à savoir : un bon statut et à une agréable vie quotidienne satisfaisants et reconnus avec tous les avantages qui en résultent. Autrement dit, il implique que si ces conditions (la volonté d’y parvenir et les capacités) sont remplies, alors on aboutira à une actualisation effective de cette qualité et situation sociales en tant qu'un événement. Ce dernier est en quelque sorte parvenu à partir de ces conditions requises exprimées par «Ka¶t» qui permet de constituer la source de la réalisation du procès. Ce procès est en fait conçu comme conséquence, c'est à dire l'objectif envisagé ou souhaité.
Quant à l'énoncé (13), on comprend que «la convoitise» est considérée comme la source d'où sont nés le chagrin et la crainte. Ces sentiments en sont donc inhérents.
Précisons que l'énoncé (12) et (13) ont un sens différent dans la mesure où le (12) a le verbe adjoint «
ecj / cenh » qui marque un repère spatial de l'intérieur à l'extérieur. Et la préposition «Pi» qui marque la provenance de quelque chose. Quant au (13), il y a le verbe adjoint «mk / mok» qui marque une source de quelque chose. Et la préposition «Pi» marque la même valeur que celle de l'énoncé (12). Mais la valeur sémantique de «Ka¶t» reste toujours la même.Nous avons aussi le même type d'exemple que nous allons illustrer
ci-dessous. Au sujet de ces deux énoncés, nous avons fait une enquête en demandant aux cambodgiens qui vivent à Paris s'ils peuvent différencier le sens. Finalement, nous avons obtenu la même réponse : « identique ».
Pour nous, nous avons l'intuition qu'il y a une petite nuance, mais que nous avons beaucoup de mal à l'expliciter. Ces exemples sont :
(14)
pSitenHekItecjBIGacm_eKa./phset nih kaet cenh pi ac ko/
/Champignons-ce-Ka¶t-PREP-crotte de bœufs/
è Ces champignons sont formés de la crotte de bœufs.
(15)
pSitenHekItmkBIGacm_eKa./phset nih kaet mok pi ac ko/
/Champignons-ce-Ka¶t-venir-PREP-crotte de bœufs/
è Le lieu de naissance de ces champignons était la crotte de bœufs.
N-B : Les traductions (14) et (15) sont des essais pour que nos lecteurs non khmerophones saisissent la différence de sens des énoncés, grâce aux verbes adjoints. Si non la traduction serait identique : «Ces champignons sont nés de la crotte de bœuf».
(16)
Rbkarécdnüminl¥GacekItmankñúgmYyb:RBicEPñkdl;GñkRtUvvHkat;./prâ ka cai dân men laor ac kaet mean khnong muoj pâ pric phnèk dâl neak trov veah kat/
/hasard-NEG-bon-pouvoir-Ka¶t-avoir-dans-un clin d’œil-PREP-personne opérée/
è Le mauvais hasard peut arriver en une seconde à une personne opérée.
Le locuteur explique en prévenant que l’événement «le mauvais hasard»
peut se manifester à n’importe quel moment à une personne hospitalisée pendant son opération. Cet énoncé est une opinion exprimée par un locuteur qui exprime son inquiétude pour la personne hospitalisée qui va bientôt être opérée. En effet, en tant que chirurgien, celui-ci a la grande responsabilité de faire en sorte qu'il n'arrive rien à la personne opérée. Cela veut dire que le chirurgien peut intervenir pour que l’événement de « mauvais hasard » ne surgisse pas de façon accidentelle. Mais il ne peut pas tout maîtriser ou l’empêcher dans toutes les circonstances : (l’acte de la maîtrise «opérer le malade» du chirurgien peut lui échapper en une circonstance fortuite). C’est là où «Ka¶t» peut renvoyer à l'idée de déclenchement d'un événement : le «mauvais hasard» qui advient et que le chirurgien peut ne pas pouvoir éviter à un moment donné. Donc «Ka¶t» marque le passage d'absence à présence de «mauvais hasard» à un moment d'inattention du chirurgien ou au moment où le malade est dans un état critique. En résumé «le mauvais hasard» serait actualisé à un moment donné de façon contingente par rapport au malade dans le cas où le chirurgien ne maîtriserait pas tout à fait l’opération. «mi¶:n» est un verbe adjoint qui se place après le verbe «Ka¶t» pour marquer dans cet énoncé (16) que l’événement de «mauvais hasard» est devenu «réel» après l'advenue du phénomène de «mauvais hasard».
(17)
s®gÁamsIuvilekIteT,IgenAkm<úCa edaysarEtkardeNþImGMNacKña./shh kri¶ m-civi¶ l-Ka¶ t-la¶ h-nov-Kampuci¶ -daojsa:-tê-ka:-dânda¶ m-âmnac- kni¶ /
/Guerre-civil-Ka¶t-monter-PREP-Cambodge-à cause de-seulement-action de se battre-pouvoir-NEG-sans arrêt/
è La guerre civile se passe au Cambodge à cause du combat pour le pouvoir sans arrêt.
« la¶h » dans cet énoncé est un verbe adjoint qui désigne un état de chose lié à un événement (guerre) qui progresse d'un état stable à un état instable.
En écoutant cet énoncé, on comprend que le locuteur explicite le phénomène de corrélation entre l’acte de «combat pour le pouvoir» et un événement de la «guerre civile». Cela implique que s’il n’y avait pas d’acte de «combat pour le pouvoir», l’événement de la «guerre civile» ne surviendrait pas comme un événement réel par rapport au moment de l’énonciation (To). En effet, cela montre bien que deux phénomènes aient un lien correspondant de cause à effet : «l’acte de combat pour le pouvoir» effectué par les êtres humains déclenche un phénomène de la «guerre civile» que personne ne vise, ni ne souhaite. Le phénomène de «la guerre civile» n’est validé que par une manifestation de ce surgissement «combat pour le pouvoir». Donc, « Ka¶t » marque que l’actualisation du procès, «la guerre civile», n’a de contenu qualitatif dans le plan temporel qu’à travers l’acte de «combat pour le pouvoir».
Nous étudions aussi un autre énoncé supplémentaire avec le verbe adjoint « la¶h » :
(18)
eRKaHfñak;cracrN_d¾F¶n;F¶rmYy ekIteT,IgenAelImhavifIRBHmunIvgS./krousthnak-chrach-dh-thhu nthho-maoj-Ka¶ t-la¶h-nov-l¶ -mohavithaij.prea- monivonh/
/Accident-circulation-ADJ.QUA-grave-un-Ka¶t-monter-sur-boulevard-preah Monivong/
è Un grave accident s’est produit sur le Boulevard Preah Monivong.
«L’accident» est un phénomène qui s’est produit au Boulevard Preah Monivong. Un événement inattendu, non-prévisible qui s’est produit à un moment donné. C’est ici que «Ka¶t» intervient pour marquer que l'événement de «l’accident» est localisé à la fois par rapport au Boulevard Preah Monivong et par rapport aux deux véhicules.
Le terme d'accident marque qu'il s'agit ici d'un événement non attendu, non visé, mais comme nous l'avons vu dans d'autres exemples, «Ka¶t» est également compatible avec des événements envisagés et même souhaités. C'est ce que l'on peut observer dans le cas d'un exemple comme (18) :
(19)
XatkmµenHekIteT,IgedaymankareRKagTukCamun./khi¶ tkâm-nî-Ka¶ t-la¶ h -daoj-mi¶ n-ka:kruoh-tûk-ci¶ -mûn/
/Assassinat-ce-Ka¶t-monter-par-avoir-projet-conserver-avant/
è Cet assassinat s’est passé avec la complicité prévue.
Dans cet énoncé (19), on comprend que «l'assassinat» a eu lieu de manière préméditée. Mais ce que marque «Ka¶t», c'est l'actualisation de l'événement «assassinat» qui est localisé sur le plan temporel de façon indépendante de la victime. Celui-ci n'est qu'un support de la localisation de cet événement «assassinat».
(20)
kUn´ekItehIys¥atNas;./ko:n-khnom-Ka¶ t-ha¶ j-saa:t-nâs/
/Enfant-moi-Ka¶t-déjà-beau-très/
è Mon bébé est né et il est très mignon.
Dans cet énoncé, «Ka¶t» a un seul statut par rapport à l'énoncé (3). Il marque que l’événement de la « naissance de bébé » a été localisé à un moment donné par rapport à un repère qui est absent (mère). Même s’il n'est pas mentionné dans cet énoncé, on le connaît dès qu’on l’entend ou voit cet énoncé parce qu’il s’agit bien de la « naissance du bébé ». Signalons que, dans cet énoncé, on comprend que le locuteur met l'accent sur «la naissance du bébé» par rapport à «ma femme» (comme dans l'énoncé 3). Mais, du point de vue grammatical, «ma femme» joue le rôle d'un sujet qui fait l’action, tandis que «Ko:n» est un complément qui marque un élément indispensable pour que cet énoncé soit compréhensible. Etant donné que, dans cet énoncé particulier, la présence du complément «Ko:n» est nécessaire, il est bien clair que c’est la femme qui a accouché d’un bébé bien que l'actualisation de l'événement de naissance soit hors de son contrôle.
Si l’on parle du coté du bébé c’est celui-ci qui est né. Par contre si l’on parle du coté de la mère avec la présence du terme «ko:n» cela implique que c'est la mère qui donne la naissance au bébé. Cela veut dire en résumé qu’elle a accouché d’un bébé. On remarque que s’il n’y a pas le terme «ko:n», cet énoncé n’est pas compréhensible car celui-ci a besoin d’un complément.
On remarque, dans cette construction intransitive, que cet énoncé particulier ne nécessite aucune participation des verbes adjoints, mais il a besoin d'une préposition «enA / nov», équivalent ici à «à» en français, pour marquer un complément de lieu ou de temps dans la mesure où on veut se renseigner sur le lieu ou sur la date de la naissance du sujet du verbe (bébé).
(21)
briyakaseBlenaH manPaBeXareXA Bn;eBkNas; . mñak;²swgEteFøaymat; niyayfa dUcCamanevTmnþbisac cEmøkmkeFVIeGayekItCaxül;kYc kMNac EdlKµan GñkNasµandl;./bhriyakâs-pelnûk-mi¶n.phi¶p-khôkhov-punp�k-nâs-mneak-mneak-s¶h-tai-tlôy-maôt-niyi: ytha:-doci¶-mi¶n-vet¶môn-baijsa:c-chmlêk-mhk-tv¶-aoj-Ka¶ t-ci¶ -kjhl-kou:rc-kC mna:c-del-kmi¶ n-n� kna-sman-dhl/
/Temps-ce-avoir-cruauté-exessivement-très-chacun-prêsque-mais-échapper-bouche-parler-dire-sembler-être-avoir-magie-sorcier-bizarre-venir-faire-donner-Ka¶t-être-vent-tourbillonner-méchant-PRON.REL-NEG-personne-penser-arrivrer/
è A ce moment-là, il survint un événement cruel. Une tempête d'une violence qui dépassait l’imagination semblait avoir été déclenché par un maléfice. (extrait du roman « Coup d’épée de POGNAYATT page 39 » ).
La «tempête» est un événement inconnu, non prévisible, non visé, qui a surgi à un moment donné par rapport au moment où il n’y avait pas de «tempête». Donc, « Ka¶t » en soi marque que l’événement de «tempête» ne surgit qu’à la suite de la création de la «tempête» par le maléfice qui s’actualise sur le plan temporel. Donc, si l’on parle du côté du maléfice, celui-ci a créé ou a fait apparaître une «tempête» qui nous donne à comprendre qu'il s'agit d'un fait externe : des effets de la création par le maléfice qui déclenche l’événement de «tempête» exprimé par «Ka¶t».
HYPOTHESE :
«Ka¶t» marque l'actualisation d'un événement (que celui-ci soit envisagé ou non et qu'il soit considéré comme favorable ou défavorable ou non) dans le temps et dans les faits, indépendamment de tout paramètre subjectif. En effet, il peut en résulter en particulier des effets de surprise ou de réalisation aléatoire de quelque chose : le fait que quelque chose qui se produit ou ne se produit pas à tel ou tel moment n'est pas prévisible. «Ka¶t» peut aussi marquer qu'un procès s'actualise en fonction de facteurs externes à sa construction.
Si l’on adopte la terminologie traditionnelle, on peut dire que «Ka¶t» dans la construction P + Ka¶t joue un rôle d’adverbe parce que «Ka¶t» a une fonction précise sur le verbe qui le précède (correspondant à P) sur lequel il joue un rôle de «modificateur». En fait, dans ce cas, on constate que «Ka¶t» relève d’une ambivalence catégorielle dans la mesure où il va le plus souvent se traduire en français comme un verbe lorsqu’il est associé à la négation telle que : «
min>>>eT / men…té, Gt;>>>eT / ât…té, BM;u>>>eT / pum…té/ min>>>eT,Iy /men ... laej»D’après notre recherche dans les anciens documents Khmers surtout dans le «Dictionnaire Cambodgien de l’Institut Boudhique»
Bs2511[9] en 1967, 5 édition, rédigé par le roi des bonzes «CHOURN NATT»[10] et ses compagnons, «Ka¶t» n’est décrit qu’en tant que relevant des catégories du verbe et du nom. En tous cas, il ne s’agit que d’une étiquette qui ne permet pas l’assimilation pure et simple de tous les emplois à ce que l’on appelle traditionnellement « adverbe » dans une langue comme le français. Cette construction P + Ka¶t peut correspondre à des sens variés en fonction de l’ordre des éléments syntaxiques qui l’entourent.Nous allons nous intéresser à la séquence P + Ka¶t dans les questions et réponses.
Dans cette construction , « Ka¶t » marque l'effectivité du verbe qui le précède par le sujet (une chose) : consommable, praticable ou habitable. Dans ce cas, «Ka¶t» intervient dans une situation ou dans un contexte que l'énonciateur juge comme problématique.
Regardons les exemples suivants :
- N + V + Ka¶t
(22)
TwkenHpwkekItrWeT sux?/t¶ k-nî-ph¶ k-Ka¶ t-rü-te-Sok/
/ Eau-ce-boire-Ka¶t-ou-MOT-INTERR-Sok/
è Cette eau est buvable ou non, Sok ?
( 23)
TwkhñwggpwkekItvaKµanemeraKeT./t¶ k-n¶ h-ph¶ k-Ka¶ t-vi¶ -kmi¶ n-merok-te/
/eau-ce-boire-Ka¶t-lui-NEG-microbe-NEG/
è Eh, oui, c’est buvable puisqu'il n'y pas de microbes.
Dans cet énoncé (22), le locuteur pose cette question à Sok dans la mesure où il a des doutes sur l’état de «l’eau» : (cette eau est-elle bonne à boire ?) où (n’est-elle pas ?). Etant donné que «l’eau» est faite pour être bue, alors il est possible de la consommer. Mais il pose cette question du fait que la composition de « l’eau » lui semble de son propre point de vue impropre à la consommation. Il cherche par la question à mettre en garde contre les dangers que l’on pourrait courir en la buvant.
Soulignons qu’il s’agit d’une question d’un type bien particulier, puisqu’elle est posée avec un a priori : le locuteur pose la question sur le caractère potable ou non lorsqu’il la fonde, selon lui, sur le risque catastrophique qui la boirait. P n’est posé comme réalisable ou non réalisable qu’associé à l’idée de «danger». L’alternative P / P’ n’est posée que dans la mesure où pour le locuteur c’est P’ qui est le cas. Regardons P + Ka¶t sous forme de réponse affirmative, il signifie que «l’eau» est bue sans danger. Cette interprétation résulte du terme «Ka¶t» qui marque que P est non seulement actualisé où sélectionné mais que P’ n’est pas le cas : ( cette «eau» a été bue sans aucun risque possible).
Nous allons donner des exemples qui fonctionnent de la même façon que
l'énoncé (22) :
(24)
)ayhñwgsIuekItrWeT ?/Baj-n¶ h-si-Ka¶ t-rü-te/
/Riz-ce-manger-Ka¶t-ou-MOT.INTER /
è Est-ce que ce riz est mangeable ou non ?
(25)
)ayhñwgsuIminekIteT eRBaHvap¥ÚmehIy./Ba:j-n¶h -si-mi:n-Ka¶ t-te-pruos-vi¶ -ph om-ha¶ j/
/Riz-ce-manger-NEG-Ka¶t-NEG-parce que-lui-pourri-déjà/
è Non, ce riz n’est pas mangeable parce qu’il est pourri.
(26)
T,anm:akhñwgeRbIekItrWeTvuI KñalWsUreKfaGahñWgqab;xUcNas; ¡/la:n-ma:k-n¶ h -pra¶ -ka¶ t-rü-te-vei-kni¶ -lü-ke-tha-an¶ h -châb-khoc-nâs/
/Voiture-marque-ce-utiliser-ka¶t-MOT.INTER-PART-moi-entendre-
on-dire-celui.ci-vite-panne-très/
è Est-ce que cette marque de voiture est utilisable ou non ? – J’entends dire qu’elle est susceptible d’être en panne.
(27)
eRbIekItGt;GIeT RKan;EtfayUr²eTAvasuIsaMgbnþic./Pra¶ -Ka¶ t-ht-ei-te-kro¶ n-tai-tha-ju-ju-tov-vi¶ -si-sâh-bh ntec/
/Utiliser-Ka¶t-NEG-quoi-mais-dire-long-long-aller-lui-consommer-essence-passablement/
è Oui, elle est utilisable. Mais plus on l’utilise plus elle consomme de l’essence, ça c’est normal.
(28)
pÞHhñwgenAekItrWeT ?/phteas-n¶ h -nov-Ka¶ t-rü-te/
/maison-ce-vivre-Ka¶t-ou-MOT.INTER/
è Cette maison est habitable ou non ?
(29)
enAminekIteTeRBaHvaCitrlMehIy./Nov-min-Ka¶ t-te-pruos-vi¶ -cit-rolum-ha¶ j/
/Vivre-NEG-Ka¶t-NEG-parce que-lui-proche-s’écrouler/
è Non, ce n’est pas habitable parce qu’elle va bientôt s’écrouler.
Lorsque le sujet est une personne, «Ka¶t» marque l'actualisation du procès qui est réalisé par ce sujet même (personne).
Voyons précisement des exemples suivants :
- S (hum) + V + N + Ka¶t :
(30)
Gasux vapwkTwkekItrWeT ?/Asok-vi¶ -ph¶ k-t¶ k-Ka¶ t-rÜ-te/
/Asok-boire-eau-Ka¶t-MOT.INTERR/
è Sok , arrive-t-il à boire de l’eau ou non ?
(31)
vapwkekIt./Vi¶ -ph¶ k-Ka¶ t/
/Lui-boire-Ka¶t/
è Oui, il est arrivé à boire de l'eau.
Dans cet énoncé (30), le locuteur a un doute sur le fait de savoir si Sok peut «boire» de l’eau. La question ainsi posée avec «Ka¶t» implique que ,pour le locuteur l’ingestion de l’eau par Sok est Problématique. Donc, c’est la capacité physique de Sok à l’ingérer qui est problématique (par exemple parce qu’il est malade et trop faible pour boire).
«Ka¶t» dans la réponse marque donc que la réalisation du procès «boire» par Sok est sélectionné : ( Sok est arrivé à boire de «l’eau» à l’exclusion de P’).
En résumé, le morphème «Ka¶t» implique à la fois une idée d'un décalage tout en marquant une actualisation effective.
REMARQUE :
Dans le cas où le verbe «ph¶k / boire» serait remplacé par le verbe «le�b / avaler», cet énoncé serait moins naturel avec «Ka¶t», il fonctionnerait plutôt avec un autre marqueur «Ru¶c» qui est traité par notre collègue Monsieur SAM auteur.
(32)
sux ÉgpwkTwkenHekItrWeT ?/Sok.êh-ph¶ k-t¶ k.nî-Ka¶ t-te/
/Sok-toi-boire-eau-ce-Ka¶t-MOT.INTERR/
è Arrives- tu à boire cette eau ou non ?
(33)
GjpwkekIteTaHbITwWkhñWgRbePTs¥Ik¾eday./Ah -ph¶ k-Ka¶ t-tu¶ s-bei-t¶ k-n¶ h -prhphet-saaij-kh-daoj/
/Moi-boire-Ka¶t-magré-eau-ce-être-type-quoi/
è Oui, je suis arrivé à tout boire quelle que soit la qualité d’eau.
En écoutant cet énoncé, grâce à l’ajout du terme «
enH / nî», qui veut dire en français «ceci», après le nom «l’eau», on comprend que le locuteur et Sok savent déjà que la composition de «l’eau» est problématique par exemple : l’eau est trop chaude, trop amère,…etc. C’est pourquoi la question ici posée par le locuteur n’est pas pour mettre en garde contre les dangers liés à la composition de «l’eau» propre ou non que l’on court à la boire comme l’énoncé (22), mais elle est posée pour savoir si Sok arrive à boire cette sorte d' «eau». Il ne s'agit pas de la capacité physique de Sok à ingérer l'eau comme l’énoncé (30).En fait, il s’agit d’un pari entre le locuteur et Sok qui attendent patiemment le résultat final. Vu que «l’eau» est très chaude ou trop amère, le locuteur pose l'ingestion de l'eau comme «impossible / irréalisable». La réponse de P + Ka¶t marque que Sok est arrivé à boire de l’eau malgré le risque de brûlure (parce que l’eau est trop chaude) ou le dégoût (parce que l’eau est trop amère). «Ka¶t» marque en effet que P est actualisé / réalisable. Tandis que P’ n’est pas le cas.
(34)
etIÉgeronmuxviCöaPasaviTüaekItrWeT ?/Ta¶ -êh -ri¶ n-mükvici¶ -phi¶ sa-vitji¶ -Ka¶ t.rü-te-Sok/
/MOT.INTERR-toi-étudier-matière-linguistique-Ka¶t-MOT-INTER/
è Est-ce que tu te figures pouvoir étudier la linguistique ?
(35)
)aT ! ´eronekIt ehIy´)anTTYlsBaØab½RtGnubNÞitmYyeTot./ba:t-khnom-ri¶ n-Ka¶t.ha¶ j.khnom-ba:n-totuol-sahnabât-âknû-bhd¶ t-maoj-ti¶t/
/Oui-moi-étudier-Ka¶t-et-moi-obtenir-recevoir-diplôme-maîtrise-un-encore/
è Oui, je suis arrivé à l’étudier et j’ai obtenu mon diplôme de maîtrise.
Dans cet énoncé, le locuteur pose la question à Sok pour se renseigner sur son aptitude en matière de «linguistique». En outre, celui qui pose la question a l'idée que «étudier» est problématique compte tenu du niveau de linguistique qu'il pense Sok. « Ka¶t » agit sur le procès sous forme d’une réponse qui marque que le procès «étudier» est entré dans l’accès d’une réalisation atteinte de telle sorte que Sok obtienne le résultat bénéfique, satisfaisant : il continue à étudier avec succès, ce qui dément l’idée du locuteur selon laquelle cela était exclu, et en démontrant que le processus de « étudier » avance de façon progressive. Donc, P est sélectionné par rapport à P’ qui est exclu.
(36)
etIÉgelIktueGayEm:ekItrWeT ?/Ta¶ -êh -l¶ k-tôk-nî-aoj-mê-Ka¶ t-rü-te/
/MOT.INTERR-toi-soulever-table-ce-donner-mère-Ka¶t-MOT.INTER/
è Arrives-tu à m’apporter cette table où non ?
(37)
)aT ! ´elIkvaekIt./Ba:t-khnom-l¶ k-vi¶ -Ka¶ t/
/oui.moi.souleve.Ka¶t/
è Oui, je suis arrivé à l’apporter.
L’emploi de terme «Ka¶t» dans cet énoncé (36), par comparaison à d’autres termes tels que «ba:n» et surtout «ru¶c», correspond à un contexte particulier.
Nous précisons que la traduction en français ci-dessus pourrait être la même avec le terme «ru¶c», ce qui pourrait engendrer une confusion sur l’emploi de ces deux termes «Ka¶t» et «ru¶c». Il n’en demeure pas moins que le fonctionnement de «Ka¶t» est très différent de celui de «ru¶c».
CONTEXTE :
Sok a mal aux mains. Sa mère est en train de faire la cuisine. Et elle a besoin d’une table pour mettre les plats et veut lui demander de lui apporter la table mais elle n’est pas sûre que Sok arrive à la soulever du fait qu’il a mal aux mains. Pour éclaircir cette hésitation, elle pose la question : arrives-tu à m’apporter cette table ou non ?
Etant donné que Sok a mal aux mains le locuteur tient compte du fait que «apporter la table» est posé relativement à son point de vue comme « impossible et irréalisable» : Sok n’arrive pas à apporter la table parce qu’il a mal aux mains. «Ka¶t» dans l'énoncé sous forme de réponse marque que la construction du procès «apporter la table» se réalise de façon effective malgré la contrainte posée : Sok a mal aux mains mais il est arrivé quand même à apporter la table.
(38)
etIÉgelIkFugTwkekþAeTAdak;elItuekItrWeT ?/Ta¶ -êh -l¶ k-thûh -t¶ k-kdav-tov-dâk-l¶ -tôk-Ka¶ t-rü-te/
/MOT.INTER-toi-soulever-sceau-eau-chaud-aller-mettre-sur-table-Ka¶t-MOT.INTER/
è Arrives-tu à apporter le sceau d’eau chaude pour mettre sur la table ou non ?
(39)
´elIkFugTwkekþAhñwgekItGt;manbBaðaGIeT./Khnom-l¶ k-thûh-t¶ k-kdâv-n¶ h-Ka¶ t-ht-mi¶ n-pahaha-ei-te/
/Moi-soulever-sceau-eau-chaud-ce-Ka¶t-NEG-avoir-problème-quoi-NEG/
è Je suis arrivé à l’apporter sans problème.
Cet énoncé (38) a le même fonctionnement (32) et (36). Etant donné que l’eau est chaude, le locuteur pose la question en tenant compte du risque de brûlure.
(40)
´elIkekItédQWb:uNÑwgGt;GIeT./Khnom-l¶ k-Ka¶ t-daij-cü-p¶ nn¶ h-ht-ei-te/
/Moi-soulever-Ka¶t-mains-mal-comme cela-NEG-quoi-NEG/
è Oui, je suis arrivé à te l’apporter bien que j’ai mal aux mains.
Nous allons étudier aussi des énoncés combinés avec la négation et avec des co-textes argumentatifs qui fournissent une évaluation sur l'actualisation du procès par rapport à P + Ka¶t dans des réponses (affirmatives) pour examiner les constructions très diverses de «Ka¶t» dans lesquelles il se caractérise différemment par rapport au chapitre II-1 ( type de négation répondant à une question ). Cette démarche consiste avant tout à analyser le fonctionnement de «Ka¶t» dans tous les énoncés qui sont conformes à chaque catégorie d'acte de paroles exprimé par le locuteur, c'est à dire : la surprise, la patience, la colère, etc. (Ka¶t, dans ce chapitre n'est plus lié à l'esprit de P' posé par le locuteur dans une question).
(41)
«Buksmøab;kUn minGaceTACaGBa©wgekIteT ¡/Ovpouk-shmlab-ko:n-m¶ n-ac-tov-ci¶ -hhc¶ h-Ka¶ t-te/
/Père-tuer-enfant-NEG-pouvoir-devenir-aller-être-comme ça-Ka¶t-NEG/
è Le père a tué son fils ! cela n’est pas vrai !
Le locuteur exprime que l’événement «tuer le fils», est de son point de vue un événement impossible / irréalisable c’est à dire qu’il n’arrive pas à y croire. Mais en réalité l’action de « tuer le fils » faite par le père a été réalisée. Alors cette action réalisée est devenue un événement effectif qui s’est opéré à un moment donné par rapport au moment de l’énonciation (To). «Ka¶t» marque que le procès «tuer le fils» a fait l'objet d'une réalisation effective malgré une contrainte : (par exemple ici l’action faite par le père est inhumain…).
(42)
rkEtxWg ¬k¾xWg¦ nwgvaminekIt ebIvaCamnusüqáÜtGBa©wg./Rok-tê-kh¶h-(kâ-kh¶h)n¶h-vi¶ -m¶ n-Ka¶ t-ba¶ -vi¶ -ci¶ -monûs-ckout-hhc¶h/
/Chercher-mais-colère-(PART-colère) avec-lui-NEG-Ka¶t-si-il-être-personne-fou-comme ça/
è Comment se fait-il que je me fàche avec lui puisqu’il est fou comme ça !
Dans cet énoncé, le locuteur exprime son manque de patience et sa colère à l’égard d’un personnage qui s’est révélé être fou. L’état de «folie» du personnage concerné est pris en compte par le locuteur : (on ne peut pas se fâcher avec quelqu’un qui est atteint de la folie). Alors, le locuteur relève que le fait de «se fâcher» est considéré, selon son point de vue comme «impossible / irréalisable» (parce qu’il est atteint de folie).
De plus, s’il se fâchait avec «le fou», il appartiendrait lui-même à la classe des fous puisqu’il se fâcherait avec un fou. Alors le fait de «se fâcher» avec un fou est exclu de sa tête : «se fâcher avec un fou» est, pour lui considéré comme «impossible / irréalisable». Donc, Nég + Ka¶t agit sur le procès « se fâcher » qui est considéré par le locuteur comme «impossible / irréalisable».
«Ka¶t» (en dehors de la négation) marque que le procès «se fâcher» s'actualise en tant qu'un événement effectif : il se fâche avec un fou bien que cet acte soit injuste.
(43)
rkEteFVIGIk_eFVIminekItEdr ebIBYkÉgecHEtmkrMxanGjGBa©Wg !/Rok-tê.tv¶-aij.kâ-tv¶-m¶n-Ka¶t-dê-ba¶-pu¶ k-êh-cê.tê.mhk.rumkhan.ah-hhc¶h/
/Chercher-mais-faire-quoi-PART-faire-NEG-Ka¶t-aussi-si-groupe-toi-savoir-mais-venir-gêner-moi-comme ça/
è Mes enfants ! A chaque fois que je travaille, vous me gênez. Je n’arrive pas à travailler !
En écoutant cet énoncé, on comprend que le locuteur exprime son mécontentement à l’égard de ses enfants qui le gênent au moment où il travaille. L’acte de «travailler» qui est perturbé par les enfants est, pour le locuteur considéré comme «impossible / irréalisable» ainsi que l'exprime Nég + Ka¶t : le moment de «gêner» par les enfants est considéré comme un empêchement pour arriver à travailler. «Ka¶t» en dehors de la négation marque la réalisation du procès «travailler» en tant que «effectif». (malgré des contraintes : dérangement, empêchement…).
Au niveau de l'aspect verbal, remarquons que la réalisation effective du procès dépend en quelque sorte du sujet humain qui la détermine.
Par exemple dans un contexte où la musique dérange A , celui-ci dit à B :
A:
GjeronminekIteTedaysarEtmanePøgrMxan ¡/ah-ri¶:n-m¶ n-Ka¶ t-te-daojsa-tê-mi¶:n-pleh-rumkha:n/
/Moi-étudier-NEG-Ka¶t-NEG-à cause de-mais-avoir-musique-gêner/
- Je n'arrive pas à étudier à cause de la musique.
Quant à B lui répond :
B:
cMENkGjvijeronekIt/chmnêk-ah-veih-ri¶:n-Ka¶t/
/Quant à moi-PART-étudier-Ka¶t/
è Moi, si, malgré la musique.
(44)
kUn´sresrsMbuRtminekIteTeRBaHvaminecHGkSr./Ko:n-khnom-shse-shmbôt-m¶ n-Ka¶ t-te-prous-vi¶ -m¶ n-cê-âksh/
/Enfant-moi-écrire-lettre-NEG-Ka¶t-NEG-parce que-lui-NEG-savoir-lettres/
è Mon enfant ne peut pas écrire des lettres parce qu’il ne sait ni lire ni écrire.
Le locuteur explique que l’acte d’ « écrire des lettres» ne peut pas se réaliser par son enfant parce que il est illettré : (il ne sait ni lire ni écrire). «Ka¶t» en soi marque que la construction du procès « écrire des lettres » débouche sur une réalisation satisfaisante. Autrement dit l’acquisition de l'aptitude à rédiger est devenue en une réalité inhérente et effective : il sait lire, écrire. Cela implique que la réalisation du procès P est sélectionnée et actualisée par rapport à P’.
(45)
kUn´vasresrsMbuRtminekIteT EtebIkMNaBüvasresrekIt./Ko:n-khnom-vi¶ -shse-shmbôt-m¶n-Ka¶t-te-tê-ba¶ -khmnap-vi¶ -shse-Ka¶ t/
/enfant-moi-il-écrire-lettres-NEG-Ka¶t-NEG-mais-si-poèmes-il-écrire-Ka¶t/
è Mon enfant ne peut pas écrire des lettres mais il peut écrire des poèmes.
Le locuteur démontre que son enfant est cette fois-ci scolarisé. Il a une certaine aptitude dans certains domaines et il n’en a pas vraiment ou du tout pour d’autres. Le locuteur nous fait comprendre que «l'aptitude» de son enfant concernant les affaires des lettres n’est pas satisfaisantes pour pouvoir réaliser le procès «écrire des lettres». Il écrit des lettres mais le contenu et la forme ne sont pas bons : il écrit mal parce qu’il ne connaît pas les formules exactes. Donc, le locuteur conclut que le procès «écrire des lettres» est considéré comme quelque chose d’impossible, d’irréalisable pour lui. Au contraire, il affirme que son enfant a effectivement l’aptitude de réaliser le procès «écrire des poèmes» par rapport à la non réalisation du procès «écrire des lettres». En effet «Ka¶t» marque une réalisation effective du procès «écrire des poèmes» de telle façon que cette réalisation est sélectionnée par rapport à P’.
(46)
sgSar´erobkar ( ecal´eTAehIy ) ! minGackøayeTACaGBa©WgeTAekIteT !/Shhsa-khnom-ri¶ bka:-(co¶ l-khnom-tov-ha¶ j)-m¶ n-ac-klaj-tov-ci¶-hh c¶h-tov-Ka¶ t-te/
/Petite amie-moi-se marier-(laisser-moi-aller-déjà)-NEG-pouvoir-devenir-
aller-être-comme ça-aller-Ka¶t-NEG/
è Ma petite amie s’est déjà mariée ! ce n’est pas vrai !
(47)
sgüar´erobkaréf¶Es¥k ! minekIteT´eTACYbnagsin./ Shh sa-khnom-ri¶ bka:-th naij-saêk-m¶ n-Ka¶ t-te-khnom-tov-coub.ni¶ h-s¶ n/
/Petite amie-moi-se marier-(jour-demain)-NEG-Ka¶t-NEG-moi-aller-rencontrer-elle-PART/
è Ma petite amie va se marier (demain) ! ça ne va pas si je ne vais pas la voir.
Dans l’énoncé (46), le locuteur exprime sa surprise et son incrédulité à propos du fait du mariage de sa petite amie qui s’est déjà passé. Etant donné que le fait du mariage était avéré, alors selon son point de vue, il relève que le procès du «mariage de sa petite amie» était considéré comme « impossible / irréalisable ». Tandis que l’énoncé (47), le locuteur exprime également sa surprise sur le fait du «mariage de sa petite amie» qui va bientôt avoir lieu. Mais ici, il exprime sa crédulité sur ce fait. Alors il relève que ce mariage est considéré comme un fait auquel il n'adhère pas. Il met en rapport entre le fait du «mariage de sa petite amie» et l’existence actuelle de sa relation amoureuse. Il est certain que sa petite amie va se marier mais pour le locuteur, il a besoin d’une part qu’elle éclaire la raison pour laquelle elle va se marier avec une personne autre que lui et d’autre part il a besoin qu’elle arrange sa relation amoureuse avec lui. Nég + Ka¶t agit sur l’activité «va voir» la petite amie que le locuteur considère comme «impossible» de ne pas aller c’est à dire qu’il lui est possible et nécessaire d’aller la voir pour régler le problème qui concerne son mariage.
Dans l’énoncé (46) et (47), « Ka¶t » (hors de la négation) marque que la réalisation du procès «se marier» et «va voir» sont sélectionnés comme un événement effectif par rapport à la non réalisation du procès P’.
HYPOTHESE :
«Ka¶t» marque l'actualisation d'une propriété ou d'un procès P en tant qu'elle est exclusive de sa non-actualisation.
En général, en Khmer un énoncé affirmatif avec le morphème «Ka¶t» (N+Ka¶t) ne peut s'employer qu'avec un énoncé négatif (N+Nég+Ka¶t) convoqué par ce type de construction même (N+Ka¶t).
On remarque que cet énoncé négatif (N+Nég+Ka¶t) qui va souvent avec l'énoncé affirmatif (N+Ka¶t) permet de mettre en relief et de justifier la valeur effective exprimée dans l'énoncé affirmatif. Par contre, la construction de l'énoncé négatif avec le morphème «Ka¶t» (N+Nég+Ka¶t) est grammaticalement possible sans qu'il y ait recours à un autre énoncé. Ce qui étaye l'hypothèse de la valeur d'exclusion liée à «Ka¶t». De plus, il est important de souligner que dans cette construction énonciative en Khmer, on n'utilise pas un verbe. Cependant, en français on introduit, pour traduire, surtout le verbe «être». Ce qui fait que «Ka¶t» fonctionne, selon la terminologie traditionnelle comme un adjectif. La raison pour laquelle nous appelons «adjectif», c’est que «Ka¶t» suit le nom qui le précède et a une fonction précise sur ce nom correspondant à une propriété (chose, animal, esprit, personne) en tant que «qualificatif». De toute façon, notre affirmation n’est qu’une explication que l'on peut observer d'une autre façade aspectuelle. Mais elle ne fournit pas toutes les caractéristiques systématiques de l’adjectif.
«Ka¶t» employé dans les énoncés dont le sujet correspond à un esprit, à une partie du corps, à des animaux marque les modèles d’une perfection absolue qui répondent aux exigences intellectuelles, morales, physiques d’un individu ou d’un animal. Ces qualités peuvent être divisées en deux catégories : l’une est de l’ordre de l’intelligence, de l’esprit, du comportement, de l’attitude, du caractère, de l’allure, de la conduite et l’autre est de l’ordre de la capacité physique.
(48)
bgÉgcMCamnusSminekItEmn !/Bhh-êhchm-ci¶-monûs-m¶ n-Ka¶ t-m� n/
/Toi-exact-être-personne-NEG-Ka¶t-vrai/
Cet énoncé est exprimé de façon ambiguë même pour les khmerophones : s’ils ne connaissent pas les contextes auxquels renvoie cet énoncé, ils n’arrivent pas à comprendre de quoi il s’agit. En effet, cet énoncé est susceptible d’avoir trois interprétations possibles qui sont :
- Première interprétation
Dans un contexte où Nary est la femme de Sok qui a un comportement indifférent à tout : il ne cherche pas à nourrir sa famille. Parfois il travaille mais négligemment. Finalement, il ne gagne pas sa vie. Alors, Nary lui dit en mettant l’accent sur l’esprit de son mari (Sok) :
(49)
mkEtBIKMnitbgÉgminekIt ! ebIKMnitekItrksIumandUceKÉg)at;eTAehIy !/Mhk-tê-pi-Kumn¶ t-bhh-êh-m¶n-Ka¶ t-ba¶ -kumn¶ t-Ka¶ t-rok-si-mi¶ n-doc-ke-êh-bât-tov-ha¶ j/
/Venir-mais-PREP-idée-toi-NEG-Ka¶t-si-idée-Ka¶t-chercher-manger-riche-comme-on-toi-perdre-aller-déjà/
è Ton esprit n’est pas fructueux. Si c’était le contraire, tu gagnerais bien ta vie comme les autres.
- Deuxième interprétation :
Dans un contexte où Nary s’est mariée avec Sok depuis très longtemps. Et elle rêve d’avoir un bébé. Malheureusement, son rêve n’est pas réalisé. Alors, elle lui dit cette fois-ci en mettant l’accent sur la capacité physique de son mari (Sok) : (50)
mkEtBIbgÉgminekIthñwgNa+)anCa´Gt;mankUnebIminGBa©wgeTem:øHsm´mankUneRbInwgeK eTAehIy !/Mok-tê-pi-bhh-êh-m¶ n-Ka¶ t-n¶ h-na:-ba:n-ci¶-khnom-ht-mi¶ n-kôn-ba¶ -m¶n-hh c¶h-te-mlê-shm-khnom-mi¶ n-kôn-pra¶ -n¶ h-ke-tov-ha¶ j/
/Venir-mais-PREP-toi-NEG-Ka¶t-commeça-PART-obtenir-être-moi-NEG-avoir-enfant-si-NEG-alors-NEG-ainsi-conforme-moi-avoir-enfant-utiliser-avec-on
è C’est à cause de ton sperme qui n’est pas fertile, c’est pourquoi je n’ai pas de bébé comme les autres !
- troisième interprétation :
Nary s'est mariée avec Sok. Après la lune de miel, elle s'est aperçue que Sok est homme impuissant. Ravy, sa copine lui demande :
«Après le mariage, ça va ?»
- Nary lui répond : bIþ´Gt;;;;ekIteT
pdei-khnhom ât ka¶t té
Mon mari est impuissant.
N.B. : On remarque, dans la culture Khmère, les femmes sont gênées pour parler ouvertement de sexe. Comme dans l'énoncé Khmer (troisième interprétation ), il n'y a aucun mot qui apparaît dans la phrase pour le désigner. Grâce au contexte donné, cet énoncé est interprété ainsi.
(51) yI ! EqáenHGt;ekItEmn ! eGayvacaMpÞHvaEbrCakekrEs,keCIgexÞc !
/Ji-ckê-nî-ht-Ka¶ t-m� n-aoj-vi¶ -câm-phtea-vi¶ -bê-ci¶ -kh ke-sbêk-c¶ h -kteîc/
/MOT-EXCL-chien-ce-NEG-Ka¶t-vrai-donner-lui-attendre-maison-lui-tourner-être-ronger-chaussures-débris/
è Putain ! ce chien est nuisible. Je lui ordonne de garder la maison. Au contraire, il a rongé tous les chaussures !
(52) kUn´GabgeKhñwgminekItEtmþg ! caj;Gab¥ÚneBAvaGaenaHcMNab;Nas; !
/Kôn-khnom-a[12]-bhh-ke-n¶h-m¶ n-Ka¶ t-tê-mdhh-câh-a-paonn-poav-vi¶-a-nûk-comâb-nâs/
/Enfant-moi-grand frère-on-ce-NEG-Ka¶t-mais-PART-perdre-petit frère-cadet-il-celui.la-excellent-très/
è Mon fils aîné n'est pas doué. Tandis que son frère cadet est admirable !
(53) naghñwgminekIteT !RsIkeBa©IFøúHGBa©wg GñkNaykeFVIRbBnæc,as;CarlayehIy.
/Ni¶h-n¶h-m¶ n-Ka¶ t-te-sraij-kahc¶-tlû-hhc¶h-n�kna-jok-tv¶-prhpûn-cbâs-ci¶ -roli¶ j-ha¶ j/
/Elle-ce-NEG-Ka¶t-NEG-fille-négligent-comme ça-qui-prendre-faire-femme-sûr-être-se dissoudre-déjà/
è Cette fille n'est pas avantageuse ! C'est une fille gaspilleuse. Si un homme se marie avec elle, il sera ruiné.
«Ka¶t» employé dans les énoncés dont le sujet est une chose marque la possession de toutes les qualités ou souhaitables : le contenu et l'état caractéristique.
(54)T,anenHGt;ekIteT!ebIT,anhñwgekIteKeRbIRKb;KñaeTAehIy edaysarvaqab;xUceBk.
/Lan-nî-ht-Ka¶ t-te-ba¶-la:n-n¶h-Ka¶ t-ke-pra¶-krûb-kni¶-tov-ha¶j-daoj-sa-vi¶-châb-khoc-pek/
/Voiture-ce-NEG-Ka¶t-NEG-si-voiture-ce-Ka¶t-on-utiliser-tout le monde-aller-ha¶j-à cause de-vite-panne-trop/
è Ce type de voiture n'est pas fiable. Si c'était le contraire, tout le monde l'utiliserait puisqu'elle n'est pas susceptible d'être en panne.
(55)
erOghñwgGt;ekIteT ! ´emIlrYcehIy./Ro¶ h-n¶ h-ht-Ka¶ t-te-khnom-m¶ l-ru¶ c-ha¶ j/
/Film-ce-NEG-Ka¶t-NEG-moi-regarder-finit-déjà/
è Ce film n'est pas bon. Je l'ai déjà regardé.
(56)
esovePAhñwgGt;ekIteT ! ´GanrYcehIy./Si¶ vph¶ v-n¶ h-ht-Ka¶ t-te-khnom-a:n-ru¶ c-ha¶ j/
/Livre-ceNEG-Ka¶t-NEG-moi-lire-finit-déjà/
è Ce livre n'est pas bon. Je l'ai déjà lu.
(57)
eborGjminekItGBa©wg)anCacaj;eK !/Bi¶ -âh-m¶ n-Ka¶ t-hh c¶ h-ba:n-ci¶ -câh-ke/
/Cartes-moi-NEG-Ka¶t-comme ça-obtenir-être-perdre-on/
è C'est parce que mes cartes n'étaient pas bons, c'est pourquoi j'ai perdu.
HYPOTHESE :
«Ka¶t», correspondant à une propriété d'une chose, à des faits psychiques, à la force physique où au comportement, marque leur qualité effective. On retrouve donc l'idée que ce qui est le cas P est posé à l'exclusion de ce qui n'est pas le cas P'( ce qui implique que ce qui n'est pas le cas a par ailleurs un mode de présence.)
Lorsque le verbe «Ka¶t» est précédé d'un préfixe[13], il devient un nom. La plupart des noms du Khmer sont formés à partir des préfixes tels que : «
kar - Ka: ; esckþI- Sekdaij ; PaB - Phi¶:p» qui sont liés à une base verbale dans sa forme libre et autonome. Observons bien que, dans sa transformation nominale certains verbes peuvent se former avec ces trois préfixes, selon la fonction aspectuelle : faits actifs, processus, état, etc. Nous parlons de verbe ici pour désigner des unités qui renvoient au procès (action, état de chose, propriété). Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser uniquement au fonctionnement nominal de «Ka¶t» qui se caractérise par «préfixe + base verbale». Il n'est compartible qu'avec un seul des trois préfixes mis en jeu. Il s'agit donc en résumé de la nominalisation à partir d'une forme verbale dans la forme de «karekIt-Ka:Ka¶t». Par ailleurs, nous signalons que ce bloc «Ka:Ka¶t» est toujours placé en début de phrase. Dans cette configuration, on peut observer que l'on retrouve une valeur déjà mise en évidence dans l'analyse de «Ka¶t» en fonction de verbe plein : valeur d'événement non prévisible, dont la réalisation / actualisation est inattendue et échappe au sujet. Cette absence de tout contrôle du sujet sur l'advenue de l'événement s'accompagne d'un effet détrimental qui peut être observé dans l'emploi de «Ka:Ka¶t» suivant :(58)
karekItsRgaÁmsIuvild_yUrGEgVgenAEdnsuvNÑPUmi KWedaysarEtCemøaHrbs;RbeTs epSg² EdlTak;TinnwgePaKRTBüFm¥Catinigninñakarneya)ay./Ka:Ka¶ t-shhkri¶ m-siv¶ l-dh-ju:-hhvêh-nov-dên-sovanaphu:m-kü-daoj-sa-tê-cumluos-robhs-prhtes-pseh-pseh-dêl-t�kt¶ n-n¶h-phoktrio:b-thomaci¶ t-n¶h-n¶ n ni¶ ka:-nojobaj/
/Naissance-guerre-civil-long-durée-rester-territoire-or-village-être-a cause de-mais-conflit-appartenance-pays-divers-divers-qui-correspondre-richesse-naturel-et-tendance-politique/
è La survenue d’une guerre civile de longue durée dans le territoire d’or
(Cambodge) est dû à des conflits entre des pays divers, liés à la revendication de richesses naturelles et à des oppositions politiques.
Signalons que la traduction en français : le terme «survenue» ou «arrivée» ne rend que très imparfaitement compte de la valeur sémantique négative donnée par «Ka:Ka¶t» (on aurait pu rendre compte de cette valeurpar une périphrase plus «lourde» comme : le fait qu’une guerre nous tombe dessus).
(59)
karekItcitþeTas³eFVIeGaymnusSeyIgvegVgsµartI./Ka:Ka¶ t-c¶ t-tosâk-tv¶ -aoj-monûsj¶ h-vov�h-smar¶ daij/
/Naissance-cœur-colère-faire-donner-personne-nous perdre-mémoire/
è L'accès de colère inattendu nous fait perdre la mémoire.
(60)
karekItklyuK Epñkneya)ayy:agF¶n;F¶r dUecñHminRtwmEteFVIeGayb:HBal; dl;kitþis½BÞ RbeTsxøÜnpÞal;Etb:ueNÑaHeT vaEfmTaMgb:HBal; dl;kitiþs½BÞ »bTVIbTaMgmUl eTotpg./Ka:Ka¶ t-khljûk-pnêk-nojobaij-jah-thh ûnthhô-docnê:-m¶ n-tr¶ m-tê-tv¶aoj-pa-po¶l-dhl-ketesâp-prhtes-kluoun-pti¶ol-tê-pônôs-te.vi¶-thêm-ti¶h pa-po¶ l-dhl-ketesâp-ôpâktvib-ti¶ h-mul-ti¶ t-phhh/
/Naissance-catastrophe-domaine-politique-manière-lourd-comme ça-NEG-non seulement-faire-donner-toucher-arriver-prestige-pays-corps-direct-mais-simplement-NEG-il-plus-ajouter-toucher-arriver-prestige-continent-entier-encore/
è Le fait qu'une catastrophe politique éclate à l'heure actuelle touche non seulement à la mauvaise réputation du pays mais aussi à celle du continent entier.
Il y a très peu de temps qu'une étude de recherches scientifiques (sémantisme) sur la langue khmère a été engagée, après des années de trouble de guerre civile.
Ce travail de mémoire est la deuxième étude d'analyse sur les marqueurs du khmer après celle de notre collègue Mr. Somnoble.CHAN. Elle est fondée sur un objectif qui consiste à décortiquer le sens de «Ka¶t» à travers ses diverses formes de constructions.
Après notre travail d'analyse sur la diversité d'emplois de «Ka¶ t», nous avons finalement pu résumer en les classant en trois catégories :
- Dans le cadre des emplois lexicaux avec la construction transitive, nous avons une forme syntaxique : X Ka¶t Y. Dans ce cas, X est considéré comme le sujet patient qui joue le rôle de support (X devient localisateur de Y, c'est-à-dire X a un comportement dit «passif » par rapport à la localisation de Y). Quant à Y, Celui-ci est considéré comme un événement qui s'actualise sur X. En ce qui concerne la construction intransitive, nous avons Y Ka¶t. Cette fois-ci, Y est considéré comme le sujet événementiel, à travers «Ka¶t», qui surgit de façon contingente et indépendante.
Grosso modo, «Ka¶t» marque un procès P du type inchoatif : passage d'absence à présence de Y qui s'actualise sur le plan temporel de façon contingente, indépendante et indéterminée. Ce passage est incarné par un terme que nous appelons «surgissement» de quelque chose (événement).
- Dans le cadre des emplois en postposition verbale, nous avons X+P+Ka¶t. X (sujet) qui peut correspondre à deux facteurs : l'un est une chose et l'autre est une personne. P est un procès exprimé par le verbe «Ka¶t» marquant dans ce cas l'actualisation du procès P en tant qu'exclusion de P'. Cette actualisation dépend du sujet X, c'est à dire premièrement, si X est la propriété d'une chose, celle-ci est sélectionnée en tant que chose qui est sans aucun risque ou problème possible [voir exemples : de (20) à (26)]. Et deuxièmement, si X est une personne, celle-ci arrive à actualiser le procès P en tant que « effectif »
- Dans le cadre des emplois en postposition nominale, nous avons N+Ka¶t. N ici, est une propriété qui peut correspondre à des faits psychiques, à des forces physiques, à la matérialisation et au comportement des animaux. Dans ce cas, «Ka¶t» marque l'actualisation de toutes les qualités effectives de la propriété représentée par N.
A la lumière de ce que nous venons de voir, le morphème «Ka¶t» apparaît donc comme un invariant que nous pourrions désigner relativement par le terme «actualisateur».
|
ANTELME M. (1996), Réappropriation en Khmer de mots empruntés par la langue siamoise au vieux Khmer, Prince of Songkla University, Bangkok. |
|
CAMBEFORT .G., (1950) Introduction au cambodgien, Maisonneuve, Paris. |
|
CHAN S., (1997), Etude du fonctionnement de ba:n en Khmer contemporain : mémoire soutenu en juin 1997, Paris X. |
|
CHUON N. (1969) Dictionnaire Khmer, Institut Bouddhique du Cambodge 5ème édition, Phnom Penh. |
|
CULIOLI A. (1990), Pour une linguistique de l'énonciation. Ophrys. |
|
EHRMAN M.E (1972), Contemporary Cambodian Grammar Sketh |
|
FRANCKEL J.J., LEBAUD D. et LHOPITAL A.., (octobre 1992) Arriver in l'information grammaticale, n° 55, p. 12. |
|
FRANCKEL J-J., et VOGEL .S. (août 1996) «Etudes de linguistique» in Cahier d'études franco-cambodgiens, n° 7, CCCL, Phnom Penh, Cambodge. |
|
FRANKLIN E-H. (1970), Modern Spoken Cambodian, Cornell University, Southest Asia Program Ithaca, New York |
|
GUERSDON J. (1930) Dictionnaire cambodgien-français, IIème partie de «De G /h / à T /to/, p. 139. |
|
KHING H.D. (1997) Aspect générale sur la littérature Khmère, l'Harmattan. |
|
MALHERBE M. (1993) Langages de l'humanité, encyclopédie des 3000 langue parlées dans le monde. |
|
MASPERO G. (1915) Grammaire de la langue khmère, Imprimerie nationale, Paris. |
|
NYCKEES V. (1998) Une brève histoire de la sémantique, dans La sémantique, page 11. |
ROMANS KHMERS
|
KONG Bunchoeun (1995) rnÞHdavBjay:at / runtea-dav-poh i¶ ja:t (Coup d'épée de POGNEAYATT.), Phnom Penh. |
|
MAO Somnang (1996) rlke)akxüac; /rolo¶ k-boak-ksâc/ (Vagues heurtées contre la plage.), Phnom Penh. |
|
NOU Hac páaRseBan ( 1960) /phka-srhpuo:n/ ( Fleur fânée ) Phnom Penh. |
|
PAL Vanaryreak (1996) bMePøcmin)an /bhmplec-m¶ n-ba:n/ (Souvenirs persistants.) Phnom Penh. |
|
RIM. Kin (1965) sUpat /sopha:t/ (SOPHAT), Phnom Penh |
|
SANG. Savatt (1955) mhaecarenATl;Edn /moha-cao-nov-tôl-dên/ (Grands bandits à la frontière.) Phnom Penh. |
|
SOUNG. Sorin (1961) RBHGaTitüfµIrHelIEpndIcas; /prea-at¶t-thmaij-rea-l¶-phêndaij-câs / (Nouveau Soleil se lève sur l'ancienne Terre.) |
Nous avons obtenu ces trois photos données par un moine Bouddhique (à Paris). Et, nous avons essayé de trouver leurs sources, mais le propriétaire Mr CHHEANG Sam Ang (marqué sur la photo 1) a dit que la source a disparu. De toute façon, nous sommes sûr que cette source garde sa originalité et que nous pourrions la retrouver un jour.
![]()
[1] Ce terme peut avoir deux significations : l'un est la langue du Cambodge et l'autre est son peuple .
[2] Une encyclopédie des 3000 langues parlées dans le monde (éd : 1993) par M. Malherbe.
[3] Mr. SAM. Auteur (travail sur le marqueur "Ru¶c") et Mr. CHAN. Somnoble (travail sur le marqueur "Ba:n" en année 1996-97.
[4] "c¶t" veut dire en français "cœur" qui signifie le siege des sentiments.
[5] Traduction : aimer
[6] Traduction : colère
[7] Il s'agit du mariage dans lequel la jeune fille va s'engager.
[8] Ici, c'est un particule qui marque l'accompli d'un événement. Pour d'autres informations, voir l'article de S. VOGEL : "Cahier d'études franco-cambodgiens" N° 7 à la page 11.
[9] Calculé en année Bouddhique.
[10] Nous hésitons sur la transcription alphabétique latine.
[11] Nous employons ce terme pour renvoyer à tout ce que qui désigne les faits psychiques et les forces physiques.
[12] Ici, c'est un terme appellatif familier pour désigner une personne qui a le sexe masculin.
[13] Nous employons ce terme pour désigner simplement qu'un élément qui se place à l'initial d'un mot mais il ne modifie pas le sens comme "le préfixe" en français
This site was last updated 05/18/04