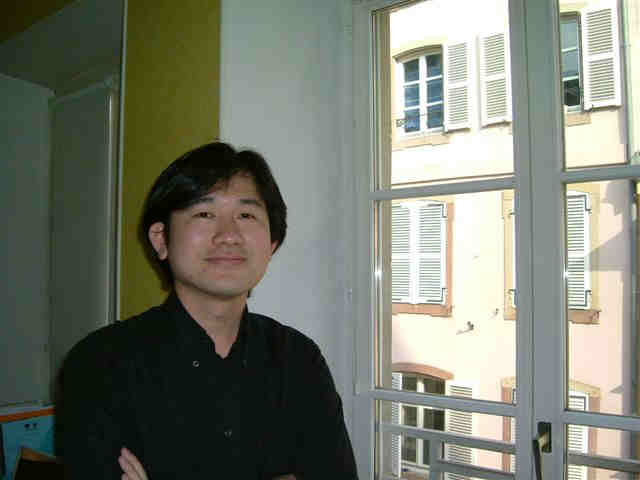

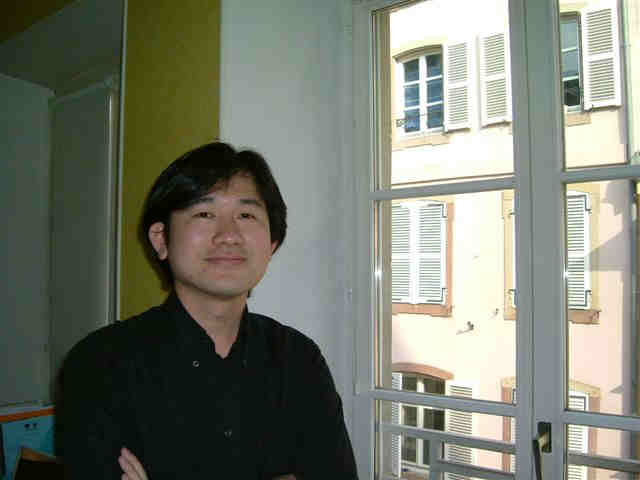 |
 |
|
05/18/04 |
|
|
CHHIV Yiseang a le plaisir de vous présenter sur cette page mon travail de DEA.A lire également "Discours identitaire" du même ex-étudiant de Paris III.L'histoire de sa vie sentimentale et surtout de ses rencontres que l'on pourrait qualifier "hors du commun" est époustouflante. Une des grandes figures des anciens étudiants du DEF, Yiseang a connu un parcours extraordinaire : il a commencé par simple professeur de français pour devenir en cette année 2004, en passant pendant plus d'un an en tant qu'attaché de presse à l'Ambassade de France au Cambodge, un stagiaire incontournable pour la France comme pour le Japon ! Ce premier énarque cambodgien attire sur toutes ses faces et à tous points de vue l'empire du soleil... |
(E.R.A.D.L.E.C)
UFR de Didactologie des Langues-Cultures
Remerciements
Je tiens à remercier mon directeur de recherche, Monsieur Robert Galisson, Professeur de Didactologie des Langues et des Cultures, qui a accepté de mencadrer et de me guider, dans la rédaction de ce mémoire. Ses encouragements mont permis den contourner les nombreux obstacles.
Je suis reconnaissant également à Monsieur Alain Daniel, responsable de la section cambodgienne de lInalco, qui ma fait bénéficier de sa longue expérience denseignement du khmer à lInstitut National des Langues et des Civilisations Orientales.
Que Claire Cabanel, Chantal Claudel, Christophe M. Thioux-Maciejowski trouvent ici lexpression de ma plus vive sympathie pour leur aide précieuse dans lélaboration de ce travail.
Je souhaite aussi remercier tous les étudiants de khmer de lInalco qui ont eu la gentillesse de répondre à mon questionnaire .
Enfin, je remercie mes proches et amis pour le soutien moral quils nont cessé de me prodiguer tout au longue de cette année et je les assure de mon indéfectible attachement.
Introduction
1. Etat des lieux de lenseignement et lapprentissage de la langue et de la culture khmères
1.1. Le cadre institutionnel
1.2. Le programme et le fonctionnement des cours
1.3. Les apprenants
2. Les difficultés de lenseignement et de lapprentissage de la langue et de la culture khmères
2.1. Difficultés linguistiques
2.2. Difficultés culturelles
3.Propositions didactiques
3.1. Un programme nouveau
3.2. Les techniques denseignement adéquates
3.3. Propositions de solutions aux problèmes relevés dans la deuxième partie
Conclusion
Bibliographie
Annexes
Index
Table des matières
Nous avons été formé comme professeur de français et avons exercé ce métier pendant quelques années, avant doccuper, depuis 1997, un poste de lecteur de khmer à lInstitut National des Langues et des Civilisations Orientales (INALCO). Le khmer étant notre langue maternelle , il nous paraît intéressant de faire le point sur cette langue à la lumière de notre expérience de professeur de FLE au Cambodge.
Dans ce travail, nous nous proposons de transférer nos connaissances en didactique du FLE et en didactologie des langues et des cultures à lenseignement du khmer. Nous tenterons donc dappliquer certaines démarches issues dapproches du FLE à une étude de cas en milieu exolingue.
Notre choix sest porté sur lInalco du fait que nous y enseignons. Il sagit dun établissement où les diplômes délivrés ont une notoriété, y compris à létranger (par exemple, au Japon). De plus, le nombre élevé de langues enseignées dans cet établissement va nous permettre deffectuer quelques comparaisons entre lenseignement du khmer et celui des autres langues de lAsie du Sud-Est.
Ainsi, notre étude portera-t-elle sur « Lenseignement et lapprentissage de la langue et de la culture khmères en milieu exolingue : le cas de lInalco ».
Avant d'aborder le cur de notre sujet nous soulignerons, dans un premier temps, les problèmes que cet enseignement pose actuellement :
- Le problème central est l'absence de manuel de base pour l'enseignement du khmer . Cela présente l'inconvénient de ne proposer aucune progression stricte, ni d'objectifs bien définis. En tant que lecteur, nous avons souffert du manque de coordination que cela implique avec l'enseignant titulaire de la section cambodgienne. Pour les étudiants, cela induit un certain flou dans les étapes d'acquisition des connaissances et des difficultés d'auto-évaluation.
- D'autre part, les techniques d'enseignement nous paraissent très traditionnelles (recours à la traduction systématique, méthode ne permettant pas l'acquisition de compétences communicatives , absence d'une approche de la culture comportementale).
- L'apprentissage du khmer présente des difficultés linguistiques particulières pour un public francophone : il sagit d'une langue non indo-européenne ; l'alphabet khmer n'est pas romanisé contrairement au vietnamien. Sur le plan phonétique, l'éventail vocalique du khmer est plus large que celui du français. Il comporte cinq niveaux d'ouverture au lieu de quatre.
Dans un second temps, nous tenterons d'apporter des solutions aux problèmes que nous venons d'évoquer.
Notre méthode d'investigation repose sur l'analyse de plusieurs documents. L'étude de la progression et des objectifs d'apprentissage sur les quatre années du diplôme supérieur (équivalent à la licence) s'est faite à partir de l'analyse des programme s, des sujets d'examen et de devoirs relatifs au contrôle continu. L'étude des difficultés phonétiques a porté sur l'analyse d'enregistrements faits lors de l'examen oral et sur un questionnaire proposé aux étudiants. Ce questionnaire a par ailleurs, servi à cerner le profil des apprenants (identité, motivations, etc.).
Notre travail
comprend trois parties. La première fait un état des lieux de l'enseignement du
khmer
à l'Inalco. La
deuxième partie fait le point sur les difficultés linguistiques et
culturelles rencontrées par les apprenants et les enseignants. La troisième
partie propose des solutions
aux problèmes évoqués
dans les parties précédentes.
Le khmer, langue principale de la famille des langues « môn-khmer », famille encore représentée par plus de 90 langues et dialectes, a été enseigné à lInalco pour la première fois au début du XXè siècle. A lépoque létablissement sappelait lÉcole nationale des Langues orientales vivantes. Les premiers cours de khmer, dispensés par un fonctionnaire et avant cela par un administrateur des colonies, sadressaient surtout aux fonctionnaires coloniaux qui allaient être envoyés au Cambodge et aux orientalistes, historiens, archéologues, mythologues ou traducteurs. Lintérêt des études khmères se justifiait alors par le fait que le pays était une des parties de la France dOutre-mer : pour les élèves-administrateurs des colonies, la connaissance de la langue leur permettait davoir des contacts avec les autochtones, mais on peut y voir aussi, un moyen de manifester leur autorité. Quant aux élèves-orientalistes, cela leur permettait de faciliter leurs recherches.
Lenseignement du khmer sest interrompu à lInalco une dizaine dannées après son introduction par manque denseignants ; ceux-ci furent en effet obligés de reprendre leur service ou leur profession.
En 1930, le khmer a été réintroduit à lInalco mais cette fois-ci, pour des raisons budgétaires, son enseignement a été associé à celui du siamois. En 1943, lenseignement du khmer a obtenu son existence autonome et régulière suite à la création de la chaire temporaire de khmer. Dès lors, un diplôme de khmer fut délivré comme pour les autres langues. Enfin, la chaire magistrale de khmer a été créée en 1945 et fut placée sous la responsabilité dun professeur délégué. Cette création, à laquelle sadjoint un cours de pratique exercé par un répétiteur khmer, donnait appui aux efforts du professeur délégué pour lamélioration de lenseignement de cette langue, au même titre que celui des autres langues de la région du sud-est asiatique.
Depuis ses débuts, lenseignement du khmer a rencontré beaucoup de difficultés étant donné dune part, lhétérogénéité des motivations des apprenants (voir 1.3.2. p.22), dautre part et surtout, les particularités de la langue elle-même. Dailleurs, une forte inquiétude des professeurs de langue de lInalco était de réaliser un enseignement conforme à lesprit général de létablissement qui, tout en étant essentiellement pratique, prépare à une connaissance vraiment scientifique de la langue. Or, nous avons constaté que lenseignement de toutes les langues sy fait selon un programme de cours plus ou moins similaire, sur la base dun enseignement traditionnel de type grammaire-traduction.
Daprès de nombreuses études sur la langue khmère, les linguistes affirment que cest une langue difficile à classer. Cependant, ils considèrent quelle fait partie des langues môn-khmère, elles-mêmes relevant des langues austo-asiatique. Les langues môn-khmère sont un groupe important en Asie du Sud-Est. Selon H.J. Pinnow[1], ce sont les langues les plus intéressantes parmi les groupes austro-asiatique (les langues malayo-polynésiennes, thaï-vietmaniennes et môn-khmère), car elles possèdent des écritures particulières.
Lorigine de lécriture khmère remonte à lépoque de Fou Non (du Ier au VIè siècles) pendant laquelle on a découvert, à Vôkâgn dans la région de Gnâtrâng du Viêt-nam du sud, une inscription rédigée en sanskrit quon considère comme la première inscription khmère. Selon une étude comparée entre lécriture du vieux khmer et celle de lInde du sud, on conclut quelles ont la même forme. En plus, on a découvert à Okéo (ex-port maritime du Cambodge au Kampuchéa krom) des pièces indiennes qui étaient gravées en brami, qui ressemble à lécriture du vieux khmer. Etant donné quà lépoque, le Cambodge et lInde avaient beaucoup de relations entre eux, on conclut que lécriture khmère a été empruntée à celle de lInde du sud dite « brami ». Or, cette écriture « brami » est née de lancien alphabet sémitique. Et parmi plusieurs écritures indiennes nées de cette écriture « brami », le davanagari était le plus connu. Avec le temps, le davanagari est devenu lécriture que lInde utilise officiellement jusqu'à lheure actuelle. Lécriture khmère utilisée à lépoque, ne ressemble pas à lécriture khmère actuelle : elle a subi plus dune dizaine de modifications avant darriver à sa forme actuelle.
Le système décriture du khmer surprendra lusager des langues notées en caractères latins. Il possède sa logique propre, fondée sur une origine historique tirée décritures davanagari de lInde du sud et rend compte de la grande richesse phonologique de la langue quil note très fidèlement. Ses caractéristiques la distinguent notamment des écritures chinoise et vietnamienne, et la rapprochent des écritures thaï, lao et birmane qui en sont issues.
Lécriture khmère est de type alphabétique, cest-à-dire quelle utilise un nombre limité et ordonné de graphèmes, non des idéogrammes. Les caractères ne sont pas liés les uns aux autres comme par exemple à lintérieur des mots du français cursif, et aucun espace ni signe particulier ne sépare deux mots consécutifs. Elle est aussi de type syllabique, en ce sens quelle se décompose en syllabes juxtaposées de la gauche vers la droite, les lignes étant écrites de haut en bas, comme en français. Chaque unité syllabique est lue dune seule émission de voix.
Dans cette langue, les consonnes et les voyelles sont attachées, ce qui provoque une relation réciproque entre elles. Cette relation fait apparaître la présence de voyelles inhérentes (la voyelle qui na pas de forme, elle na que le son intrinsèque à la consonne) à lintérieur des consonnes. Les consonnes sont réparties en deux séries sauf certaines qui nexistent que dans une seule série. Les voyelles dépendantes sont divisées elles aussi en deux séries dont les prononciations dépendent des deux séries de consonnes inhérentes, mais dont les signes-voyelles nont quune seule forme. Il est à noter que chacun des signes-voyelles est susceptible dune deuxième prononciation, distincte de la première. On verra par lécriture que cest la consonne qui détermine celui des deux registres qui convient.
Grâce à la présence des voyelles inhérentes dans les consonnes inhérentes, chaque consonne peut devenir une syllabe et avoir un sens, à la différence notamment du français où une consonne peut devenir une syllabe si elle se combine avec une voyelle.
En khmer, deux consonnes consécutives peuvent aussi devenir une syllabe. Dans ce cas, la consonne finale ne possède pas de voyelle inhérente et on ne prononce que le son de la consonne. Malgré labsence dindication de la voyelle inhérente dans la consonne finale, les erreurs dinterprétation sont rares. Le contexte permet de lever les ambiguïtés.
Comme le français, par exemple, ne possède ni voyelle inhérente ni consonne inhérente , deux ou trois consonnes consécutives ne peuvent pas devenir une syllabe, mais un groupe consonantique (tr de « trouver », spl de « splendeur », etc.). En khmer, en revanche, les consonnes dun groupe consonantique ne sont pas écrites les unes après les autres mais lune au-dessus de lautre, ce qui a pour conséquence la création de consonnes souscrites ou « pieds », placés au-dessous des consonnes de base avec un graphisme différent pour former un groupe consonantique. Ce système des consonnes souscrites fait partie du principe des voyelles et consonnes inhérentes.
Une autre particularité de lécriture khmère , cest lutilisation de deux signes diacritiques « " », « », placés au-dessus des consonnes existant dans une seule série et qui ont pour utilité de les faire passer de la première à la deuxième série et vice-versa.
Comme dans beaucoup dautres langues, de nombreux mots étrangers se sont mêlés au khmer. Le plus grand nombre de mots étrangers empruntés provient du pâli et du sanskrit. Le pâli est arrivé au Cambodge par le Bouddhisme hinayana (petit véhicule) et le sanskrit, par le bouddhisme mahayana (grand véhicule) et le brahmanisme. Etant donné que les Cambodgiens pratiquent ces religions venues de lInde, le pâli et le sanskrit ainsi que leurs règles grammaticales ont beaucoup influencé le khmer et y sont encore enracinés. Les Cambodgiens possédaient déjà leur propre langue : le khmer lorsque le pâli et le sanskrit sont arrivés au Cambodge. Ceci vient confirmer le point de vue de J. Taupin : « La littérature et la langue khmère sont filles du sanskrit ». Le khmer utilise les emprunts du pâli et du sanskrit uniquement pour compléter sa pénurie. Et, en plus, les mots venus de ces deux langues ont été modifiés phonétiquement et morphologiquement pour sadapter au goût des Cambodgiens. Ce genre de khmérisation ne sapplique pas seulement au pâli et au sanskrit, mais aussi à tous les emprunts de langues étrangères. En outre, les langues khmère-môn sont très éloignées du pâli et du sanskrit qui sont des langues indo-européennes, car elles possèdent des déclinaisons.
Les mots dorigine khmère possèdent peu de syllabes. Il existe beaucoup de mots monosyllabiques à la différence du pâli et du sanskrit qui sont polysyllabiques. Dans le cas dun mot khmer de deux ou plusieurs syllabes, la prononciation a tendance à réduire le nombre de syllabes en atténuant le son de la première syllabe et en accentuant la dernière syllabe. Cette tendance à réduire le nombre de syllabes a beaucoup influencé les mots dorigine pâli ou sanskrit qui possèdent plusieurs syllabes. Voilà lune des méthodes utilisées pour khmériser les mots venus du pâli et du sanskrit.
A la différence des langues indo-européennes, et notamment du pâli et du sanskrit, qui possèdent le genre, le nombre et la morphologie, le khmer nen possède pas. Mais il existe des mots pour indiquer les sexes (masculin, féminin, mâle, femelle) quon utilise avec les noms. Il y a aussi des mots utilisés avec les noms pour marquer le nombre (un, deux, tout, toutes, etc.). Dans la langue khmère , comme il nexiste ni genre ni nombre, les mots dune phrase ne changent pas de formes, aussi il ny a pas de morphologie. Le khmer est une langue indéclinable.
Il dispose de procédés particuliers qui permettent de créer, à partir dune racine, des mots qui ont des sens différents mais qui restent de la même famille . On peut créer des mots à partir dun verbe, dun adjectif au moyen des affixes : préfixes, infixes.
Combefort explique que :
« la structure morphologique de cette langue a ceci doriginale quelle ignore totalement les suffixes, lesquels sont dailleurs très copieusement remplacés par les infixes et notamment linfixe nasal. Ce procédé de dérivation par infixes nest pas lapanage exclusif de la langue khmère , il en constitue cependant une des particularités les plus remarquables ».[2]
Par ailleurs, on peut utiliser en khmer plusieurs adjectifs, qui peuvent être synonymes, avec un nom pour renforcer le sens comme « le grandiose, splendide et merveilleux temple dAngkor Wat ». Ceci peut être redondant par rapport au français mais, en khmer, cette répétition est tout à fait normale.
Ce sont des mots spécifiques qui permettent d'assurer le comptage. On donne successivement la nature de l'objet compté, le nombre d'objets, puis un terme appelé classificateur, variable suivant le type d'objet. Chez les êtres humains, on distingue les personnes ordinaires, les membres du clergé, les membres de la famille royale. Cela mène à trois termes spécifiques qui n'ont pas d'équivalent français.
Le khmer possède la particularité de ne pas être une langue à tons. Cest lun des points qui le différencie notamment du chinois, du vietnamien, du thaïlandais et du laotien qui sont des langues toniques. (Voir 2.1.1. p.22 et 3.3.1. p.22)
Comme la plupart des autres langues dExtrême-Orient, dans la syntaxe khmère, le mot est invariable. Les catégories grammaticales ne correspondent pas aux « parties du discours ». On ne trouve donc pas de marque particulière indiquant le genre, le nombre, la personne, le temps, le mode, etc. Il ny a, en outre, pas de déclinaison, ni de conjugaison. Certes, on trouve en khmer des mots qui tiennent le rôle de verbes, substantifs, adjectifs, etc., comme en français mais sauf peut-être en ce qui concerne les dérivés, rien ne permet de les différencier morphologiquement ; leur rôle dépend de leur place. Un autre fait important à remarquer, cest que le mot khmer est toujours pris dans son sens le plus général, doù nécessité de le faire préciser en mettant à sa suite les déterminants appropriés dans lordre voulu, car cest lordre qui va de lindéterminé au déterminé qui prévaut en khmer. Cest la règle capitale, remarquait déjà au XIIIè siècle le Chinois Tcheou Ta Kouan lors de son voyage au Cambodge[3].
Selon Alain Daniel, la fonction du mot n'est pas définie par sa forme mais par sa place à l'intérieur de la phrase. (Ex. Eqá ´ [cHkEkHøom] « mon chien » ; ´ Eqá [kHøom cHkE] « je suis un chien »). La phrase ressemble souvent à un rébus dont les éléments peuvent apparaître comme difficiles à interpréter et à classer.
Du point de vue syntaxique également, on peut utiliser en khmer le même marqueur de personne dans tout le texte : ce qui ne se fait pas dans la syntaxe française. A propos des marques de temps, le khmer nen possède que trois (le passé, le présent et le futur).
Par ailleurs, F. Ponchaud explique que la langue khmère est très concrète et descriptive : pour dire « Va chercher cela ! » Il convient de dire « aller pendre objet là porter venir moi »[4]. Pour un français une phrase exprime une idée après laquelle on en enchaîne une autre. Pour le Khmer, les redondances, les répétions sous une autre forme permettent à linterlocuteur de saisir lidée exprimée. La phrase khmère est mono-propositionnelle : les relatifs et les conjonctions (parce que, afin que, pour, par ) sont dusage récent, calqué sur le français. Elle est une juxtaposition spatiale et temporelle et non une organisation selon la logique cartésienne. Dans la phrase dailleurs, tout doit être explicite, sans idée abstraite. Linterrogation « que désirez-vous : du pain ou du riz ? » ne sera pas comprise immédiatement. Pour ce faire il faudra expliquer de quoi on parle en premier et dire : « du pain ou du riz que désirez ? ». (Voir aussi 2.1.2. p.22, 3.3.2. p.22)
De ces diverses notions, nous pourrons conclure quavec le khmer, nous aurons affaire à une langue narrative qui procède par précisions successives, mais à qui linterprétation est interdite.
La présentation de ces particularités de la langue et de lécriture khmères a pour but de montrer les grandes différences quil existe entre le khmer et le français ces deux langues faisant partie de deux familles très éloignées : la première, de la famille austro-asiatique, la seconde, du groupe indo-européen.
Depuis le milieu du XVIIIè siècle, on peut distinguer trois étapes dans lévolution de la langue khmère.
A lépoque de la colonisation française (1863-1953), lévolution du khmer a été ralentie. Jusquà 1900, les Cambodgiens apprenaient leur langue uniquement dans les pagodes. Ainsi, les garçons étaient obligés de prendre lhabit, dune part pour le respect de la coutume et de la religion et dautre part, pour apprendre à lire et à écrire le khmer et le pâli, mais aussi pour aborder les principes du Bouddha. Pour les filles, impossible de prendre lhabit, elles étaient donc généralement analphabètes. Dans la capitale, jusqu'à 1930, il y avait très peu décoles en dehors des pagodes. Après cette date, le khmer est introduit dans le seul collège qui existait alors. En 1936, le premier journal en khmer est créé sous le nom de Nagaravatta. Ce journal allait être fermé six ans plus tard par lautorité coloniale, ce qui ne favorisa pas le développement de la langue.
Après lIndépendance en 1953, le khmer est déclaré langue officielle. Les créations du Comité de la culture, des Facultés de Pédagogie et des Lettres, de lInstitut National de khmérisation ont promu linvention de vocabulaire technique. L'évolution très rapide de la société, sa modernisation, créent de nouveaux besoins linguistiques. Deux voies d'enrichissement sont en présence, l'une consistant à utiliser au maximum les procédés de dérivation traditionnels, l'autre à emprunter massivement au pâli.
Lavènement du régime Khmer Rouge a entraîné la stagnation voire la régression de la langue. Suite à cela, lensemble des organismes ayant des fonctions similaires à celles de l'Académie Française ont totalement disparu. En labsence de ce type dinstance, chacun peut inventer et proposer ses propres mots nouveaux. Le temps seul fera ses choix parmi eux.
Pour les apprenants francophones, écrire le khmer en caractères latins rendrait à coup sûr leur apprentissage plus facile. Les systèmes proposés sont trop simplificateurs et ils introduisent de nombreuses confusions. Ils ne délivrent pas exactement la richesse de la phonétique khmère. La profusion de signes supplémentaires, d'accents, de barres et de points au-dessus ou au-dessous des lettres les rendent aussi difficiles à déchiffrer que l'écriture traditionnelle. L'intérêt est donc bien mince. Une seule tentative de l'imposer a cependant eu lieu. En 1943, lautorité coloniale a voulu romaniser le khmer comme elle lavait déjà fait au Viêt-nam. Cette loi de romanisation du khmer a été un échec. De nombreux moines et des intellectuels cambodgiens lont contestée, aussi a-t-elle été abolie en 1945. Cette lutte contre la romanisation fait que les Cambodgiens possèdent, aujourdhui encore, leur propre écriture.
![]()
[1] PINNOW H.-J., « Personnal pronouns in the Austroasiatic languages : a historical study » dans Lingua, XIV, 1965, pp.3-42
[2] CAMBEFORT G., Introduction au cambodgien, Les langues dorient, G. P. Maisonneuve et Cie, Paris, 1950, p. 5
[3] CAMBEFORT G., op. cit., p.6
[4] PONCHAUD F., cité par J. ROUER, site Internet : www.lb.refer.org/miroirs.CBODG_CT/
Compte tenu de la date de lintroduction du khmer, lInalco est à notre connaissance la plus ancienne école dapprentissage du khmer hors du Cambodge même. Il sagit dun enseignement universitaire, réparti sur quatre années.
Les cours de khmer sont organisés de façon à ce que les personnes salariées puissent venir les suivre. Cest ainsi que pendant trois jours par semaine, les cours ont lieu entre 18h et 21h et sont répartis en deux séances.
Actuellement, les cours de langue sont dispensés par un professeur français, un lecteur et deux professeurs cambodgiens qui sont au CNRS et qui assurent chacun deux unités denseignement (UE).
Comme toutes les autres langues, les diplômes de premier cycle comprennent le certificat de langue et civilisation et le Diplôme Unilingue de Langue et de Civilisation Orientale (DULCO). Le certificat de langue et civilisation se prépare en deux ans avec 4 unités denseignement (UE) et deux de civilisation dont une est obligatoire et lautre optionnelle. Quant au DULCO, il se prépare normalement en 3 ans et comprend 6 UE, 4 de civilisation et 2 ou 3 UE libres selon le poids horaire des UE. Pour les diplômes de deuxième cycle, le premier est le diplôme supérieur option langue et littérature ou diplôme supérieur option français langue étrangère (équivalent à la licence) et le Diplôme de Recherche et dEtudes Appliquées (DREA).
Pour le fonctionnement des enseignements généraux de langue et de civilisation à lInalco, de nombreuses unités denseignement ont été proposées ; pour le premier cycle, des cours dinitiation à la linguistique, dintroduction aux littératures des pays de lAsie du Sud-Est et de préparation à la communication interculturelle ; pour le deuxième cycle, des cours sur le bouddhisme, lhistoire de lart et larchéologie en Haute Asie et en Asie du Sud-Est, des cours dinitiation pratique à la recherche et de technologie de la communication. En plus de ces cours, il y a pour le département de lAsie du Sud-Est, des séminaires sur les civilisations de la région. Ceux-ci concernent lethnologie, la sociologie, lhistoire, la géographie, la géopolitique, léconomie et les sciences sociales.
Selon le responsable de la section cambodgienne, lobjectif des cours de 1ère année est quà la fin du premier semestre, les étudiants soient capables de déchiffrer nimporte quel texte, décrire en khmer et de prononcer correctement les sons khmers. A la fin de la 1ère année, les étudiants doivent avoir acquis un vocabulaire qui leur permet de lire des textes de niveau élémentaire et de sexprimer dans des situations très simples de la vie courante.
En ce qui concerne les objectifs généraux de la 2ème année, les étudiants doivent avoir acquis une bonne connaissance théorique de la grammaire et avoir suffisamment accru leur vocabulaire pour pouvoir lire des textes dun niveau plus élaboré ; ils doivent savoir également lire des textes simples de type descriptif et comprendre une conversation simple et peu rapide, dans laquelle ils peuvent demander à linterlocuteur de répéter.
Quant aux objectifs de la 3ème année qui aboutit DULCO, les apprenants doivent avoir une bonne maîtrise de la langue écrite et parlée, la capacité de rédiger des textes sur tous types de sujets concrets, soutenir une conversation simple et ils doivent avoir acquis des principes de bases de traduction dune langue à lautre. A la fin de la 4ème année, lannée du diplôme supérieur, les étudiants doivent avoir une bonne connaissance de la langue écrite et parlée, une maîtrise de lemprunt aux langues étrangères, sanscrit et pâli notamment, une aptitude à lexposé oral sur un sujet donné et une familiarisation à la littérature romanesque et journalistique modernes, une connaissance de la traduction à travers des textes et une approche des grandes uvres de la littérature khmère.
En résumé, les quatre premiers mois de cours pour les 1ère années permettent de maîtriser la lecture et lécriture, la quatrième année peut déboucher sur la rédaction dun mémoire de maîtrise, puis dune thèse.
Il nous semble que la définition des objectifs reste trop générale pour déterminer avec précision les compétences que lon peut attendre des étudiants à chaque niveau de leur cursus.
Nous avons fait des recherches sur le programme des cours depuis lintroduction du khmer à lInalco, mais navons trouvé de trace écrite quà partir de 1986.
Daprès M. Alain Daniel, professeur responsable de la section khmère à lInalco depuis 1986, le programme des cours (ou des UE) a été fait, en principe, en sinspirant des autres programmes et en harmonie avec les autres langues de lInalco. Mais, étant donné que chaque langue a ses spécificités, il faut faire un découpage qui sadapte aux étudiants qui font du cambodgien en majorité en plus de leur travail ou de leurs études principales.
Le programme de cours[1] est grosso modo[2] le suivant depuis 1986.
|
Code Module |
Code U.E. |
Intitulé
|
|
CAM 101 |
Initiation au cambodgienPhonologie et théorie de lécriture du cambodgien (18h) Apprentissage de la lecture du cambodgien (27 h) |
|
|
(14 semaines) |
CAM 102 CAM 103 |
Cambodgien élémentaireEtude de textes élémentaires cambodgien (36h) Pratique orale élémentaire du cambodgien de base (54h) |
|
CAM 200 CAM 201 |
Théorie du cambodgien IGrammaire du cambodgien (27h) Compréhension écrite du cambodgien (27h) |
|
|
CAM 202 CAM 203 |
Pratique du cambodgien IPratique orale du cambodgien I (41h) Expression écrite cambodgienne I (41h) |
|
|
CAM 301 |
Théorie du cambodgien IILa traduction cambodgien-français (27h) Textes de civilisation cambodgiens (27h) |
|
|
CAM 302 CAM 303 |
Pratique du cambodgien IIPratique orale du cambodgien II (41h) Expression écrite cambodgienne II (41h) |
|
|
CAM 400 CAM 401 |
Méthodologie du cambodgien avancé (1er semestre) Méthodologie de la traduction en cambodgien (21h) Méthodologie de loralité en cambodgien (20h) |
|
|
CAM 402 CAM 403 |
Pratique du cambodgien avancée (2ème semestre) Pratique de la traduction avancée cambodgien-français (21h) Pratique avancée de loral cambodgien (20h) |
|
|
CAM 404 CAM 405 |
Expression cambodgienne moderne (1er semestre) Sélection darticles de presse en cambodgien (41h) Littérature romanesque moderne cambodgienne (41h) |
|
|
CAM406 CAM407 |
Expression cambodgienne contemporaine (2ème semestre) Champ lexical des termes techniques cambodgiens (20h) Littérature romanesque cambodgienne contemporaine (20h) |
Nous avons comparé les programmes des UE des autres langues de la région comme le thaï et nous avons constaté que les intitulés de chaque UE sont tous très vastes. Néanmoins, nous avons noté que la section thaï expliquait le contenu des UE présentées. Cela montre quau moins les objectifs des cours sont définis.
Afin de mieux comprendre les intitulés présentés dans le programme, nous allons expliquer le déroulement des cours, les démarches utilisées et leurs supports.
Phonologie et théorie de lécriture du cambodgien (18h)
Apprentissage de la lecture du cambodgien (27 h)
A raison de 5h par semaine pendant les quatre premiers mois, lenseignement du cambodgien est consacré uniquement à linitiation à la langue. Il exclut lapprentissage de phrases. Les cours dinitiation sont répartis en deux séquences dont la première qui est assurée par le professeur responsable, est consacrée à lexplication de la phonologie, de la théorie de lécriture du cambodgien et de quelques notions importantes sur la langue ; la deuxième séquence porte sur lapprentissage de la lecture et de lécriture et sa charge est confiée au lecteur. Pour la correction phonétique, les cours ont lieu dans le laboratoire de langue.
Cette répartition nous semble justifiée, car la maîtrise de la lecture et de lécriture est primordiale pour la suite de lapprentissage. Il est à noter que cette maîtrise est tellement indispensable que les étudiants qui nont pas réussi lexamen du premier semestre ne sont pas autorisés à poursuivre leurs études.
Etude de textes élémentaires cambodgiens (36h)
Pratique orale élémentaire du cambodgien de base (54h)
Comme lindiquent les intitulés de lUE, de nombreux textes en khmer sont étudiés pendant tout le second semestre. Tout dabord, ils sont expliqués et traduits en français. Puis, ce sont les cours de lecture et de compréhension écrite. En plus de létude des textes élémentaires, sajoutent celle de dialogues élémentaires. Lapprentissage du dialogue a lieu dans le laboratoire de langue et se fait en deux parties : la première est un exercice découte et de répétition pour la vérification de la prononciation et la deuxième porte sur les exercices structuraux. Une partie du cours est réservée également à la traduction du français au khmer. Il sagit de morceaux de phrases traduites de langlais vers le français extraites du manuel dapprentissage du khmer de J.-M. Jacob[3], qui sont conçues pour marquer la différence entre la syntaxe anglaise et la syntaxe cambodgienne.
Grammaire du cambodgien (27h)
Compréhension écrite du cambodgien (27h)
Ce sont des cours de grammaire exclusivement. Les points grammaticaux sont expliqués en français. Quant aux cours de compréhension écrite, ils prennent la suite de ceux de la première année. Les mêmes techniques, traduire dabord des textes en français puis vérifier oralement la compréhension, sont utilisées.
Pratique orale du cambodgien I et II
Les cours sont répartis en deux parties : la première est la pratique orale à partir de textes déjà expliqués et la deuxième est lexploitation de dialogues qui sont la suite de ceux de la première année. Les exercices utilisés sont des exercices structuraux : il sagit découter le modèle et de répondre aux questions selon le modèle.
Expression écrite cambodgienne I et II
Une série de textes en français, composés dune dizaine de lignes, sont à traduire en langue étudiée.
La traduction cambodgien-français (27h)
Textes de civilisation cambodgiens (27h)
Il sagit dun cours théorique de traduction à partir de textes de civilisation cambodgiens fabriqués ou authentiques. Les éléments culturels khmers au quotidien à savoir les expressions imagées, les métaphores, les dictons, les proverbes, etc., sont à relever puis il sagit de chercher les équivalents approximatifs en français. Les cours se font en français.
Méthodologie du cambodgien avancé (1er semestre) et pratique du cambodgien avancé (2ème semestre)
Méthodologie de la traduction en cambodgien (21h) et pratique de la traduction avancée cambodgien-français (21h)
Cest la suite du cours théorique de traduction, sauf que cette fois-ci, des extraits duvres littéraires et de contes sont utilisés.
Méthodologie de loralité en cambodgien (20h) et pratique avancée de loral cambodgien (20h)
La méthodologie des exposés oraux est présentée puis, chaque semaine, un ou deux étudiants préparent et font un exposé oral sur le sujet de leur choix. Chaque exposé est suivi dun débat ou dune discussion.
Expression cambodgienne moderne (1er et 2ème semestre)
Sélection darticles de presse en cambodgien (41h)
Champ lexical des termes techniques cambodgiens (20h)
Des articles extraits de la presse cambodgienne sont expliqués et traduits en français et analysés, afin de relever les termes techniques permettant délargir le champ lexical.
Littérature romanesque moderne cambodgienne (41h)
Quelques romans contemporains célèbres khmers ont été choisis pour étudier le courant littéraire et la société que ces uvres reflètent. Ces cours se font en français.
Deux observations nous semblent pouvoir être faites :
A la lecture des programmes de la brochure pédagogique, la progression proposée paraît très vague. Cela implique que lenseignant a toute liberté pour faire les cours à sa manière, mais cela signifie en contrepartie que la coordination des enseignants en matière de progression est quasiment absente.
Il manque cruellement douvrages modernes denseignement du khmer. Un certain nombre de manuels dinitiation ont vu le jour depuis la deuxième moitié du XIXè siècle et sont désormais inadaptés. Cest ainsi que parmi les ouvrages à considérer, le premier est le Dictionnaire de Aymonier, paru en 1874, qui traite daspects divers de la culture et de la langue ; la première grammaire khmère de Georges Maspéro a paru en 1915 et la première méthode destinée à des non-khmérophones est celle de Louis Manipoud (cette dernière na jamais été publiée, mais a été utilisée entre 1913 et 1946 au Cambodge). Ces trois principaux ouvrages sont ceux auxquels on se réfère, aujourdhui encore, le plus souvent.
Nous avons constaté que les professeurs responsables de la section de khmer à lInalco ont tous mis laccent sur lapprentissage des bases de la lecture et de lécriture, lesquelles sont indispensables pour la suite de lapprentissage. Cest la raison pour laquelle chaque professeur écrit une méthode de lecture et décriture[4]. Nous sommes daccord sur limportance à accorder à cette approche.
Pourtant, il nexiste ni méthode, ni manuel qui assure la suite de cette initiation. Selon M. Alain Daniel, « fidèle à sa tradition, lenseignement du cambodgien fait une large place à la littérature ancienne malgré la difficulté dapprentissage dune écriture dont la complexité rend à merveille la grande richesse phonologique »[5]. Etant donné les problèmes posés pour cette littérature, lenseignant recourt largement à la traduction. Ceci extrait montre clairement que le rôle de la langue maternelle est primordial pour la compréhension des textes littéraires. Nous pouvons induire que la traduction est quasiment systématique au cours de lenseignement-apprentissage du khmer.
Avant les méthodes directes, le recours à la langue maternelle ou à la traduction nétait pas un problème. Mais, à lheure de lapproche communicative, utiliser la traduction de façon systématique est pour le moins obsolète. Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie.[6]
Bien que lenseignement dispensé à lInalco sinscrive dans le cadre de lenseignement universitaire, lensemble de ses sections disposent dun test daccès réservé à ceux qui souhaitent suivre les cours de langue, mais ne sont pas titulaires du baccalauréat.
Chaque année, en plus des étudiants régulièrement inscrits, il y a aussi des auditeurs libres. Le statut de ces derniers ne leur permet pas de bénéficier des corrections de devoirs, ni du laboratoire. Il nest accordé quaux candidats qui remplissent les conditions administratives pour bénéficier dune inscription normale.
Afin de cerner le profil sociologique des étudiants, nous avons procédé à une enquête sous forme dun questionnaire [7] effectué auprès des étudiants inscrits et présents. Il existe un écart entre le nombre détudiants inscrits et les étudiants présents car officiellement, les inscrits sont 39 en 1ère année, 22 en 2ème année, 7 en 3ème année et 8 en 4ème année. A la fin de lannée, en 1ère année, 20 seulement se sont présentés à lexamen. Il y a donc des étudiants qui ont abandonné au cours de lannée pour diverses raisons et dautres qui ne viennent que passer lexamen final.
Nous avons donc distribué plus dune quarantaine de questionnaires aux étudiants présents en leur laissant une semaine pour répondre à toutes les questions. En dépit de notre position denquêteur (Professeur), seuls 21 filles et 11 garçons, soit 32 personnes, les ont remplis.
Pour mieux cerner le profil des étudiants, nous avons élaboré deux questionnaires, lun destiné aux étudiants dorigine cambodgienne et lautre à ceux dorigine non cambodgienne. En fait, nous avons pensé quil était intéressant de poser certaines questions aux uns, lesquelles nétaient pas importantes pour les autres. Ces questions avaient pour fonction de vérifier certaines de nos hypothèses.
Parmi les 32 questionnaires reçus, 20 sont des réponses détudiants dorigine non cambodgienne et 12 celles de personnes dorigine cambodgienne. Ils ont entre 18 et 56 ans dont 6 ont moins de 20 ans, 13 entre 20 et 26 ans et 13 plus de 26 ans. Quant à la nationalité, 26 sont Français, 4 Cambodgiens (Cambodgiens de France), une Canadienne dorigine cambodgienne et un Japonais.
5 étudiants sur 32 sont mariés, dont trois Français et 2 dorigine cambodgienne qui sont en couple mixte (conjoint non asiatique et cambodgien). Parmi les trois Français, un est marié avec une Cambodgienne.
La plupart des étudiants dorigine non cambodgienne exercent une activité professionnelle parallèlement à leurs études et cest le contraire pour les étudiants dorigine cambodgienne. Il est à noter que les professions des étudiants sont très diversifiées. Ceux-ci sont : journaliste, infirmière en soins palliatifs, agent de propreté, éducatrice spécialisée, surveillantes décole maternelle, bibliothécaire, comédienne, entrepreneur de spectacle, consultant, professeur de sciences physiques, fonctionnaire, médecin, stagiaire de lAmbassade du Japon, etc.
En ce qui concerne leurs études, deux tiers des étudiants ont affirmé que le khmer était leur cursus principal. Un tiers font dautres études en parallèle : pour les étudiants dorigine cambodgienne, ce sont des études de langues étrangères (chinois, thaïlandais, japonais, anglais, etc.), et de sociologie ; pour les étudiants dorigine non cambodgienne, ce sont des études variées à savoir lethnologie, lhistoire de lart, les relations internationales, les sciences politiques, le droit ; une étudiante prépare un doctorat de médecine.
La connaissance et les relations avec le Cambodge sont variables : deux tiers des étudiants dorigine non cambodgienne y sont déjà allés dont 3 sont restés moins de 3 mois et 5 plus de 3 mois. Leur voyage a été effectué entre 1993 et 1998. Une étudiante est née au Cambodge et y a passé une partie de son enfance.
Les trois quarts des étudiants dorigine cambodgienne sont déjà allés au Cambodge. Leur séjour a duré entre une semaine et deux ans, entre 1991 et 1998.
Les étudiants dorigine cambodgienne ont tous de la famille au Cambodge sauf une étudiante dont toute la famille était réfugiée à létranger. Ils entretiennent des rapports sous forme de correspondance plus ou moins régulière, daide financière, dappels téléphoniques et de visites. Lors de leur voyage au Cambodge, un quart dentre eux séjournait dans leur famille.
La plupart des étudiants dorigine non cambodgienne estiment avoir un niveau rudimentaire en khmer et un tiers passable. Parmi les étudiants dorigine cambodgienne, 4 sur 12 utilisent le français au quotidien dans leur famille, 1 le khmer et 7 le français et le khmer.
En dehors du français et du cambodgien, tous connaissent au moins une autre langue étrangère quelle soit occidentale comme langlais, lallemand, lespagnol, litalien, le portugais, et/ou une langue orientale à savoir le chinois, le japonais, le laotien. Il en est de même pour les étudiants dorigine cambodgienne, mais les deux tiers connaissent en plus dune langue occidentale une langue orientale telle que le chinois, le japonais ou le thaï. Ceci se justifie par le fait quen France, lapprentissage des langues étrangères est obligatoire pendant la scolarité.
Avant danalyser les motivations des étudiants actuels, faisons une brève présentation des motivations des premiers apprenants de khmer à lInalco. A lorigine, la majorité des apprenants de la chaire de khmer étaient les élèves de lÉcole nationale de la France doutre-mer. On comptait ensuite des membres de lenseignement primaire qui avaient lintention de solliciter un poste en Indochine française, des fonctionnaires en congé qui profitaient de quelques mois de répit pour perfectionner les rudiments acquis dans le pays et acquérir un diplôme utile à leur avancement. Enfin, les apprentis orientalistes qui sintéressaient tout particulièrement aux choses du vieux royaume khmer, les indianistes qui ne pouvaient ignorer la langue des hommes dAngkor[8], des linguistes que passionnaient les aspects propres à la langue à savoir la structure de la langue, son évolution et ses emprunts, sa phonétique et sa phonologie. Ajoutons encore à cette liste des ethnologues et des folkloristes en quête de traditions populaires, et nul ne sétonnera du nombre relativement considérable des élèves inscrits au cours de khmer. De plus, des auditeurs extérieurs à lÉcole de la France dOutre-mer suivaient les enseignements avec la même application que les élèves de lÉcole des Langues Orientales.
Pour ce qui concerne les étudiants actuels, le questionnaire distribué a permis aussi de connaître les raisons de leur apprentissage de la langue khmère et les occasions de leurs contacts avec cette langue et cette culture.
Les étudiants dorigine non cambodgienne sont entrés en contact par divers biais : la littérature (7 réponses), le cinéma (4 réponses), les documentaires sur le Cambodge (7 réponses), les journaux (7 réponses), les contacts avec des amis cambodgiens (12 réponses), les voyages (7 réponses), les productions artistiques (3 réponses), le vécu des ancêtres au Cambodge, lhistoire ancienne et récente du Cambodge, lenvie de travailler et de vivre dans un pays au passé et à lactualité à la fois riches et parfois difficiles (1 réponse) et une association de parrainage denfants au Cambodge (1 réponse).
Deux étudiants dorigine cambodgienne ont dit que leur apprentissage de la langue khmère a commencé dès la toute petite enfance avec la lecture et lécriture et dix autres, plus tard, lorsquils en ont exprimé le désir.
En ce qui concerne les motivations pour lesquelles les étudiants apprennent le khmer, leurs réponses sont les suivantes : la majorité des étudiants dorigine non cambodgienne apprennent la langue pour accéder à la culture cambodgienne, aller travailler ou faire du tourisme au Cambodge, utiliser cette langue dans leur projet de recherche ou détude. Un étudiant dorigine non cambodgienne a répondu quune des raisons qui le motivent dans lapprentissage du khmer est familiale (il a une conjointe cambodgienne), deux autres étudiants, parce quils ont adopté ou parrainent des enfants cambodgiens, une étudiante, parce quelle vit en concubinage avec un Cambodgien et le dernier pour passer le concours des cadres dOrient.
Pour les étudiants dorigine cambodgienne, les raisons sont aussi diverses : il sagit de perfectionner une langue que leur parents parlent à la maison[9]. Certains affirment apprendre la langue pour retourner vivre et aller travailler au Cambodge : un étudiant étudie le khmer parce que le sud-est asiatique lintéresse en général, le Cambodge en particulier, un autre, parce quil voudrait, à long terme, devenir directeur dune compagnie internationale pour les échanges import-export franco-asiatiques. Une étudiante explique quelle voudrait devenir interprète/traductrice.
Par ailleurs, les raisons pour lesquelles des personnes apprennent le khmer sont liées à des problèmes didentité.
Certains trouvent que quand leurs parents parlent khmer et queux répondent en français, cela gène la communication ou quil y a une contradiction dans le fait davoir une apparence physique khmère et de ne pas parler khmer. Dautres enfin éprouvent le besoin de mieux connaître leurs racines cambodgiennes après lexil de leurs parents.
Neuf sur trente-deux déclarent quils se sont inscrits à la section cambodgienne de lInalco pour avoir un diplôme, 7 pour compléter leur cursus universitaire[10] et 3 seulement pour trouver du travail en France dans des sociétés qui ont des rapports avec le Cambodge et utiliser cette langue dans leur profession. A ce propos, nous remarquons que cette idée nest peut-être pas fondée car dune part, il existe très peu de relations commerciales entre la France et le Cambodge et dautre part, la langue khmère nest pas une langue quon utilise dans le commerce.
![]()
[1]INALCO, Brochure pédagogique de lannée 1998-1999, Département de lAsie du Sud-Est, Haute Asie et Pacifique, p. 16
[2] Il y a des modifications des intitulés de cours, mais le contenu reste le même.
[3] JACOB J.-M., Introduction to cambodian, Orford University Press, London, 1968
[4]
Il existe par exemple les livres suivants :
- MARTINI F. Méthode de lecture et de transcription du cambodgien,
Librairie Orientaliste et Américaine, G.P. Maisonneuve, 2 livrets, Paris
1932-34. Cette méthode comprend des leçons de lecture simultanées en
caractère et en translitération accompagnées de listes de mots regroupés
daprès leurs sons et dun texte avec lexique.
- CAMBEFORT G.
Introduction au Cambodgien, G.P. Maisonneuve, Paris 1950
- LEWITZ S., Lectures cambodgiennes : notions succinctes, Librairie
dAmérique et dOrient, A. Maisonneuve, Paris, 1986
- DANIEL A., Lire et Ecrire le cambodgien : précis pédagogique raisonné
écrit et oral à lusage des étudiants non-khmérophones, Institut de
lAsie du Sud-Est, Paris, 1992
[5] DANIEL A., « Le cambodgien », dans Deux siècles dhistoire de lÉcole des langues orientales, Textes réunis par Pierre Labrousse, Editions Hervas, LanguesO, 1995, p. 260
[6] Voir 3.1. Un programme nouveau, p.22
[7] Voir le questionnaire et les réponses en annexe n° 1, pp. 76-101
[8]BERNARD S., « Le cambodgien à lÉcole Nationale des Langues Orientales Vivantes », dans Cent-cinquantenaire de lÉcole des langues orientales, Imprimerie nationale de France, Paris, 1948, p. 366
[9] Certains étudiants savent déjà parler un peu khmer, car leurs parents les obligent à le parler à la maison ; mais en général ils ne lécrivent ni ne le lisent. Ils sinscrivent à lINALCO pour combler cette lacune et ne pas se sentir gênés lorsque leurs amis français leur demandent sils maîtrisent bien le khmer.
[10] Le khmer est une des langues présentées au baccalauréat, ou une langue intégrée dans un cursus universitaire.
Parmi les difficultés rencontrées au cours de lenseignement et de lapprentissage de la langue et de la culture khmères, nous avons décidé de sélectionner celles qui paraissent pertinentes sur le plan linguistique (en phonétique et en syntaxe ) et sur le plan culturel.
Les réponses au questionnaire montrent que chez les étudiants dorigine non cambodgienne, la majorité a répondu quelle éprouvait des difficultés phonétiques. Celles-ci sont tout dabord pour quelques étudiants, le fait de prononcer les phrases avec un bon rythme, cest-à-dire faire ressortir lapostrophe khmer () qui rend la prononciation des mots qui les portent plus courte que celle des mots sans apostrophe. Une autre difficulté est dinsister sur la première partie dune voyelle diphtonguée , car cela ne va pas de soi en français. De plus, le fait de ne pas entendre la consonne finale pose aussi des problèmes, car quand les Khmers parlent, on nentend presque pas la consonne finale. Cest ainsi quen khmer, lorsquune consonne est en final dun mot, elle nest pas prononcée. Par exemple, le mot BUk[puk|] matelas, k[k] qui est précédé par la voyelle « U»[u] nest pas prononcé, il est simplement combiné avec [u] pour que ce [u] ne soit pas trop long. [k|] : le petit signe [|] après [k] montre que [k] nest pas prononcé. Quelques étudiants expliquent que certaines consonnes (nasales, sourdes et aspirées) sont très difficiles à prononcer parce qu'elles n'existent pas en français comme le g [N«ù], c [cù], C [c«ù] et en plus de ces consonnes sajoutent des souscrites et/ou dautres consonnes qui se suivent pour certains mots. La consonne r [r] présente une difficulté particulière pour trois étudiants. Enfin, les difficultés phonétiques pour trois autres étudiants sont les alternances et la distinction entre les consonnes aspirées et les consonnes non aspirées.
Par ailleurs, la prononciation des voyelles en fonction des différentes ouvertures pose également des problèmes pour quelques étudiants. En khmer, en effet, il y a 5 degrés douverture contre 4 seulement en français. De même que la durée démission des voyelles qui forment des voyelles longues et brèves et leur alternance sont une des difficultés phonétiques[1] pour deux étudiants. A ce sujet, en khmer la différence entre les voyelles longues et brèves est pertinente, car elle modifie complètement le sens des mots et lerreur demploi peut être lourde de conséquence. Par exemple, cab [cAùb] [moineau] et cab; [cab/] [saisir]. Une autre difficulté évidente pour deux étudiants est liée à linexistence de certaines voyelles (diphtonguées[2]) en français, à savoir la voyelle, W [Îù], eO [w«].
Pour deux étudiants, les accents français et les différents accents en khmer leur posent aussi des difficultés phonétiques, parce quils nosent pas mettre laccent où il faut et les multiples accents les perturbent.
Pour deux autres étudiants, la difficulté est la prononciation des mots dorigine savante empruntés au pâli et au sanscrit ; pour un étudiant, certains mots sont prononcés dune certaine façon par des Khmers de son entourage et à lécrit, leur transcription ne correspond pas à la prononciation.
En résumé, ces difficultés résultent des particularités de la langue khmer aussi bien dans les sons que dans les combinaisons des consonnes et des voyelles.
Quelques étudiants dorigine non cambodgienne néprouvent pas de difficultés phonétiques au cours de leur apprentissage du khmer : certains ont des amis khmers et ont pris lhabitude dentendre et de prononcer la langue bien avant de létudier. Cest pourquoi même sils ne comprennent pas, ils sont habitués à la sonorité du khmer. Dautres disent quils ont eu un bon apprentissage au départ, quils ont une assez bonne oreille musicale et une bonne mémoire.
La plupart des étudiants dorigine cambodgienne néprouvent pas de difficultés phonétiques. Cest évident. Ils sont habitués à entendre parler la langue dans leur entourage, les sons leurs sont donc familiers. De plus, dautres parlent le khmer à la maison ou ils le maîtrisent déjà.
Afin de vérifier les réponses du questionnaire , nous avons examiné également les enregistrements faits lors de lexamen oral du deuxième semestre. Les difficultés éprouvées dans le questionnaire sont ainsi confirmées.
Parmi les difficultés décrites ci-dessus, nous avons sélectionné les trois plus importantes. La première porte sur certaines consonnes nasales, sourdes et aspirées et les voyelles diphtonguées qui nexistent pas en français ; la deuxième concerne la durée démission des mots en fonction des voyelles et de lapostrophe khmère ; la troisième difficulté porte sur la consonne « r » [r] combinée avec dautre(s) consonne(s).
Nous reviendrons sur quelques points exposés ici dans la 3ème partie de ce travail. Nous proposerons des méthodes de correction phonétique qui pourraient être les remèdes à ces difficultés. (Voir 3.3.1. p. 22)
Presque tous les étudiants dorigine non cambodgienne et deux tiers des étudiants dorigine cambodgienne éprouvent des difficultés en syntaxe. Leurs difficultés sont diverses.
Dune part, pour quelques étudiants, la syntaxe khmère qui nest pas la même quen français ou en japonais, constitue une difficulté parce quils ont tendance à faire des phrases khmères sur le modèle des phrases françaises ou japonaises. Cette différence implique des difficultés à construire des phrases khmères correctes, soit en sachant placer les mots dans le bon ordre, utiliser les bons mots de liaison dans des phrases complexes. A cet égard, deux étudiants affirment que la syntaxe khmère étant très rigoureuse, le plus difficile est de savoir quand utiliser les petits mots quon retrouve souvent et où les placer dans la phrase.
Dautre part, pour quatre étudiants, la présence de nombreuses particules dans la syntaxe est une grande difficulté parce que parfois, elles sont mal définies et si nombreuses, quils ont du mal à les mémoriser. Un étudiant explique aussi quil a du mal avec lusage des particules selon quelles sont utilisées seules ou avec dautres groupes de mots.
En khmer, il ny a pas de conjugaison, aussi pour indiquer le temps, on ajoute des particules temporelles. La mémorisation de ces particules et le raisonnement chronologique dans la construction des phrases posent des problèmes supplémentaires.
Les éléments de la phrase comme les pronoms, les verbes, les auxiliaires, les adjectifs, les classificateurs, les mots ayant un sens générique et les mots dorigine savante constituent aussi des difficultés.
Deux étudiants ont des problèmes pour trouver le sujet de la phrase et pour utiliser le sujet lorsquil sagit de quelquun du même niveau social et du même âge. La place du pronom est un problème et la non-utilisation de pronom personnel en est un autre pour deux étudiants. Ces derniers expliquent aussi que la redondance verbale, la décomposition de certains verbes sont des difficultés dans lapprentissage du khmer. Il en va de même pour les auxiliaires.
Une autre difficulté pour deux étudiants est la place des adjectifs, surtout quand il en y a plusieurs pour un seul nom par exemple : en français, « une jolie petite maison neuve ».
Dailleurs, lemploi des classificateurs qui est systématique en khmer, nest pas évident pour deux étudiants dont lun ne sait pas faire la différence entre les classificateurs et les mots ayant un sens générique.
La grande variété des mots dorigine savante empruntés au pâli et au sanscrit présente des difficultés particulières pour un étudiant. Deux autres soulignent également quune des difficultés dans lapprentissage de la syntaxe khmère est la grande différence entre la langue parlée et la langue écrite[3].
En ce qui concerne les étudiants qui néprouvent pas de difficultés en syntaxe, cela sexplique de différentes manières : ceux qui sont dorigine cambodgienne maîtrisent déjà la langue et ils la parlent à la maison. Un étudiant dorigine non cambodgienne explique quil est déjà habitué avec le chinois à une syntaxe très différente des langues européennes ; de plus, selon lui, il y a beaucoup de similitudes entre les syntaxes chinoise et khmère.
Après avoir examiné les copies dexamen, nous avons constaté que les difficultés exposées ci-dessus se confirmaient.
Parmi ces problèmes, nous allons choisir les trois plus courantes pour les apprenants francophones : lordre des mots dans le groupe nominal, les particules de temps et lemploi des verbes.
Ces quelques points seront à nouveau examinés dans la 3ème partie de ce travail (voir 3.3.2 p.22). Nous suggérerons alors des méthodes de corrections syntaxiques comme remède à ces différents problèmes.
Comme nous lavons noté, les méthodes et les techniques denseignement sont très traditionnelles : utilisation systématique de la langue maternelle (L1), étude de nombreux contes, dextraits duvres littéraires et de romans contemporains. Nous avons constaté que la culture courante et en particulier, les spécificités culturelles semblaient un peu négligées dans lenseignement. Nous avons fait des hypothèses dans ce sens et nous les avons vérifiées au travers de notre questionnaire.
Plusieurs remarques sont faites par les étudiants qui sont déjà allés au Cambodge. Parmi celles-ci, les étudiants dorigine non cambodgienne ont retenu le sourire, la pudeur, la réserve, la modestie, la violence rentrée ou au contraire, le manque dintériorisation des sentiments, la façon détablir la communication et le « oui » même quand on pense « non ». Par ailleurs, ce qui a frappé les étudiants dorigine cambodgienne, est pour lun dentre eux que « les Khmers nous[4] regardent avec rancur car pour eux, nous sommes des privilégiés ». Les autres ont observé lhostilité envers les Cambodgiens de létranger, la crainte, la peur, limportance de la famille et le respect des personnes âgées qui les frappent.
Ce qui leur paraît particulièrement différent de la culture française et/ou de ce qui se passe en France, ce sont du côté des étudiants dorigine non cambodgienne, que tout dabord, les Khmers utilisent plus le langage extra-verbal que les Français, ensuite, la sagesse dans une gestion et une conception du temps, de lespace, du travail[5], la façon de concevoir les relations, de se comporter, les rapports entre les gens, la prépondérance du groupe sur lindividu, le fait quils disent « oui » tout le temps même sils ne comprennent pas. Et aussi, labsence dune pensée conceptuelle, la place laissée à lintuition, la très grande place des sentiments interpersonnels, la notion de respect lié à lâge, la place immense de la famille , lamour de la fête. Par ailleurs, la façon de vivre, le rythme de vie, lhabitat, larchitecture, lalimentation, le deuil, la prépondérance des coutumes rend les comportements choquants et traditionnels ; les niveaux de langage, le comportement en présence dautrui, les conventions sociales et familiales et la vie religieuse et culturelle sont également des sujets détonnement. Enfin, les influences religieuses si différentes, labsence de notion de péché, de châtiment dans le bouddhisme, lidée de synthèse moins perceptible dans le raisonnement cambodgien.
Les étudiants dorigine cambodgienne affirment que les Cambodgiens du Cambodge sont beaucoup plus accueillants, souriants, aimables et attachants que les Français (la vie est beaucoup plus simple, les murs ne sont pas les mêmes, le niveau de vie est différent, les gens sont plus attachés aux traditions quau modernisme, les gens les regardent comme des étrangers et ne comprennent pas la mentalité des nouvelles générations asiatiques qui vivent en France).
Cependant, une partie des étudiants ayant rempli le questionnaire fait remarquer quils nont pas été étonnés par les manières dagir et les comportements des Cambodgiens. Et pour cause, certains étudiants dorigine cambodgienne ont vécu pendant un certain temps au Cambodge ; ils étaient donc déjà imprégnés de culture khmère ou connaissaient déjà la culture et les murs cambodgiennes par leurs parents. Les étudiants dorigine non cambodgienne ont répondu quils sétaient préparés à la différence entre les deux cultures. Un étudiant a affirmé quétant ouvert aux autres cultures, létonnement devient une richesse. Un autre ayant déjà lu des livres sur la culture khmère na pas été surpris par les différences observées. Enfin, un autre étudiant a expliqué que toute culture étant différente, elle induit nécessairement des étonnements.
Concernant les spécificités culturelles de type extra-verbal (la gestuelle, les comportements, etc.) et de type verbal (salutations différentes en fonction de linterlocuteur, différences dans les remerciements, etc.), tous les étudiants questionnés ont répondu quil serait intéressant de les étudier. Quant à la question permettant de savoir si ces spécificités culturelles sont suffisamment étudiées en cours, deux tiers des étudiants questionnés ont répondu négativement. Ils souhaitent quelles soient abordées sous la forme de documentaires de télévision, de films de réalisateurs cambodgiens, dinformations télévisées, darticles de journaux et sous dautres formes. Ces dernières sont les activités en classe (jeux de rôle, mise en situation, discussion), rencontres dans le milieu khmer, analyses des légendes ou des contes pour enfants ayant pour but linitiation à linterculturel, analyses des manuels scolaires, rencontres avec des intervenants cambodgiens et exploitations de publicités en cambodgien.
Un tiers pense que les spécificités culturelles sont suffisamment étudiées en cours. Il est vrai que traditionnellement au travers dexplications de textes, de contes et dextraits duvres littéraires, une partie des spécificités ci-dessus est enseignée. Notons dautre part que le lecteur de khmer a introduit depuis 1997 des pratiques nouvelles[6] visant à sensibiliser les étudiants à la culture comportementale cambodgienne.
Nous allons rendre compte de quelques difficultés culturelles liés aux comportements psychosociaux et à la lexiculture en analysant une chanson .
La conduite du dialogue est différente dune société à lautre ou dune culture à lautre. Celle-ci est due aux « règles et aux principes qui sous-tendent le fonctionnement des conversations, et plus généralement, des différents types déchanges communicatifs qui sobservent dans la vie quotidienne »[7]. Chaque culture possède ses propres règles. Cela constitue des difficultés lors de lapprentissage dune langue et dune culture étrangères.
Les étudiants de khmer de lInalco, quils soient ou non déjà allés au Cambodge, sont confrontés à des différences considérables au cours de la conduite dun dialogue.
Au Cambodge, quand on parle de conduite, on expose avant toute chose, les c,ab; [cbab] « codes de conduite khmer », les Rkm [krùm] « code de civilités » tels que c,ab;Rbus [cbab| proh] « morale des garçons », c,ab;RsI [cbab| srei] « morale des filles », etc. Nourris depuis leur enfance de ces formules qui mêlent les préceptes du bouddhisme aux prescriptions du formalisme traditionnel, les Cambodgiens y trouvent des règles de conduite pour les diverses circonstances de la vie.[8]
Parmi ces règles, la conduite du dialogue a une place importante, comme nous allons le voir en présentant quelques approches verbales et non-verbales.
Dans la culture khmère, quand deux personnes se rencontrent, elles ne se serrent pas la main, elles ne se font pas la bise non plus comme les Français, mais elles se saluent en plaçant les paumes à plat lune contre lautre (sMBH [sAmpeah]) et en les levant à une hauteur différente suivant le rang de la personne. Cette élévation va de la poitrine au front. Des mots tels que CMrabsYr [cumri«p su«] « bonjour » accompagnent ce geste. Après le SAmpeah et Cumri«p Su«, les expressions courantes suivantes sont prononcées pour engager la conversation :
+ Gñksuxsb,ayCaeT ? [nak sok sabaj ci« te ? » littéralement : « Etes-vous paisible et heureux ? », mais pouvant se traduire par « comment allez-vous ? ou
+ Ég man RKYsar ehIy b¤ enA ? [/ENmi«n kru« saù ha«j r®ù n«®] « Es-tu marié ? »
+ Ég man kUn ecA b:unµan ehIy ? [/EN mi«n kon ca® pùnman ha«j] « Combien avez-vous denfants et de petits-enfants ? ».
Ces deux phrases étonnent un peu les Occidentaux.
Une telle adresse sexplique, disent les vieux, par les traumatismes de lHistoire. Au cours des siècles, chaque famille a connu la mort violente, que ce soit à cause des relations houleuses entretenues avec les pays voisins ou à cause des folies politiques des dirigeants. Les khmers ont été et se sont exterminés. Les survivants sinterrogent sur leur descendance et la survie de leur race.
De plus, avant dengager une conversation, les femmes comme les hommes ont coutume de se découvrir la tête devant un supérieur, ce qui le plus souvent consiste à enlever le Rkma [krùma] « écharpe cambodgienne », parfois le chapeau, qui protège du soleil.
Par ailleurs, dans la société cambodgienne, chacun occupe une place en fonction de son âge et de ses caractéristiques. Les pronoms personnels étant inexistants, chacun se désigne et désigne son interlocuteur par un appellatif : « enfant », « père », « mère », « oncle cadet des parents », « oncle aîné des parents », « sage », « puissance-bénédiction », etc. (voir 2.2.2.2. p.22). Ces différents appellatifs soulignent les liens de sang, lâge, le rang social, la qualité de la personne qui parle et celle de son interlocuteur. Cet ensemble de termes est utilisé pour signifier le respect.[9]
Lutilisation de « oui » et de « non » par les Khmers pose des problèmes chez les étudiants de khmer de lInalco.
La langue khmère na pas, à proprement parler de mot signifiant « oui ». Le mot utilisé se traduit littéralement par « plante des pieds » pour les hommes, « Maître » pour les femmes. Cest plus une formule de politesse signifiant « oui, je vous écoute » quun acquiescement. Celui qui parle peut dailleurs intercaler ces mots, )aT [baùt|] pour homme, cas [cah] pour femme, dans son discours, un peu comme « nest-ce pas » en français. Ce mot peut être couplé avec eT [te] « non » pour exprimer une négation polie. Pour exprimer un véritable acquiescement, le Khmer répétera le mot important de la question ou une partie de la phrase. A linterrogation : « Veux-tu aller au marché ? » il répondra )aT [baùt|] « oui, je veux » ou )aT eT [baùt| te] « oui, non » pour une réponse négative.
Parmi les principes essentiels de la politesse khmère , nous en citons un qui est « ne pas refuser ce quon vous offre ». Cela induit que les Khmers répondent rarement « non » à une invitation.
A ce propos, Sun Hyo-Sook montre que, pour les Coréens, le « oui » (que lon peut considérer comme une prophrase) qui est soit la réponse à une question, soit la manifestation dun accord avec lénoncé précédent de linterlocuteur, est soutenu par lintercalation du terme ou de lexpression qui le suit[10].
Quant à D. Bertrand, il explique les malentendus qui peuvent en découler dans une situation de communication avec des Vietnamiens ou des Asiatiques en général : « Nous avons appris ( ) quil était très malséant de dire non ( ). Le oui, en fait, est seulement une sorte daccusé de réception qui signifie : je vous ai entendu, mais non lacquiescement à une proposition »[11]. Ces remarques semblent sappliquer au contexte cambodgien.
Lharmonie est une notion centrale des rapports interpersonnels au Cambodge. Il est important que chacun reste à sa place. En effet, il est déconseillé de se singulariser. Dans ce contexte, il est nécessaire avant tout dagir, non pas en fonction de soi, mais par rapport à ce que lautre attend de nous. Ainsi, avant de parler, chacun évalue son interlocuteur. Par exemple, un inférieur hiérarchique observe son supérieur avant de sexprimer, de façon à aller dans le sens de ce dernier. « On a toujours peur de lopinion et du regard de lautre, surtout du plus « grand » que soi. Il faut à tout prix passer inaperçu, sans se singulariser. »[12]
Ces idées sont partagées par Marie-Alexandrie Martin selon laquelle chez les Khmers seffacer devant le groupe et adopter une attitude de modestie lorsquon a réussi socialement, est constant. Le type de comportement valorisé est celui du « GñkCYr [ni«k cu«], « celui qui est dans le rang »[13].
Jacques Népote, pour sa part, explique que le statut personnel chez les Khmers au travers dune identité collective se traduit par un usage répandu du eyIg [jON] « nous ». Parlant deux-mêmes, les Khmers disent ExµreyIg [kHE jPN] « nous les Khmers ». Dans certaines conversations, cette expression est utilisée très souvent, ce qui rappelle les incantations. Cette pratique est culturellement marquée. Cest une façon polie de ne pas se singulariser vis-à-vis du groupe dans lequel on se trouve.
A ce propos, S. LEWITZ explique que lassociation du « nous » avec le « je » a conduit à la création dun nouveau pronom personnel eyIg´ [jON kHøom] « nous je », au sens plus précis de nous. De nos jours, cette expression sera utilisée, par exemple, dans les publicités, pour vanter la qualité dun service. Mais « la dynamique culturelle va plus loin et potentiellement, lindividu nexprime plus quune volonté collective. »[14]
De fait, une bonne part des pronoms personnels du Khmer fait référence à un groupe précis comme le souligne S. POU (1979) :
« Danciens noms communs [ ] ont servi à développer la liste des pronoms : ce qui, daprès les textes, semble répondre à un besoin accru de nuancer la pensée. [ ] Les Khmers semblent soucieux de pousser très loin lanalyse des groupements humains, de leurs rapports entre eux, et celles des rapports dindividus entre eux dans chaque groupe. Le statut dindividu est défini par le groupe social auquel il appartient [ ]. Ainsi certains termes sont danciens noms désignant des groupes humains, qui ont pris une valeur partitive ».[15]
Elle cite ainsi « les gens », « le monde », « le groupe », etc., ainsi que le cas de ces pronoms personnels composés utilisés par les personnes dun rang hiérarchique élevé, dont le sémantisme véhicule une part de responsabilité. Ces pronoms traduisent la structure de la société cambodgienne qui fonctionne au travers dun système hiérarchique strict.
Par ailleurs, Sun Hyi-Sook analyse dans un article paru dans la revue LIDIL la recherche du consensus et le refus de toute formulation pouvant déboucher sur un conflit relationnel entre un Coréen et un Français[16]. Ses remarques nous semblent sappliquer aux échanges entre Cambodgiens et Français.
La recherche du consensus a non seulement pour rôle déviter les conflits, mais également déviter de faire perdre la face, une notion omniprésente dans la société asiatique[17].
Parmi les termes dauto-désignation , les Khmers emploient des appellatifs : chacun se situe par rapport à lautre, souvent en sabaissant, parfois en abaissant lautre pour manifester du mépris ou de la colère.
Un des termes utilisés est ´ [kHøom]. Il est la forme unique que lon peut rapidement traduire par « je, moi, mon, ma, mes » en français, mais aussi par :
´ [kHøom] « serviteur » dans une conversation avec un étranger.
´)aT [kHøom baùt] « serviteur-plante-des-pieds » pour honorer quelquun dimportant.
´RBHkruNa [kHøom prahkar«na] « seviteur-compassion » lorsque lon sadresse à un bonze.
« serviteur portant sur sa tête la divine adoration sous la poussière la plus fine des augustes pieds de Monseigneur Maître », pour sadresser au roi.
Mais, il existe aussi des termes de parenté comme :
bg [bùN]« aîné » si lon est le cadet, la fiancée ou la femme du locuteur.
b¥Ún ou GUn [pHù/on /on] « cadet » si lon parle à son aîné, à son fiancé ou à son mari.
kUn [kon|] « enfant », ecA [ca®] « petit enfant », kµÜy [kHmu«j] « neveu », si lon parle à ses parents, grand-parents, oncles, tantes, personnes plus anciennes.
ta ou CIta [ta ou cita] « grand-père », yay ou CIdUn [ji«j ou cidon|] « grand-mère », Buk ou )a: [puk ou pa] « père », Em: ou m:ak; [mE ou mak] « mère »[18], BU ou G¿[pou ou /om] « oncle cadet ou aîné des parents », mIg ou G¿ [miNou/om] « tante cadette ou aînée des parents » si lon parle à ses petits-enfants, enfants, neveux, nièces.
Gj [/aN|] quand on sadresse à des enfants, quand on est en colère, que lon insulte autrui.
A ce sujet, il convient de faire attention à lusage du tutoiement. Le Khmer ressentira la relation « je-tu » comme celle du « /aN|-/aEN », où la personne tutoyée est placée à un rang inférieur. Cest une expression de mépris. Même des amis se tutoient rarement en public.
Dautre part, la notion de hiérarchie est très importante dans la société khmère . Dans la vie quotidienne, de nombreux titres sont utilisés pour sadresser à linterlocuteur. Ces titres définissent le statut et la place du locuteur dans le rang et la hiérarchie sociale. Chaque interlocuteur doit en tenir compte, il ne faut en aucun cas passer au-delà, car cela risquerait de causer quelques incidents (perte de face, par exemple). Ainsi, dans une réunion, un débat, chacun doit attendre son tour.
Pour marquer la hiérarchie, citons les titres les plus courants :
elak [lok] est équivalent à « monsieur » en français, elakRsI [lok srei] « madame », nagkBaØa [ni«N kaøa] « mademoiselle » ; semþc [samdec] est un titre royal équivalent à « monseigneur », Ék]tþm [Ek udom] titre ministériel, « votre excellence » (le féminin étant elakCMTav [lok com ti«B), GñkGgÁm©as; [neak /aN mcah] est un terme dadresse utilisé pour les membres de la famille royale, qui sera traduit par « altesse ».
En famille, on utilise les termes suivants :
- Pour le maître de maison, elakRbus [lok proh] sans nom de famille
- Pour la maîtresse de maison, GñkRsI ou elakRsI [neak srei ou lok srei], sans nom de famille
- Le fils est nommé GñkRbus [neak proh], la fille Gñknag [neak ni«N]
- Les amis sont appelés par leur prénom ou bien par lonomatopée « a », équivalent du « tu ».
- On sadresse aux bonzes à laide de lexpression etCKuN [dekun]. [dekun] peut être utilisé également par des domestiques sadressant à leur maître. Les bonzes sadressent aux laïcs en employant ej:am [øom|].
Les nombreux termes dauto-désignation et de titres présentés constituent de grands problèmes pour les apprenants francophones et mettent en cause, en outre, la notion de personne , car on nutilise pas un même pronom personnel en loccurrence « je » en français pour sauto-désigner. Le « je » des judéo-chrétiens est un « je » unique pour tout le monde, quel que soit son rang. Mais, linguistiquement, il nexiste pas de mot khmer pour identifier la notion de personne. Les lexicographes ont donc dû fabriquer, à partir du pâli, des néologismes dont le nombre atteste lincertain statut linguistique de ce terme (la plupart ne figure même pas dans le vocabulaire khmer).
Lindividualité est à peu près inconnue pour les Khmers du fait quils fonctionnent avec une autre notion qui est celle de famille. A ce propos, J. Népote affirme que :
« la famille constitue le lieu affectif privilégié de la sensibilité khmère. Au-delà du comportement individuel du Khmer pour qui la grande affaire est sa vie de famille , il faut surtout souligner la résonance culturelle exceptionnelle que suscite ce sentiment. »[19]
Cette sensibilité à la famille est tellement importante que psychologiquement et culturellement, il est impossible pour lindividu de vivre normalement hors de sa famille . Cest ainsi que le type du « Renonçant », qui est pourtant lun des éléments-clés de la pensée indienne, est à peu près inconnu au Cambodge. Néanmoins, tout cela ne veut pas dire quil ne soit pas possible dêtre soi-même au Cambodge, mais le canal dexpression de cette individualité est la famille . « Le type social si valorisé dans nos sociétés occidentales du self made man est un non sens culturel au Cambodge où lon est toujours endetté de sa vie, de ses talents, de son savoir, de son pouvoir enfin, auprès de ses parents, de ses maîtres, de ses patrons, de ses supérieurs ou des génies. »[20].
La famille est un segment de la société dans laquelle lordre social est central et dont les valeurs fondamentales sont la confiance et la permanence. Il sagit alors dun seul ensemble qui se serre durablement les coudes en cas dadversité. Quand lun de ses membres dévie du droit chemin, le groupe sarrangera pour trouver en lui-même les moyens de réharmoniser les choses. Ainsi,
« La société khmère nest point tant, culturellement parlant, composée dindividus que de familles. On comprendra au passage toute labsurdité quil y a à vouloir imposer des pratiques « démocratiques » reposant sur la notion dindividu dans cette société. Cest là une autre forme ( ) de colonisation culturelle dont on peut se demander si elle est plus le fruit dun machiavélisme occidental que le fruit dun européocentrisme progressiste à courte-vue. »[21].
Enfin, un autre aspect concernant la notion de personne est le nom. Dans la société khmère, un nom personnel est attribué à lenfant dès sa naissance par la famille . Il sagit généralement dun nom commun dépréciatif dans le but préventif de ne pas attirer lattention des esprits « mauvais ». Ces « prénoms », le plus souvent monosyllabiques, applicables indifféremment aux deux sexes, sont loin de caractériser la personne pendant toute son existence. Quun incident survienne (maladie, changement de village, fuite devant les dettes, etc.), le Khmer aussi bien enfant quadulte en changera. A ce propos, F. Ponchaud explique que « De tout temps, les Khmers changeaient volontiers de nom, un enfant malade prenait le nom de « Chéa » qui signifie « guéri » afin de déjouer les influences maléfiques des esprits ».[22]
En ce qui concerne le nom de famille , G. Martel[23] a mené une étude en 1962 sur les habitants du village Lovéa qui sont très peu touchés par la civilisation occidentale. Elle explique que lusage de donner un nom qui se perpétue de génération en génération, condition nécessaire pour tenir un état civil, nexiste pas. La notion même de nom de famille , telle que les Occidentaux la conçoivent est étrangère à la culture khmère et a été, difficilement, imposée par le Protectorat français (1863-1953). Dans la société traditionnelle et jusquen 1860 environ, les gens portaient un nom unique composé dune seule syllabe. Sils devenaient de grands personnages, le roi leur accordait lhonneur et la distinction de faire précéder ce nom par un autre nom, en général un titre, qui devenait leur nom de famille . Ceux qui ont fait des études, avaient une vie sainte, un poste de fonctionnaire et qui voulaient se distinguer de la masse paysanne prirent lhabitude de porter des noms multisyllabiques.
La politesse sociale, dans les situations de représentation, exige lemploi du titre suivi du nom et du prénom ou suivi du prénom seulement. Cette dernière combinaison est différente de la politesse occidentale qui exige lemploi du titre et du nom de famille .
Les difficultés dordre culturel rencontrées au cours de lapprentissage dune langue étrangère sont très variées. Parmi celles-ci, la valeur culturelle ajoutée au lexique de la langue apprise reste peu accessible aux étudiants. Nous pensons que lutilisation de la chanson est un moyen dy accéder.
En effet, la chanson quelle que soit lévocation qui en est faite, offre toujours quelques images de la société. Sa mélodie, son rythme et son contenu reflètent lesprit de la société dans laquelle elle a été composée. Ainsi, les idées quelle transmet rappellent le type de culture à laquelle elle appartient. Même si certains sujets sont universels (le thème de lamour), suivant le lieu et/ou lépoque, ils ne seront pas abordés de la même façon.
La chanson est par conséquent le reflet de la société. Elle traduit lévolution sociale et les différents changements qui peuvent avoir lieu.
La chanson véhicule les aspects culturels et son utilisation en classe permet aux apprenants de les aborder de manière divertissante. Elle est le lieu où sactualisent des implicites culturels. Ses paroles reflètent une certaine réalité ou une part de rêve partagées par la communauté à laquelle lauditeur appartient. Elle est donc « lexpression dune vision du monde singulière, proposée, sinon imposée, par une mentalité collective fonctionnant à la manière dun inconscient social extrêmement puissant, construit au fil de lhistoire dun peuple »[24]. Sa charge « connotative » est très importante. Comme la poésie, elle est le fruit dinterprétations diverses. Cest pourquoi, chacun la perçoit en fonction de son propre vécu.
Nous avons expérimenté avec les étudiants de 3ème et 4ème années de khmer lutilisation dune chanson datant des années 60 intitulée en français : « Veuf sans avoir été marié »[25] de Sin Sisamut, le chanteur le plus connu dans le monde de la chanson khmère. Cette chanson présente pour les étudiants un grand intérêt non seulement à cause de la diversité du vocabulaire, mais aussi à cause des multiples allusions qui sont faites à des faits culturels.
Pour les étudiants francophones de khmer, le titre de la chanson est déjà révélateur de la culture khmère.
Nous avons choisi la chanson dont le thème porte sur le mariage , parce que dans toutes les cultures, on retrouve le mariage. Ce dernier est plus ou moins important dune société à lautre et dune tradition à lautre. Au Cambodge, cest une institution très importante. En effet, traditionnellement, les Cambodgiens qui vivent en union libre sont dune part mal considérés par leurs familles et leur entourage et se sentent, par conséquent, mis au ban de la société. Dautre part, les enfants nés hors mariage sont considérés comme illégitimes.
Au Cambodge, le mariage se déroule toujours en présence dun très grand nombre de personnes. En effet, les invités sont considérés comme témoins du mariage ; plus il y a dinvités, meilleure est lambiance et plus il y a de participants pour se partager les frais du banquet[26] comme cest la coutume au Cambodge.
Il est à rappeler quavant de travailler cette chanson, nous avons demandé à un ou deux étudiants de faire un exposé sur le mariage khmer. Les étudiants sont sensés être au courant des différentes cérémonies traditionnelles et religieuses du mariage. Savoir tout cela au préalable est indispensable pour la compréhension de la chanson.
Par ailleurs, il sagit dun texte dont le style est extrêmement recherché : le pronom sujet est quasiment absent et chaque couplet commence par un verbe.
Lors de la première écoute, les étudiants nont pratiquement rien compris, ils ont retenu seulement quelques mots déjà rencontrés. A la deuxième écoute, ils ont pu comprendre globalement de quoi il sagissait.
Daprès eux, les difficultés sont diverses : dune part, ils nont pas dhabitude découter des chansons khmères, ce qui leur demande un grand effort pour essayer de comprendre ; dautre part, le plus difficile est le vocabulaire.
Cette chanson comporte de nombreux mots à charge culturelle partagée :
Veuf sans avoir été marié
Dans les formulaires administratifs, par exemple dans celui de demande de visa, la rubrique de situation de famille propose plusieurs mots du même champ lexical, à savoir, célibataire, marié(e), divorcé(e), veuf(ve), etc. Pour ce micro-système lexical, quand un mot est choisi, les autres sont donc exclus. Pourtant, le terme « veuf(ve) » na pas la même acception dune culture à lautre. Dans la culture française, daprès le dictionnaire le Petit Robert, le mot désigne une personne dont le conjoint est mort. Mais, dans la langue et dans la culture khmères, le terme veuf(ve) désigne à la fois, la personne dont le conjoint est mort, les divorcés et les fiancés qui nont pas pu se marier à cause de la mort de lun des deux dans la période située entre les fiançailles et le mariage . Normalement, les cérémonies de mariage ont lieu quelques mois après les fiançailles.
La tente
Puisque le Cambodge pratique le régime matriarcal, les cérémonies du mariage ont toujours lieu chez la mariée. La maison de la mariée ne peut pas recevoir tous les invités aux différentes cérémonies. Une tente provisoire mais de très grande taille est alors montée pour accueillir ces personnes lors du banquet de noce.
Les invités, les invitations au mariage
Etant donné que les invités sont considérés comme témoins du mariage, les familles des mariés invitent non seulement leurs proches, mais aussi quasiment toutes les personnes de leur entourage quelles connaissent pourtant plus ou moins bien.
Le jour où le cortège apporte la dot
Au début du siècle, le mariage traditionnel au Cambodge durait sept jours. Par la suite, il fut réduit à trois jours. Ainsi les cérémonies étaient réparties selon le nombre de jours et étaient célébrées selon un rituel qui respectait la liturgie traditionnelle. Cest la raison pour lesquelles, dans la chanson , on utilisait le terme « jour » au lieu de « cérémonie ». Mais, depuis 1970, pour des raisons économiques, il ne dure plus quun jour. Les cérémonies traditionnelles sont donc raccourcies.
Le jour du mariage, le marié va chez la mariée. Il tient à la main des fleurs daréquier et est accompagné par un long cortège conduit par un achar, maître des cérémonies. Le cortège est composé des garçons et des enfants dhonneur, des parents et des invités proches. Ces derniers portent des gâteaux, des fruits, des boissons, etc. Puis, la mariée accueille le marié devant la porte de chez elle pendant que lachar sonne les trois coups de gong traditionnels. La mariée met une guirlande de fleurs embaumées au cou du marié. Ensuite, tous les deux entrent dans la maison de la mariée, suivis des gens du cortège.
Le jour de la cérémonie du lancer des fleurs darequier
Après que les parents, les oncles, les tantes, etc., ont noué des bracelets de fils aux poignets des mariés, cest la cérémonie du lancer des fleurs darequier : lachar détache les deux bouquets de fleurs daréquier et les distribue à toute lassistance qui les jette sur les mariés en formulant des vux de bonheur.
Rembourser le prix de la dot
Selon le régime matriarcal au Cambodge, lhomme ou la famille du garçon, après avoir demandé la main de la jeune fille, offre une dot à sa famille. Entre les fiançailles et le jour de mariage, il est possible que la famille de la fille rembourse la dot sil y a un problème quelconque.
Crématorium : bouddhisme, brûler les cadavres
Les Khmers pratiquent quasiment tous le bouddhisme du Petit Véhicule. Dans cette religion, après la mort, les défunts sont emmenés au crématorium qui se trouve dans lenceinte dune pagode. Une fois la crémation achevée, un achar[27] recueille les ossements résiduels. Ils sont lavés avec du jus de noix de coco, puis enveloppés dans un tissu blanc et enfermés dans un urne surmontée dun couvercle. Lurne est ensuite placée sur lautel des ancêtres. Celui-ci contient au moins une photo de la personne disparue.
Bien que tous ces mots aient été expliqués, les étudiants ne sont pas sûrs de bien comprendre cette chanson . Cela est dû dune part, à lhistoire de cette chanson qui est assez compliquée et dautre part, aux métaphores utilisées qui ne sont pas vraiment faciles à comprendre.
Nous ne nous y attardons pas. Cependant, nous tentons de dégager son sens global de façon que les étudiants aient une idée de ce dont il sagit.
Nous poursuivons notre travail par lanalyse de cette chanson . La dimension culturelle (aspect « connotatif ») est parallèlement présentée.
Le premier couplet introduit la thèse de la chanson . Cette thèse pose le problème dun mariage fondé sur largent. Les valeurs telles que lhonneur sont mises à lécart et même bafouées. Il y est donc mis en relief certains aspects de la société cambodgienne dans laquelle, aujourdhui encore, le mariage arrangé est répandu.
Dans les deuxième et troisième couplets, il est question des cérémonies de mariage. Celles-ci sont illustrées au travers de mots-clés comme cortège, dot, fleurs daréquier. Un coup de théâtre intervient au milieu du troisième couplet. Le mariage est interrompu en pleine cérémonie : la famille de la mariée revient sur sa décision (elle rembourse la dot).
Le dernier couplet peut sinterpréter de deux façons différentes. Dune part, sous prétexte que la mariée est morte, le prétendant est présenté comme « Veuf sans avoir été marié ». Dautre part, on met en parallèle les deux dernières propositions. Dans chacune delle, un acte contradictoire survient. Premièrement, le cercueil arrive au crématorium, mais il nest pas brûlé. De même que le cadavre est « ramené intact ». Cest le dénouement de cette histoire dans laquelle le marié se rend compte quil a été dupé. Aussi sinterroge-t-il sur le mariage et sur ses implications financières, ce qui nous ramène au premier couplet. La thèse qui y est exposée appelle une conclusion que chaque auditeur pourra tirer en fonction de sa propre expérience, de sa propre perception[28].
Devant la richesse des particularités de la langue khmère, tant sur le plan phonétique que sur celui du système décriture, nous avions imaginé que les étudiants rencontreraient de très nombreuses difficultés au cours de leur apprentissage. Cependant, après avoir enseigné le khmer pendant deux ans à lInalco, nous nous sommes aperçu que, outre des difficultés inhérentes à la structure de la langue, dautres venaient sajouter dont lexistence était due à des questions de programme et de méthodes denseignement .
Nous avons constaté dans la première partie de ce travail que le programme des cours comportait des faiblesses. Les objectifs paraissent et la progression semblent vague. Les techniques denseignement sont traditionnelles. En effet, il est systématiquement fait recours à la L1. Enfin, aucun manuel de base nexiste pour les niveaux débutant et intermédiaire.
A partir de ces constatations, nous avons essayé de formuler et de proposer un programme denseignement du khmer intitulé programme nouveau dans lequel nous suggérons des objectifs utilitaires, permettant daccéder à une compétence de communication (orale et/ou écrite), à la culture courante et à une dimension interculturelle. Ce programme nouveau propose une progression ou une ligne directrice comme la progression du manuel de français Archipel, méthode à lapproche communicative, avec laquelle les enseignants sont libres de commencer par nimporte quelle unité sans pour autant sortir des objectifs définis. Quand les objectifs sont bien définis, la coordination sétablit alors plus facilement entre les enseignants. Cela assure donc de procéder par étapes dans lacquisition des connaissances par les élèves qui auront ainsi moins de difficulté pour sauto-évaluer.
Le programme nouveau propose également des techniques denseignement adéquates, non traditionnelles (on ne recourra pas à la traduction systématique). Ces techniques denseignement sinscrivent dans lapproche communicative : la langue maternelle nest ni systématiquement écartée, ni systématiquement utilisée ; « lalternance codique » est occasionnelle. Ces techniques[29] sont adaptées par les enseignants pour atteindre les objectifs déterminés (voir 3.2. p.22).
Le contenu de ce programme nouveau est présenté comme dans le tableau suivant. Nous développerons ultérieurement les objectifs qui y sont présentés.
![]()
[1] Rappelons quen français, les voyelles sont ordinairement brèves.
[2]Phonétiquement, on distingue les voyelles monotongues, cest-à-dire celles dont le timbre reste le même pendant toute la durée de lémission, et les diphtongues, celles qui changent de timbre au cours de lémission par suite dun changement de position des organes vocaux. Les diphtongues cambodgiennes sont normalement longues, leur attaque est fortement marquée, et leur finale nest que faiblement prononcée.
[3] Cette opposition est souvent ressentie comme telle par beaucoup de personnes. Il s'agit d'une opposition entre une langue soutenue, de construction solide, mais alourdie par une surabondance de termes d'introduction récente, qui est celle de l'administration, de la politique ou de la presse, par opposition à la langue courante, concise, rapide, qui fait l'économie des éléments relationnels.
[4] Les Khmers de la diaspora.
[5] Un étudiant fait la citation suivante : « petit grain deviendra grand ».
[6] Jeux de rôle, exploitation de documents vidéo khmers.
[7] KERBRAT-ORECCHIONI C. Les interactions verbales, Tome III, Armond Colin, Paris, 1994, p. 7
[8] Cf. COEDES G., Les peuples de la péninsule indochinoise, cité par J. ROUER, op. cit.
[9] Voir PONCHAUD F., Cambodge, année zéro, Julliard, Paris, 1977, pp. 153-172
[10] SUN H.-S., « Le français, outils de communication pour les sujets coréens en situations exolingue », in LIDIL n °5 : lapprenant asiatique face aux langues étrangères, Univ. Stendhal, Grenoble, 1992, p. 46
[11] BERTRAND D., « Analyses de situation de communication avec des Vietnamiens », in Intercultures, n° 15, octobre 1991, p. 83
[12] PONCHAUD F., « Elections et société khmère », in Les Cambodgiens face à eux-mêmes, Dossier pour un débat , Fondation pour le progrès de lhomme, n° 4, 1993, p. 146
[13] MARTIN M.-A., Le mal cambodgien, Histoire dune société traditionnelle face à ses leaders politiques 1946-87, Hachette, Paris (Histoire des gens), 1989, p. 27, cité dans NEPOTE J., Parenté et organisation sociale dans le Cambodge moderne et contemporain : quelques aspects et quelques applications du modèle les régissant, Ed. Olizane, Genève, 1992
[14] NEPOTE J., 1992, op. cit. pp. 13-14
[15] id. p. 14
[16] SUN H.-S., 1992, op. cit. pp. 31-66
[17] Cf. GOFFMAN E., La mise en scène de la vie quotidienne, 1. La présentation de soi, Les Editions de Minuit, Paris, 1973, p. 64
[18] Les enfants sadressent aux parents avec les expressions )a: [pa] « papa » ou m:ak; [mak] « maman » sils sont citadins, Buk [puk] et Em: [mE] sils sont villageois.
[19] NEPOTE J., 1992, op. cit. p. 111
[20] id. p. 112
[21] ibid. p.116
[22] PONCHAUD F., 1977, op. cit. pp. 154-155
[23] MARTEL G., Lovéa village des environs dAngkor, 1962 (217 pages), cité par J. ROUER, op. cit.
[24] BROCHE M. et al., Comment donner une représentation vivante dune langue-culture étrangère en milieu exolingue ? Une approche par le biais de la chanson, Dossier de cercle de mai, ERADLEC, Univ. de Paris III, 1997-1998, p. 3
[25] Le texte de cette chanson se trouve en annexe n°2, pp. 102-103
[26] Chaque invité participe financièrement à la manifestation.
[27] Dans ce cas, lachar est un laïc qui sert dintermédiaire entre les moines et les fidèles et qui décide du jour et de lheure les plus fastes pour la crémation.
[28] Suite à une explication de cette chanson, certains étudiants ont manifesté un certain étonnement.
[29] Nous entendons par « techniques » les activités variées comme, par exemple, les jeux de rôles, les activités ludiques, etc.
|
Module |
Intitulé |
|
1ère année (1er semestre)
|
Initiation au cambodgienPhonologie et théorie de lécriture du cambodgien |
|
1ère année (2ème semestre) |
Cambodgien élémentaireInitiation au cambodgien de base à loral et à lécrit Initiation à la pratique du cambodgien de base |
|
2ème année (1er semestre) |
Cambodgien intermédiaire IInitiation au cambodgien intermédiaire à loral et à lécrit Initiation à la pratique du cambodgien intermédiaire |
|
2ème année (2ème semestre) |
Cambodgien intermédiaire IIPratique de lécrit en cambodgien II Pratique de loral en cambodgien II |
|
3ème année (1er semestre) |
Cambodgien avancé ICambodgien avancé à loral et à lécrit Analyse de textes de civilisation en cambodgien |
|
3ème année (2ème semestre) |
Cambodgien avancé IIPratique de lexposé oral en cambodgien Expression écrite cambodgienne |
|
4ème année (1er semestre) |
Cambodgien de perfectionnementExpression écrite et orale Etudes de documents audiovisuels authentiques |
Expression cambodgienne moderneLecture de la presse écrite cambodgienne Littérature romanesque moderne cambodgienne |
|
|
4ème année (2ème semestre)
|
Pratique du cambodgien de perfectionnementProblématique et pratique de la traduction Perfectionnement de la pratique de loral en cambodgien |
Expression cambodgienne contemporaineLangue et vie quotidienne au Cambodge Littérature romanesque cambodgienne contemporaine |
![]()
[1] Voir la comparaison entre le programme du cours depuis 1986 et le programme nouveau en annexe n°3, p.104
Initiation au cambodgien
Phonologie et théorie de lécriture du cambodgien
Apprentissage de la lecture du cambodgien
Ce module denseignement est orienté vers lacquisition progressive du système phonologique et graphique de la langue khmère par le biais du manuel dAlain Daniel intitulé Apprendre à lire et à écrire le cambodgien[1]. Cette acquisition permettra de maîtriser la lecture des textes de niveau élémentaire. En parallèle à lacquisition de la lecture, les apprenants sinitieront également à lexpression élémentaire dans des situations de communication de la vie quotidienne au Cambodge.
Cambodgien élémentaire
Initiation au cambodgien de base à loral et à lécrit
Initiation à la pratique du cambodgien de base
Ce module denseignement a pour objet de donner aux apprenants la possibilité dacquérir une connaissance de base de la langue khmère, tant par létude en laboratoire de langue à laide de moyens audio et audiovisuels que par des exercices. Ces données orales et écrites seront les éléments constitutifs de base de nombreuses unités didactiques dont les thèmes porteront sur la vie courante.
Cambodgien intermédiaire I et II
Initiation au cambodgien intermédiaire à loral et à lécrit
Initiation à la pratique du cambodgien intermédiaire
Pratique de lécrit en cambodgien II
Pratique de loral en cambodgien II
Ce module denseignement qui se veut être la suite du module denseignement du cambodgien élémentaire aura pour objet lacquisition de connaissances plus approfondies de la langue khmère. Laccent sera particulièrement mis sur les réalités du Cambodge contemporain par des documents semi-authentiques permettant ainsi une approche plus complète de la culture courante par le truchement de la langue.
Cambodgien avancé I et II
Le cambodgien avancé à loral et à lécrit
Analyse de textes écrits en cambodgien
Pratique de lexposé oral en cambodgien
Expression écrite cambodgienne
En premier lieu, ce module denseignement qui sera la suite du module denseignement du cambodgien élémentaire, aura pour objet lacquisition de connaissances plus complexes de la langue et de la culture khmère. Elle visera également la pratique de lexposé oral. En second lieu, ce module sera plus particulièrement axé sur lapprentissage de la logique interne et sur celle de la structure des textes khmers. Cela se fera grâce à la lecture et lanalyse des textes écrits portant essentiellement sur la culture et lactualité du Cambodge.
Cambodgien de perfectionnement
Expression écrite et orale
Cet enseignement vise la maîtrise de compétences tant écrites quorales, afin daméliorer de manière notable la prise de parole et la rédaction. Ces deux approches sous-tendent la connaissance des techniques argumentatives propres à la langue khmère .
Etudes de documents audiovisuels authentiques
Cet enseignement sera basé sur lutilisation exclusive de documents authentiques (programmes radiophoniques et télévisés, fictions cambodgiennes, etc.) ayant pour thèmes tous les aspects sociaux, culturels, politiques et économiques du Cambodge daujourdhui. La pratique de loral visera à la fois la compréhension de la langue des médias et celle de la conversation courante, au travers de discussions portant sur les thèmes inclus dans ces documents.
Expression cambodgienne moderne
Cet enseignement proposera lutilisation darticles de presse, dextraits de romans et de nouvelles contemporains, des textes littéraires. Il sera également consacré à la lecture et la compréhension de textes authentiques, dont le style permettra une prise de conscience de létat de diversité de la langue du point de vue synchronique.
Pratique du cambodgien de perfectionnement
Théorie et pratique de la traduction
Cet enseignement permettra de mettre en évidence, au-delà de lemploi de structures linguistiques différentes, les oppositions radicales entre les mentalités et les visions du monde. Les ambitions de ce cours ne se limiteront pas à lacquisition doutils de traduction, mais permettront une approche plus approfondie des caractéristiques particulières de la langue et de la culture khmères.
Cet enseignement aura pour ambition de faire acquérir les techniques oratoires visant à convaincre un auditoire en abordant par exemple, sous forme dimprovisation, des documents de diverses natures. Cela devrait permettre aux apprenants davoir confiance en eux, un élément nécessaire à la communication directe avec les autochtones.
Expression cambodgienne contemporaine
Langue et vie quotidienne au Cambodge
Littérature romanesque cambodgienne contemporaine
Cet enseignement se caractérisera par une étude contrastive des réalités cambodgiennes actuelles. Il sagira de montrer que le Cambodge nest pas figé dans des croyances ancestrales, dans les fêtes traditionnelles et dans une réalité rurale immuable, mais quil connaît des mutations rapides sur le plan économique, social et donc culturel. Cette complexité de la société cambodgienne sera étudiée à travers des auteurs contemporains (romanciers, essayistes) et prendra en compte le vocabulaire spécifique.
En suivant le programme nouveau, nous allons expliquer les techniques denseignement adéquates, afin de réaliser les objectifs décrits dans 3.1.2.
Comme nous lavons déjà dit plus haut, au début de la première année, la maîtrise de la lecture et de lécriture est indispensable pour la suite de lapprentissage. Ainsi, lorsquun étudiant confond deux mots homophones ou phonétiquement proches, lenseignant peut expliquer le problème soit en montrant la graphie, soit en donnant des exemples qui prouvent que ces mots sont réellement différents. Nous jugeons donc nécessaire de commencer par ce que nous avons intitulé Initiation au cambodgien (Phonologie et théorie de lécriture du cambodgien et Apprentissage de la lecture du cambodgien). Sur ce plan, nous suivons ce qui se pratique déjà actuellement.
Une fois la lecture et lécriture maîtrisées, nous pourrons commencer les cours pour amener l'étudiant à une connaissance élémentaire de la langue khmère , centrée sur la capacité de communication, à loral comme à lécrit, en compréhension comme en expression.
Les cours se dérouleront selon un programme composé dunités didactiques dont les thèmes porteront sur la vie quotidienne cambodgienne.
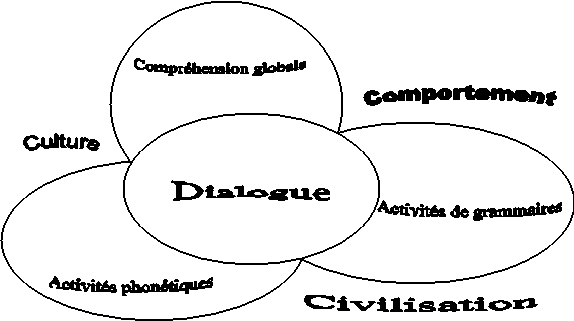
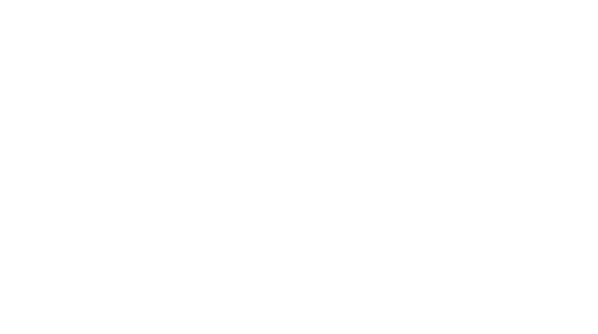
Nous proposons ici même un schéma inspiré du manuel Libre Echange 2 et représentant notre conception de ce que doit être une unité didactique :
![]()
Le dialogue, qui se trouve au cur de lunité
didactique, porte sur un thème relevant de la vie quotidienne comme par
exemple « qui êtes-vous ? », etc. Les objectifs phonétiques
(travailler sur tel ou tel son) et grammaticaux seront définis à partir de ce
dialogue. Les enseignants peuvent donc chercher des exercices existant dans
les manuels ou fabriquer des exercices qui gravitent autour du thème général
du dialogue ou de lunité didactique.
Dans la situation actuelle, à lInalco, lenseignement du khmer des trois premières années est dispensé par deux enseignants, un professeur de khmer français et un lecteur venu du Cambodge. Ainsi, pour appliquer lunité didactique présentée précédemment, nous pensons que les deux enseignants devraient se répartir judicieusement les activités présentées. Cest ainsi que la compréhension orale pourrait être confiée au professeur français, lactivité phonétique étant la tâche du lecteur Cela montre quune coordination parfaite entre les enseignants est requise, afin dassurer au mieux le fonctionnement des cours.
Pour les modules denseignement des troisième et quatrième années, nous proposons les techniques denseignement suivantes :
- En ce qui concerne lenseignement de lécrit dont les intitulés du cours sont Analyses de textes écrits et Expression écrite, les techniques reposent sur lanalyse des éléments constitutifs du texte tels que les mots de liaison, les termes utilisés pour énumérer les idées, etc. Une fois que le squelette du texte a été repéré, lenseignant demande aux apprenants dinventer par exemple un autre texte tout en se servant des éléments du squelette. Les cours se feront en L2.
- Quant à lenseignement de loral dont les intitulés du cours sont Pratique et perfectionnement de la pratique de lexposé oral et Expression orale, les techniques consistent en une présentation théorique, par lenseignant, de ce quest lexposé oral. Ce dernier il demande ensuite aux apprenants den préparer un denviron 15 minutes sur un thème de leur choix dans le cadre de la langue et de la culture khmères. Le rythme de lexposé sera dune fois par semaine. Les questions des autres apprenants peuvent être posées seulement à la fin de lexposé. Quand le temps de questions-réponses sur lexposé est terminé, lenseignant intervient pour apporter déventuelles précisions sur certains points de lexposé et le cas échéant pour corriger les erreurs de langue sil y en a. Le prolongement de lexposé oral, pour les quatrièmes années, sera un débat sur le thème étudié. Lenseignant se transformera alors en animateur.
- Les techniques denseignement pour les cours dEtude de documents audiovisuels authentiques sont les suivantes : chaque document audiovisuel authentique devrait ne pas dépasser 3 minutes ; si le document dure plus longtemps, il faudrait le découper en séquences de 3 minutes. Par exemple, pour un document radiophonique enregistré, dans un premier temps, lenseignant travaille à loral sur la compréhension globale, puis sur la compréhension détaillée du document et, en second lieu, il distribue un texte lacunaire de la transcription du document étudié. Ces éléments manquants sont normalement des mots, des expressions, etc., qui représentent des exemples de lobjectif du cours. Les apprenants vont remplir les trous. Une fois que le texte de transcription est rempli, lenseignant pose aux apprenants à peu près trois ou quatre questions sur le texte. Les apprenants peuvent répondre alors soit par écrit, soit à loral.
- A propos de lenseignement de la littérature romanesque cambodgienne moderne et la lecture de la presse cambodgienne, les techniques denseignement se font, à partir darticles de presse et dextraits de romans et nouvelles contemporains, de textes littéraires, sous forme dune lecture analytique effectuée parallèlement par lenseignant et les apprenants. Cest-à-dire que lenseignant donne des consignes ou une grille de lecture pendant que les apprenants essaient de suivre les consignes et de remplir la grille. Cette lecture analytique permet à ces derniers de connaître le style existant dans les documents abordés et de prendre conscience de létat de diversité de la langue dun point de vue synchronique.
- Pour lunité denseignement intitulée Théorie et pratique de la traduction, lenseignant présente dabord quelques théories importantes de la traduction, puis passe à la pratique en commençant par traduire en français des textes faciles, mais assez riches en spécificités linguistiques et culturelles khmères. En second lieu, des textes courts en français et en khmer seront proposés aux apprenants afin quils les préparent à la maison. Leur préparation sera corrigée en classe.
- Enfin, pour lenseignement des unités intitulées La langue et la vie quotidienne au Cambodge et La littérature romanesque cambodgienne contemporaine, lenseignement se fera, à partir dextraits de romans dauteurs contemporains et de documents de toute nature abordant des réalités cambodgiennes actuelles. Lenseignant distribuera un extrait de roman à lavance, puis il présentera un document audiovisuel. Il demandera enfin aux apprenants de faire une étude contrastive. Sur les réalités sociales présentées, précisons quau Cambodge, les romans sont moins étudiés sur un plan stylistique quils ne sont le prétexte à une exploitation sociologique des personnages et des situations présentées.
Daprès le programme nouveau et les techniques denseignement adéquates que nous venons de décrire, nous pouvons dire quune grande partie des difficultés phonétiques et syntaxique sera résolue grâce aux exercices et aux activités proposées. Il en est de même pour les difficultés dordre culturel.
Néanmoins, nous sommes conscient quil existe toujours des difficultés chez les apprenants. Cependant comme elles ne revêtent pas la même importance selon les apprenants, nous proposerons les solutions qui vont suivre.
Nous avons sélectionné plus haut les trois difficultés les plus importantes. La première porte sur les consonnes nasales, sourdes et aspirées et les voyelles diphtonguées qui nexistent pas en français ; la deuxième est consacrée à la durée démission des mots due aux voyelles et à lapostrophe khmère ; la dernière porte sur la consonne « r » [r] combinée à dautre(s) consonne(s).
Afin de proposer des solutions à ces difficultés, nous nous inspirons du mémoire de DEA de Mao Bunneang intitulé Les interférences phonétiques dans lapprentissage du français par des apprenants cambodgiens[2]. Dans ce mémoire, lauteur relève les erreurs phonétiques commises en français par des apprenants cambodgiens. Afin de proposer des pistes pour la correction de ces erreurs, il a fait une description détaillée et comparative des deux systèmes phonétiques français et khmer (voir les tableaux récapitulatifs des consonnes et des voyelles des deux langues en annexe n°6, pp. 107-109). Ensuite, il a analysé les erreurs ou les difficultés selon le système phonétique décrit. Enfin, il a proposé des méthodes de corrections phonétiques intitulées méthode articulatoire, méthode des contextes facilitants et méthode spécifique. La méthode articulatoire repose sur le postulat selon lequel lémission des sons implique une connaissance relativement poussée du fonctionnement de lappareil phonatoire. Cest en analysant et en pratiquant en même temps, à partir des schémas, les mouvements nécessaires à la réalisation dun son que lélève est amené à produire ce son »[3]. La méthode des contextes facilitants est « une méthode qui en sinspirant de la méthode verbo-tonale permet de réduire les interférences phonétiques »[4] : après avoir pronostiqué les erreurs phonétiques, on va chercher, en fonction des phonèmes, les éléments (consonnes/voyelles) les plus favorables pour corriger ces erreurs ; « L'intervention consiste à replacer l'élément fautif dans un environnement optimal pour reconditionner l'audiophonation et ce, en recourant, selon les cas, à l'intonation, au rythme, à la tension, à la phonétique combinatoire et à la prononciation nuancée »[5]. La méthode spécifique est une « méthode qui propose une progression "type" de cours de phonétique pour corriger des erreurs phonétiques »[6].
Ces trois méthodes nous semblent pouvoir s'appliquer dans la résolution des difficultés phonétiques des étudiants de khmer à l'Inalco.
Pour pouvoir proposer une solution, il faudrait que nous sachions pourquoi les francophones ont ce genre de difficultés.
Les erreurs cités plus haut sont dues à plusieurs raisons. Nous nen présenterons que deux, car nous estimons quelles sont les plus importantes. Dune part, elles sont dues à l'audibilité ou « perception auditive » : un apprenant qui ne discrimine pas un son ne peut pas le produire correctement[7]. Dautre part, ces difficultés sont dues à labsence du phonème en question en français et aux interférences phonétiques.
- Certaines consonnes nasales, sourdes et aspirées nexistent pas en français, elles posent des problèmes de prononciation aux apprenants du khmer. Ceux-ci ne peuvent que difficilement produire les phonèmes c[c], g[N], j[ø], q[cH], F[tH], eO[w«], eo[i«]. Il convient alors de prendre en considération ce phénomène pour pouvoir effectuer une correction phonétique « type ». Le meilleur moyen pour résoudre ce problème nest sans doute que la méthode articulatoire.
- Au plan articulatoire, les deux phonèmes [r] et [R] ne sont pas les mêmes, lun est roulé et lautre est uvulaire. En raison de labsence de [r] dans leur système consonantique, les apprenants francophones adoptent [R] plutôt que [r] parce que ce phonème nest pas facile à produire et quils considèrent que ces deux sons sont identiques. De plus, pour eux, cest encore plus difficile quand ce phonème est combiné avec dautres consonnes et voyelles, cest-à-dire lorsquil est dans un mot, comme dans RcUt [crot] moissonner, RsYl[sru«l|] facile. Tout cela est une difficulté supplémentaire pour la prononciation du khmer. La méthode articulatoire est également un moyen adéquat pour résoudre ces problèmes.
Nous avons sélectionné plus haut les trois difficultés syntaxiques les plus courantes pour les apprenants francophones : lordre des mots dans le groupe nominal, les particules de temps et lemploi des verbes.
Précisons que lordre des mots en khmer est très rigoureux et possède sa logique propre. Il est à rappeler que les mots khmers sont invariables : ni déclinaison, ni marque du genre, ni du nombre, ni conjugaison.
- Le groupe nominal khmer commence toujours par un nom suivi généralement dun adjectif (adjectif verbal et/ou adj. possessif, adj. numéral), dun classificateur , dun adj. démonstratif. Par exemple :
Nom + adj. verbal + adj. numéral + classificateur :
pÞH FM mYy xñg
[pHti«h tHom mu«j| kHnùN]
/maison grande une classificateur/
« une grande maison »
Nom + adj. possessif + adj. numéral + classificateur :
ecARsI ´ bI nak;;
[ca® srei kHøom bei nak]
/petites-filles mes trois classificateur/
« mes trois petites-filles ».
Nom + adj. possessif + adj. num. + classificateur + adj. démonstratif :
kµÜy Rbus Kat; BIr nak; enaH
[kHmu«j broh ki«t più nak nuh]
/ neveux ses deux classificateur là/
« ses deux neveux-là ».
Il existe également dautres groupes nominaux composés dune cascade de noms synonymes, car la redondance et la répétition ne posent pas de problème dans la langue khmère.
Par ailleurs, en khmer, on considère également la construction de « quel(le)(s) et combien » en français avec un nom, comme un syntagme nominal. Cest ainsi que :
Kat; )an Tij esovePA Na ?
[keat baùn| tiø si«B pH«® na]
/il part. acheter livre quel/
« Il a acheté quel livre ? »
Il est à noter quen khmer, le nom esovePA [si«B pH«®] « livre » se trouve avant la particule interrogative Na [na]. Quand il sagit de pluriel, « quels livres », on utilise la particule NaxøH [na kHlah]. Il en est de même pour b:unµan [ponman] « combien » en français. Par exemple : Gñk man esovePA b:unµan k,al ?
[nak mi«n si«B pH«® ponman kHbal]
/vous avez livres combien classificateur/
« vous avez combien de livres ? ».
Cet exemple montre que le syntagme nominal khmer est complètement différent de celui du français.
- Dautre part, en khmer, le temps ne joue quun rôle effacé dans la classification des idées. De même que le mode nexiste pas pour les verbes en dehors de limpératif.
Pour rendre la notion de temps, le Khmer recourt à des procédés qui lui sont propres, et qui révèlent une conception du temps et de l'espace différents des Français.
Et en plus, on peut mettre une phrase indiquant le passé ou le futur au présent en y ajoutant une particule temporelle comme « Hier, il vient chez moi » ou « demain, je vais à Bangkok, etc. ». Les particules sont donc très nombreuses.
- Enfin, lemploi des verbes pose plusieurs problèmes aux étudiants francophones ; dans les textes khmers, il y a souvent redondance verbale[8]. Certains verbes sont décomposés[9] et surtout, les verbes « auxiliaires » ne sont ni le verbe « avoir » ni le verbe « être »[10].
De plus, il existe un autre type de verbe que nous appelons les verbes complétifs.
Par exemple : ´ eTA pSar Tij RtI
[kHøom t«® pHa tiø trei]
/je aller marché acheter poisson/
« je vais au marché pour acheter du poisson ».
va yk kUnesar [ ´
[Bi« j«k konsao /aoj kHøom]
/il prendre clé donner moi/
« il a pris la clé pour me donner ».
Les verbes « acheter » et « donner » sont des verbes complétifs. Ils sassocient à « aller » et à « prendre ».
G. Cambefort explique que cette notion de détermination du verbe par un autre verbe ne se trouve pas dans la phrase simple, qui en khmer suit le même ordre quen français (sujet-verbe-complément), mais dans la phrase complexe. Dans ce type de phrase, on rencontre souvent « un verbe indiquant le procès essentiel et un ou plusieurs verbes postposés qui apportent des nuances daspect ». Doù lemploi de « verbes-doubles » dont le premier indique laction proprement dite et le deuxième, placé plus loin, donne laspect déterminé, ou effectif, ou accompli, etc. Le nombre de ces verbes ne se limite dailleurs pas toujours à deux ; on en trouve parfois de véritables cascades, dont lemploi a été jugé indispensable pour préciser progressivement la pensée[11].
Puisque ces problèmes sont très diversifiés et généraux, il nous est très difficile de proposer des remèdes. Néanmoins, nous suggérons quelques méthodes qui devraient permettre de réduire ces difficultés.
Dune part, la lecture. Il est conseillé aux apprenants de lire beaucoup. Cela devrait leur permettre de se familiariser avec la syntaxe, les particules de temps et lemploi des verbes. Tout cela favorise des automatismes. En effet, en classe, quand un étudiant fait une erreur demploi dune particule de temps par exemple, lenseignant corrige. Si lapprenant a déjà rencontré à plusieurs reprises cette particule en contexte, il a plus de chance de ne pas répéter la même erreur.
Dautre part, les exercices structuraux (produire et transformer selon le modèle, substituer un des éléments de la phrase, etc.). Nous pensons quils sont lun des meilleurs moyens pour résoudre ce genre de difficultés.
Enfin, les mini-activités dexpression écrite et/ou orale comme rédiger des petits textes de cinq à dix lignes sur divers sujets, des petites lettres en réponse à une carte postale dun(e) ami(e), à une invitation, à des demandes dinformation. Et dans le prolongement de ces activités écrites, nous proposons des jeux dexpression orale conduisant à des micro-conversations (au téléphone, dans la rue, au marché, à la poste, etc.).
En résumé, travailler les quatre compétences de lapproche communicative est la solution par excellence à toutes difficultés.
Nous avons exposé plus haut que les problèmes dordre culturel relevés par les étudiants sont nombreux. Nous avons en outre analysé quelques éléments culturels afin de montrer que les difficultés culturelles lors de lapprentissage dune langue sont dues à des pratiques, des conceptions ou une idéologie différentes dune société à lautre.
Ces difficultés sont variables selon les étudiants. Cest pourquoi, plutôt que dapporter des solutions définitives, il conviendra de montrer la différence entre la culture de la langue étudiée et celle des apprenants.
Ainsi, pour présenter la différence entre la société française et cambodgienne au travers de la notion de hiérarchie, nous pourrions proposer lanalyse dun document dune émission télévisée du 10 juillet 1999 intitulée « La table ronde » diffusée par TVK, une chaîne publique subissant la censure du gouvernement.
Nous voudrions signaler également quil est extrêmement difficile de trouver un document audiovisuel présentant un débat ou des discussions en khmer aussi bien en France quau Cambodge. Quand on parle de débat, chaque intervenant donne son point de vue, puis le défend ; or nous avons fait remarquer plus haut que le fait de se singulariser, de donner une opinion personnelle nest pas un schéma khmer.
Le thème de « La table ronde » porte sur « les problèmes de frontières ». Les intervenants de cette émission sont des politiciens, des membres du gouvernement (voir la liste en annexe n°7, p. 110). Nous sommes conscient que ces intervenants ne sont pas représentatifs des Cambodgiens en général. De plus, le thème du débat ne relève pas de la vie quotidienne. Il nous semble cependant intéressant dans la mesure où il reflète certains aspects de la culture khmère.
En ce qui concerne lanalyse proprement dite du document, nous nous limitons à la forme seulement.
Avant toute chose, il nous paraît intéressant de comprendre ce que veut dire lintitulé de lémission « La table ronde » dans la société khmère. Daprès le document, « La table ronde » désigne tout simplement le fait que chaque intervenant présente un exposé. Il ny a pas de débat, ni déchange didées. Or, quand on parle de « La table ronde », on pense en général à un débat et à des discussions sur un thème particulier.
Dautre part, dans les sociétés occidentales, lors dun débat télévisé, le journaliste a pour rôle de distribuer la parole. Cela nest absolument pas le cas dans cette émission. En effet, comme les intervenants sont gouverneur, vice-gouverneur ou secrétaire dEtat, ils appartiennent à une hiérarchie élevée. Le journaliste ne se situe pas au même rang queux. Il nest donc pas digne du même respect. Le journaliste ne sert que de faire valoir. Il a pour rôle unique douvrir et de clore lémission.
Le rôle de modérateur est assuré par un conseiller du gouvernement qui est bien placé hiérarchiquement. Ce qui fait que chaque intervenant lui adresse, avant de parler, ses remerciements pour avoir obtenu la parole.
Chacun a sa place et attend son tour. Les rôles ne sont pas interchangeables.
Par ailleurs, il est à noter que, malgré lintitulé de lémission, tout est préparé à lavance. En effet, certains intervenants lors de leur exposé lisent un texte. Cela ne reflète absolument pas la conception du débat, un élément intéressant dans la mesure où lon souhaite travailler sur la notion de débat.
Cette étude nous a permis de préciser les difficultés entrevues à notre arrivée à l'Inalco. Nous avions à ce moment-là voulu proposer de nouvelles démarches pédagogiques qui n'avaient alors, pas été retenues.
Il nous semble que, par ce travail, nous avons apporté des arguments plaidant en faveur de réels changements dans l'enseignement : une progression plus stricte, une approche des dimensions communicative et interculturelle, des supports plus variés incluant les nouvelles technologies.
Cette année étant notre dernière année de travail à l'Inalco, conformément à notre contrat de travail, nous ne serons pas en mesure d'appliquer nos propositions d'intervention. Nous ne manquerons cependant pas de les suggérer à notre successeur. Quant à la réelle possibilité d'appliquer le programme nouveau sur le terrain, elle est tout à fait relative. Si cette approche peut rencontrer un avis favorable de la part de l'employeur, elle peut tout aussi bien être freinée par la pesanteur de l'institution.
Il pourrait être intéressant de prolonger ce travail en l'élargissant à l'enseignement dans d'autres grands pays (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Japon). Cela permettrait de comparer les méthodes actuelles d'enseignement et les difficultés éventuelles. Et dans le prolongement d'une telle étude, il serait intéressant de mettre au point des démarches communes.
Ouvrages
|
BYRAM Michaël (1992), Culture et éducation en langue étrangère, Hatier/Didier, col. LAL, Paris. 220 pages |
|
CAMBEFORT Gaston (1950), Introduction au cambodgien, Les langues dorient, G. P. Maisonneuve et Cie, Paris, 80 pages |
|
CORMON Françoise (1992), Lenseignement des langues : théorie et exercices pratique, Chronique sociale, Col. Synthèse, Lyon. |
|
DANIEL Alain (1992), Lire et écrire le cambodgien : précis pédagogique raisonné écrit et à oral à lusage des étudiants non-khmérophones, Institut de lAsie du Sud-Est, Paris, 78 pages |
|
GUIBERT Joël et JUMEL Guy (1997), Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales, Armond Colin, Paris, 206 pages |
|
GUMPERZ John (1989), Engager la conversation : introduction à la sociolinguistique interactionelle, Les éditions de Minuit, Col. Le sens commun, Paris, 185 pages |
|
HUFFMAN Frankiln E. |
|
JACOB M. Judith (1968), Introduction to cambodian, Orford University Press, London, 341 pages |
|
KERBRAT-ORECCHIONI Catherine (1994), Les interactions verbales, Tome III, Armond Colin, Paris, 347 pages |
|
LEWITZ Savoros (1968), Lectures cambodgiennes : notions succinctes, Librairie dAmérique et dOrient Adrien Maisonneuve, Paris, 111 pages |
|
LIM Hak Kheang et PURTLE Dale (1972), Contemporary cambodian, Foreign Service Institut, Department of State, Washington, 649 pages |
|
MASPERO Georges (1915), Grammaire de la langue khmère, Imprimerie Nationale, Paris, 489 pages |
|
MIDOUX Marcel (1974), La dérivation en langue cambodgienne moderne, Ecole pratique des Hautes Etudes, 6è section, Centre de recherches linguistiques sur lAsie Orientale, Paris, 267 pages |
|
NEPOTE Jacques (1992) Parenté et organisation sociale dans le Cambodge moderne et contemporain : quelques aspects et quelques applications du modèle les régissant, Ed. Olizane, Genève, 255 pages |
|
PONCHAUD François, |
|
PORCHER, L. (dir.) (1986), La civilisation, Didactique des langues étrangères, CLE International, Paris. |
|
PUREN Christian (1988), Histoire des méthodologies de lenseignement des langues, Nathan/CLE International, col. DLE, Paris |
|
ROBERT Galisson (1980), Dhier à aujourdhui, la didactique générale des langues étrangères, CLE International, col. DLE, Paris |
|
ZARATE Geneviève (1986), Enseigner une culture étrangère, Recherches/ applications, Hachette, Paris, 159 pages |
Mémoires de DEA
|
MAO Bunneang, Les interférences phonétiques dans lapprentissage du français par des apprenants cambodgiens, Mémoire de DEA, Université de Rouen, 1998 |
|
CABANEL Claire, Les mécanismes de réappropriation de la mémoire collective : lexemple du Cambodge, DEA de didactologie des langues et des cultures, Paris III, 1997 |
|
PO Map, Problèmes de la traduction en français dun roman cambodgien : la rose de Païlin, Mémoire de DEA, Université de Rouen, 1998 |
Articles et dossiers
|
BERNARD Solange (1948), « Le Cambodgien à lEcole Nationale des langues orientales vivantes », in Cent-cinquentenaire de lEcole des Langues Orientales, Imprimerie nationale de France, Paris, pp. 365-379 |
|
BERTRAND Didier (Octobre 1991), « Analyse de situation de communication avec des Vietnamiens : intérêt dune approche ethnocommunicative et pragmatique» in Intercultures, n° 15 |
|
BROCHE M. et al. (1998), Comment donner une représentation vivante dune langue-culture étrangère en milieu exolingue ? Une approche par le biais de la chanson , Dossier de cercle de mai, ERADLEC, Univ. de Paris III, 12 pages |
|
CHHIV Yiseang (1998), Le discours identitaire des étudiants dorigine cambod-gienne de lInstitut national des Langues et Civilisations Orientales, Dossier de maîtrise de FLE, Paris III. 32 pages. |
|
DANIEL Alain (1995), « Le cambodgien », in Deux siècles dhistoire de lÉcole des langues orientales, Textes réunis par Pierre Labrousse, Editions Hervas, LanguesO, pp. 259-262 |
|
LONG Seam (1978), « Létude de la langue khmère en URSS » in Cahier de lAsie du Sud-Est, n°4, Publications Orientales de France, Paris, pp. 81-88 |
|
MARTINI François (1942), « Aperçu phonologique du cambodgien » in Bulletin de la société de Linguistique de Paris, Tome 48 n° 124, C. Klincksiect, Paris, pp. 112-131 |
|
PINNOW H.-J., « Personnal pronouns in the Austroasiatic languages : a historical study » in Lingua, XIV, 1965, pp. 3-42 |
|
PONCHAUD François (1993), « Élection et société khmère » in Les Cambodgiens face à eux-mêmes, Dossier pour un débat, Fondation pour le progrès de lhomme, n° 4, pp. 144-151 |
|
PORCHER Louis (Juillet Septembre 1982), « Lenseignement de la civilisation en questions » in Etudes de Linguistiques Appliquées n° 47, coordonné par François MARIET, pp. 38 49 |
|
ROBERT Galisson (Juillet-août 1994), « Un espace disciplinaire pour lenseignement/apprentissage des langues en France. Etat des lieux et perspective », in Revue française de Pédagogie, n° 108, pp.25-37 |
|
SUN Hyo Sook (1992), « Le français, outils de communication pour les sujets coréens en situations exolingue », in LIDIL n °5 : lapprenant asiatique face aux langues étrangères, Univ. Stendhal, Grenoble, pp. 31-66 |
Annexe n° 1 : Le questionnaire et les réponses p. 76
Annexe n° 2 : Le texte de la chanson intitulée « Veuf sans avoir été marié » p.102
Annexe n° 3 : La comparaison entre le programme du cours depuis 1986 et le programme nouveau p.104
Annexe n° 4 : Schéma n° 2 p.105
Annexe n° 5 : Schéma n° 3 p.106
Annexe n° 6 : Tableaux récapitulatifs des voyelles et des consonnes des deux langues khmer-français p.107
Annexe n° 7 : La liste des intervenants de « La table ronde » p.110
Annexe n°1 : Le questionnaire et les réponses
Questionnaire destiné aux étudiants de khmer dorigine non cambodgienne de lInalco
Ce document a pour but de collecter des renseignements sur le profil sociologique des étudiants en khmer de lInalco et sur les raisons qui motivent leur apprentissage de la langue.
Ces données, une fois dépouillées, permettront denrichir un mémoire de DEA sur « Lenseignement et lapprentissage de la langue et de la culture khmères en milieu exolingue : le cas de lInstitut national des langues et civilisations orientales ».
Profil sociologiqueÄ
Nom : . ...... .. Prénom : .......................
Age : . Sexe : Nationalité : .
Si oui , laquelle ?
Le khmer est-il votre cursus principal ? Oui Non
Si non, quel est votre cursus principal ? ..
Etes-vous déjà allé(e) au Cambodge ? Oui Non
Si oui , quand et pendant combien de temps y êtes-vous resté(e) ?
Situation familiale
Etes-vous marié(e) ? Oui Non
Si oui , votre conjoint(e) est-il(elle) dorigine : - cambodgienne ? Oui Non
- asiatique ? Oui Non
Langues
Quelle langue utilise-t-on au quotidien dans votre famille ?
française Autre (laquelle ?) .
Quel niveau estimez-vous avoir en khmer ? (très bonne maîtrise , passable ?, rudimentaire?)
Parlé Lu Ecrit
? ? ? ? ? ?
En dehors du français et du cambodgien, quelle(s) langue(s) connaissez-vous ?
( très bonne maîtrise , bonne maîtrise?, passable ? )
Citez les principales : Parlé Lu Ecrit
- ? ? ? ? ? ?
- . ? ? ? ? ? ?
- . ? ? ? ? ? ?
Enseignement de la langue et de la culture
Eprouvez-vous des difficultés particulières :
- en phonétique Oui Non
Si oui , lesquelles . ..
Si non, pourquoi ? .. ..
- en syntaxe Oui Non
Si oui , lesquelles ....
Si non, pourquoi ? . .. ..
A propos de la culture courante :
Etes-vous déjà allé(e) au Cambodge ? Oui Non
Si vous êtes déjà allé(e) au Cambodge, avez-vous été étonné(e) par les manières dagir et les comportements des Cambodgiens ? Oui Non
Si non, pourquoi ? .. .. ...
Si oui , quest-ce qui vous paraît particulièrement étonnant ?
Quest-ce qui vous paraît particulièrement différent de votre culture ?...............
Pensez-vous quil serait intéressant détudier des spécificités culturelles :
- de type extra-verbal (la gestuelle, les comportements, etc. ) ? Oui Non
- de type verbal (salutations différentes en fonction de linterlocuteur, différences dans les remerciements, etc.) ? Oui Non
Pensez-vous que ces spécificités culturelles sont suffisamment étudiées en cours ?
Oui Non
Si oui , précisez lesquelles et sous quelles formes ? . ...
Si non, sous quelle forme souhaiteriez-vous quelles soient abordées ?
Articles de journal
Documentaires de télévision
Informations télévisées
Films de réalisateurs cambodgiens
Autres
Précisez . ..
Les motivations de lapprentissage de la langue khmère
Avant vos études de khmer, par quel biais aviez-vous abordé la culture et/ou la langue khmère ?
- la littérature
- le cinéma
- des documentaires
- les journaux
- des contacts avec des amis cambodgiens
- des voyages au Cambodge
- autres
Précisez .
Est-ce que vous vous considérez comme bilingue ? Oui Non
Pourquoi étudiez-vous le khmer aux Langues Orientales ?
- pour parfaire votre connaissance en langue
- pour parfaire votre connaissance de la culture khmère
- pour avoir un diplôme
- pour utiliser cette langue en France dans votre profession
- pour compléter votre cursus universitaire
- pour utiliser cette langue dans votre projet de recherche ou détude
- pour accéder à la culture cambodgienne
- pour aller travailler au Cambodge
- pour des raisons familiales : époux / épouse cambodgien(ne),
enfants adoptifs cambodgiens, parrainage
- Autres
Précisez ... ...
Etes-vous plus attiré par la langue khmère que par la culture ? Oui Non
Pourquoi ? .
Voudriez-vous apprendre uniquement la langue ? Oui Non
Pour quelles raisons ? ....
Fin du questionnaire .
Je vous remercie de votre coopération. Ces informations resteront anonymes et seront traitées uniquement et strictement dans le cadre dun travail universitaire.
Questionnaire
destiné aux étudiants de khmer dorigine cambodgienne de lInalco
Ce document a pour but de collecter des renseignements sur le profil sociologique des étudiants en khmer de lInalco et sur les raisons qui motivent leur apprentissage de la langue.
Ces données, une fois dépouillées, permettront denrichir un mémoire de DEA sur « Lenseignement et lapprentissage de la langue et de la culture khmères en milieu exolingue : le cas de lInstitut national des langues et civilisations orientales »
Profil sociologiqueÄ
Nom : . .. Prénom : ..................................................
Age : . . Sexe : Nationalité : .
Exercez-vous une activité professionnelle parallèlement à vos études ? Oui Non
Si oui , laquelle ?
Le khmer est-il votre cursus principal ? Oui Non
Si non, quel est votre cursus principal ?
Avez-vous encore de la famille au Cambodge ? Oui Non
Si oui , quels sont les liens familiaux et quels rapports entretenez-vous avec ces personnes ? (correspondance régulière, aides financières, etc.) .. ... ..
Etes-vous déjà allé(e) au Cambodge ? Oui Non
Si oui , quand et pendant combien de temps y êtes-vous resté(e) ?
Lors de votre séjour au Cambodge, séjourniez-vous dans votre famille ? Oui Non
Situation familiale
Père : Quel âge a votre père ? .. ans
Quel est son niveau détude ? .. ..
Quelle était sa profession au Cambodge ? .
Et sa profession actuelle ? .
Mère : Quel âge a votre mère ? ans
Quel est son niveau détude ? ..
Quelle était sa profession au Cambodge ? .
Et sa profession actuelle ? .
Habitez-vous chez vos parents ? Oui Non
Avez-vous des frères et des surs ? Oui Non
Si oui , indiquez leur âge .
Etes-vous marié(e) ? Oui Non
Si oui , votre conjoint(e) est-il(elle) dorigine : - cambodgienne ?Oui Non
- asiatique ? Oui Non
Langues
Quelle langue utilise-t-on au quotidien dans votre famille ?
française khmère française et khmère
Si vous utilisez le khmer, de quelle façon le maîtrisez-vous? Lu Parlé Ecrit
- Maîtrise orale : Je parle couramment
Je me débrouille
Je comprends mais je ne peux pas mexprimer
- Maîtrise écrite : Je peux le lire Très facilement Facilement Difficilement
Je peux lécrire Très facilement Facilement Difficilement
En dehors du français et du cambodgien, quelle(s) langue(s) connaissez-vous ?
( très bonne maîtrise , bonne maîtrise?, passable ? )
Citez les principales : Parlé Lu Ecrit
- .. ? ? ? ? ? ?
- .. ? ? ? ? ? ?
- .. ? ? ? ? ? ?
Si vous avez des frères et des surs, dans quelle langue, communiquez-vous le plus facilement avec eux ? française khmère française et khmère
Sil vous arrive dutiliser le français et le khmer, dans quel contexte utilisez-vous (à la maison, avec les amis, etc.)
le khmer ? .
le français ? ... .
Enseignement de la langue et de la culture
Eprouvez-vous des difficultés particulières :
- en phonétique Oui Non
Si oui , lesquelles
Si non, pourquoi ? ..
- en syntaxe Oui Non
Si oui , lesquelles .. .
Si non, pourquoi ?
A propos de la culture courante :
Si vous êtes déjà allé(e) au Cambodge, avez-vous été étonné(e) par les manières dagir et les comportements des Cambodgiens ? Oui Non
Si non, pourquoi ? .. ...
Si oui , quest-ce qui vous paraît particulièrement étonnant ? ..
quest-ce qui vous paraît particulièrement différent de ce qui se passe en France ?.....................
Pensez-vous quil serait intéressant détudier des spécificités culturelles :
- de type extra-verbal (la gestuelle, les comportements, etc.) ? Oui Non
- de type verbal (salutations différentes en fonction de linterlocuteur, différences dans les remerciements, etc.) ? Oui Non
Pensez-vous que ces spécificités culturelles sont suffisamment étudiées en cours ?
Oui Non
Si oui , précisez lesquelles et sous quelles formes ? . . ...
Si non, sous quelle forme souhaiteriez-vous quelles soient abordées ?
Articles de journal
Documentaires de télévision
Informations télévisées
Films de réalisateurs cambodgiens
Autres
Précisez ... ..
Les motivations de lapprentissage de la langue khmère
Quand votre apprentissage de la langue khmère a-t-il commencé ?
- dès la toute petite enfance avec lecture et écriture Oui Non
- plus tard, lorsque vous en avez exprimé le désir Oui Non
Est-ce que vous vous considérez comme bilingue ? Oui Non
Pourquoi étudiez-vous le khmer aux Langues Orientales ?
- pour parfaire votre connaissance en langue
- pour parfaire votre connaissance de la culture khmère
- pour avoir un diplôme
- pour utiliser cette langue en France dans votre profession
- pour compléter votre cursus universitaire
- pour perfectionner une langue que vos parents parlent à la maison, langue familiale
- pour accéder à la culture cambodgienne
- pour retourner vivre au Cambodge
- pour aller travailler au Cambodge
- Autres
Précisez . ...
Etes-vous plus attiré(e) par la langue khmère que par la culture ? Oui Non
Pourquoi ? .. . ...
Voudriez-vous apprendre uniquement la langue ? Oui Non
Pour quelles raisons ? ....
Fin du questionnaire .
Je vous remercie de votre coopération. Ces informations resteront anonymes et seront traitées uniquement et strictement dans le cadre dun travail universitaire.
Réponses au questionnaire
destiné aux étudiants de khmer dorigine non cambodgienne de lInalco
1. FF1, étudiante, 18 ans, 1ère année
2. FF2, étudiant, 27 ans, 1ère année
3. FF3, étudiante, 24 ans, 1ère année
4. FF4, étudiante, 21 ans, 1ère année
5. FF5, étudiante, 56 ans, 1ère année
6. FF6, étudiante, 56 ans, 1ère année
7. FF7, étudiant, 42 ans, 1ère année
8. FF8, étudiant, 20 ans, 1ère année
9. FF9, étudiant, 31 ans, 1ère année
10. FF10, étudiant, 40 ans, 1ère année
11. FF11, étudiante, 18 ans, 1ère année
12. FF12, étudiante, 26 ans, 1ère année
13. FF13, étudiant, 56 ans, 2ème année
14. FF14, étudiante, 22 ans, 2ème année
15. FF15, étudiant, 23 ans, 2ème année
16. FF16, étudiante, 23 ans, 2ème année
17. FF17, étudiant, 24 ans, 3ème année
18. FF18, étudiante, 44 ans, 4ème année
19. FF19, étudiant, 51 ans, 4ème année
20. J1, stagiaire de lambassade du Japon, 26 ans, 2ème année
Profil sociologique
Tranches d'âge : moins de 20 ans : 2 (F)
Entre 20 et 26 ans : 9 (6F et 3H)
Plus de 26 ans : 9 (4F et 5H)
Nationalité : Française : 19 (12F et 7H)
Japonaise : 1 (M)
Exercez-vous une activité professionnelle parallèlement à vos études ?
[FF2 : journaliste pigiste, FF3 : Infirmière en soins palliatifs, FF5 : éducatrice spécialisée, FF7 : comédienne, FF7 : entrepreneur de spectacle, FF8 : bibliothécaire au Centre Georges Pompidou + entretien, FF9 : agent de propreté, FF10 : consultant, FF12 : secrétaire dans un institut de formation pour cadres au chômage (1 jour par semaine), FF13 : professeur de sciences physiques, FF16 : bibliothécaire, FF18 : médecin, FF19 : fonctionnaire, J1 : stagiaire de lAmbassade du Japon]
· Non (7/20)
Le khmer est-il votre cursus principal ?
· Oui (14/20)
· Non (6/20) Si non, quel est votre cursus principal ?
[FF2 : licence en ethnologie, FF4 : école du Louvre histoire de lArt, FF15 : Magistère de relations internationales, FF17 : IEP de Paris DEA en économie internationale (96-97), FF18 : doctorat en médecine, FF19, études de droit]
Etes-vous déjà allé(e) au Cambodge ?
· Oui (8/20) Si oui , quand et pendant combien de temps y êtes-vous resté(e) ?
- Courte durée (moins de 3 mois) : 3
- Longue durée (plus de 3 mois) : 5
· Non (12/20)
Situation familiale
Etes-vous marié(e) ?
· Non (17/20)
· Oui (3/20) Si oui, votre conjoint(e) est-il(elle) dorigine :
- cambodgienne ? Oui (1) Non (2)
- asiatique ? Oui (0) Non (3)
Langues
Quel niveau estimez-vous avoir en khmer ?
- Très bonne maîtrise : 0
- Passable : 7
- Rudimentaire : 13
En dehors du français et du cambodgien, quelle(s) langue(s) connaissez-vous ?
( très bonne maîtrise , bonne maîtrise?, passable ? )
Citez les principales :
|
Langues occidentales |
Rudimentaire |
Passable |
Très bonne maîtrise |
|
Anglais |
4 |
9 |
7 |
|
Langues orientales |
Rudimentaire |
Passable |
Très bonne maîtrise |
|
Chinois |
|
1 |
|
Enseignement de la langue et de la culture[12]
Eprouvez-vous des difficultés particulières :
- en phonétique
· Oui (16/20) Si oui, lesquelles
FF1 : Prononcer les phrases avec un bon rythme, cest-à-dire faire « ressortir » les () bnþk; par rapport aux autres mots qui doivent être prononcés à une vitesse normale. Il est aussi difficile (car cela ne va pas de soi en français) dinsister sur la 1ère partie dune voyelle diphtonguée . Quand les Khmers parlent, il est parfois difficile de savoir quelle est la consonne finale , qui nest presque pas prononcée.
FF2 : problème de prononciation de certaines lettres.
FF5 : Certaines aspirations à faire sentir et la présence de certaines souscrites.
FF6 : avec l'articulation des Rc et RC et . Par exemple : éf¶ .
FF7 : les aspirés (consonnes et voyelles) - la longueur des voyelles, les consonnes finales (leur prononciation le g, le changement de registre provoqué par l'aspect monosyllabique de la langue et la "musique" qui en découle en particulier, valeur de la consonne initiale.
FF8 : w ou FP (ces différenciations). D'une façon globale la prononciation est difficile. La différenciation entre voyelles courtes et longues est souvent légère et en particulier à l'oreille. Les différents accents mettent parfois en déroute.
FF9 : RAS
FF10 : La prononciation des voyelles en fonction des différentes ouvertures. La prise en compte des souscrites dans les dissyllabes.
FF11 : J'ai des problèmes avec les sons [o], je n'arrive pas bien à faire la différence. Cela est sûrement dû à la région du sud d'où je viens. Dans l'ensemble, je n'ai pas trop de problème sauf quand il y a plusieurs consonnes qui se suivent comme qñaM.
FF12 : Les sons que nous ne sommes pas habitués à utiliser en français. Les aspirations la lettre g, j'ai l'impression d'avoir un accent français dont je ne me débarrasserai jamais, peut-être aussi que je n'ose pas mette l'accent où il faut.
FF13 : RAS
FF14 : certaines sons n'existent pas en français et sont difficiles à restituer. Par exemple, eO et les consonnes aspirées. Le r m'ait aussi difficile à prononcer. Pour la compréhension orale, il est parfois dur de faire la différence entre voyelles et brèves.
FF15 : prononciation très difficile.
FF16 : Avec certains sons, certaines consonnes le RC. Il y a des sons que j'ai du mal à prononcer les r (qui sont roulés). Des difficultés éprouvées également avec la prononciation des mots emprunts pâli et sanscrit. C'est une véritable difficulté.
FF19 : Les difficultés sont multiples : elles résultent de l'alternance des sons brefs et longs des voyelles, parfois difficiles à cerner lors de l'écoute, valeur pour l'alternance aspirées, non aspirées; à ce niveau, une légère progression , si possible soit-elle dans la perception de ces voyelles et aspirées permet de progresser un peu dans l'orthographe des mots, etc. Le dictionnaire de mots de prononciation voisine peut devenir problématique, Avoir l'oreille "juste" semble devoir être une qualité déterminante pour progresser dans la langue khmère .
J1 : Pour distinguer des consonnes aspirés et des consonnes non aspirés (l'écoute et la prononciation).
· Non (4/20) Si non, pourquoi ?
FF3 : bonne oreille, bonne mémoire.
FF4 : des amis khmers et une habitude dentendre la langue.
FF17 : Parce que j'ai pris l'habitude d'entendre et de prononcer le khmer bien avant de l'étudier. Même si je ne comprenais pas, mon oreille s'y est accoutumée.
FF18 : Bon apprentissage de départ. Assez bonne oreille musicale.
- en syntaxe
· Oui (19/20) Si oui, lesquelles
FF1 : Il y a une grande différence entre la langue parlée et écrite. Même si lon maîtrise bien la syntaxe à lécrit, un Français peut ne pas comprendre un Khmer qui lui parle quand il parle de façon familière (ce problème est toutefois commun à toutes les langues).
FF2 : Problème de mémorisation des mots, de leurs orthographes et de leurs positions dans la phrase.
FF3 : difficultés à construire une phrase, savoir placer les mots dans le bon ordre.
FF4 : emploi consécutif de synonymes, particules de sens mal défini.
FF5 : La place des pronoms, la place et l'utilisation des classificateurs ou des mots génériques (je ne sais d'ailleurs pas la différence entre ces 2 termes ).
FF6 : la place des mots dans la phrase et l'importance primordiale du contexte pour une bonne compréhension du sens.
FF8 : Et négatif/euphonique/interrogatif. Place de l'adjectif. utilisation du sujet pour quelqu'un du même niveau social et d'âge. Surtout, problèmes avec ehIy )an nwg mij etc. ce genre de particules.
FF9 : RAS
FF10 : Il en a y beaucoup. En état actuel d'avancement, une des principes difficultés est la mémorisation des différentes particules, d'indication de temps notamment.
FF11 : Pour l'instant, je ne connais pas bien la syntaxe mais j'ai quelques difficultés pour le temps (ehIy nwg). Ces mots ont plusieurs sens, donc renforce la difficulté.
FF12 : La syntaxe n'est pas la même qu'en français. J'ai du mal avec l'usage des particules en fonction qu'elles sont utilisées seules ou avec d'autres groupes de mots (ex: Et).
FF13 : RAS
FF14 : L'ordre des mots dans la phrase diffère du français. Le plus difficile est de savoir placer certain petits mots comme Edr k_ ehIy et lexpression en 2 parties. Savoir quand les utiliser et où les placer dans la phrase.
FF16 : la syntaxe étant très rigoureuse en khmer, il est parfois difficile de savoir exactement l'ordre des mots dans la phrase. Au début de mon apprentissage, j'avais des difficultés avec le ehIy. L'emploi de classificateurs n'est pas évident non plus et au niveau lexical par exemple mes principales difficultés sont dans l'emploi de mot qui correspondent au contexte. C'est-à-dire qu'il est difficile par le dictionnaire de savoir employer un mot plutôt qu'un autre.
FF17 : Pour composer des phrases complexes. J'hésite sur les mots de liaisons sur la façon dont je dois relier les différentes proposition et sur leur ordre dans la phrase.
FF18 : La place des mots dans la phrase la non-utilisation de pronom personnel la redondance verbale.
FF19 : Le raisonnement chronologique dans la construction des phrases. Au contraire, certaines expressions très "concentrée" difficiles à interpréter. La maîtrise des auxiliaire )an, Et ehIy eTIb La décomposition de certains verbes : eTA mk La grande variété des mots savants : le cours de Professeur Loch Pleng permet peu à peu de découvrir quelques points de repère en ce domaine. NB. Le cours de thème en 2ème année me semble déterminant pour progresser : il pourrait être étoffé largement.
J1 : l'ordre des mots est complètement différent que celui de la langue japonaise.
· Non (2/20) Si non, pourquoi ?
FF6 : en première année pour le moment, pas de difficultés particulières.
FF15 : je suis déjà habitué avec le chinois à une syntaxe très différente des langues européennes; de plus, il y a beaucoup de similarités entre la syntaxe chinoise et khmère.
A propos de la culture courante :
Etes-vous déjà allé(e) au Cambodge ? Oui (8/20)
Non (12/20)
Si vous êtes déjà allé(e) au Cambodge, avez-vous été étonné(e) par les manières dagir et les comportements des Cambodgiens ?
Oui (8/20) Si oui ,
· quest-ce qui vous paraît particulièrement étonnant ?
FF2 : la pudeur, la violence rentrée, le manque d'intériosation de sentiment.
FF5 : La réserve et la modestie dont ils font preuve.
FF7 : le "oui " justement même quand on pense "non".
FF10 : la façon d'établir le rapport de communication entre individus.
FF13 : RAS
FF16 : le sourire
· Quest-ce qui vous paraît particulièrement différent de votre culture ?
FF1 : Je n'étais jamais au Cambodge, mais me permet de faire une remarque : je trouve (d'après ce que j'observe chez mes amis cambodgiens) que les Khmers utilisent plus le langage extra-verbal que les Français.
FF5 : La sagesse dans une gestion du temps et de l'espace "petit grain deviendra grand". Une façon de penser les rapports.
FF7 : L'absence d'une pensée conceptuelle, la place donnée à l'intuition, la très grande place des sentiments interpersonnels, la notion de respect lié à l'âge, la place immense de la famille , l'amour de la fête, la pudeur.
FF10 : la conception du temps, la conception du travail, les rapports entre individus.
FF13 : RAS
FF14 : Tout, la façon de penser et de se comporter (car la religion est différente) les rapports entre les gens, la prépondérance du groupe pour l'individu, le fait qu'ils disent "oui " tout le temps même s'ils ne comprennent pas.
FF16 : La façon de vivre, l'habitat, le rythme de la vie, (qui commence très tôt), le deuil par exemple, l'architecture, l'alimentation.
FF17 : La prépondérance des coutumes rends le comportements choquants et traditionnels, les niveaux de langage, le comportement en présence d'autrui.
FF18 : Les conventions sociales, familiales et bien sûr la vie religieuse, culturelle.
FF19 : Les influences religieuses si différentes, la notion de péché, du châtiment dans les religions chrétiennes qu'on ne retrouve pas, l'idée de synthèses, moins perceptible semble-t-il dans le raisonnement cambodgien.
· Non (5/20) Si non, pourquoi ?
FF5 : Parce qu'elles sont proches de la nature.
FF6 : En étant ouvert aux autres cultures, l'étonnement devient richesse. De toute façon, mon séjour a été trop court pour l'étonnement en profondeur.
FF14 : Car j'avais déjà lu des livres sur la culture khmère et que je m'attendais à voir des comportements différents des miens.
FF18 : Non, a priori puisque tout culture différencie induit des étonnements (même si en voyage en Europe), donc il ne peut s'arrêter, mais les observer.
FF19 : N'étant jamais retourné au Cambodge depuis 1979, ma femme semble éprouver de l'appréhension à l'idée de s'y retrouver.
Pensez-vous quil serait intéressant détudier des spécificités culturelles :
- de type extra-verbal (la gestuelle, les comportements, etc. ) ? Oui (19/20)
Non (1/20)
- de type verbal (salutations différentes en fonction de linterlocuteur, différences dans les remerciements, etc.) ? Oui (20/20)
Non (0/20)
Pensez-vous que ces spécificités culturelles sont suffisamment étudiées en cours ?
· Oui (10/20) Si oui , précisez lesquelles et sous quelles formes ?
FF1 : On prend un peu de temps pour évoquer l'utilisation de certains mots (famille , ) qui sont en rapport avec la culture. En 2ème et 3ème année, il serait intéressant de regarder souvent des cassettes vidéo khmères (comme nous avons fait pour le nouvel an), car on apprend des choses sur la culture, et nous entraîne à la compréhension orale.
FF2 : les fonctions de politesse, les habitudes sociologiques, cultures, etc.
FF5 : Les redondances pour exprimer les choses et la logique dans la composition des mots et la construction des phrases avec l'emploi de certains pronoms ou noms plutôt que d'autres.
FF7 : Les exemples sont bien choisis dans la vie quotidienne. Pour les jeux de rôle, c'est une très bonne idées mais encore font-ils que les étudiants aient envie de jouer.
FF9 : Par exemple, la différence entre le "oui" pour les hommes et le "oui" pour les femmes. Egalement, les différents termes en fonction du sexe et de l'âge de signer une personne khmère.
FF12 : Nous avons étudié en cours les "appelatifs". Théoriquement, nous savons comment nous adresser à notre interlocuteur. Mais pour ce qui est de la gestuelle ou de la façon de se comporter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, nous n'en savons pas bien, ce serait peut-être bien d'aborder les "codes de politesse" comme en France.
FF17 : Par le niveau du langage.
FF19 : Les spécificités verbales sont étudiées en cours, celles de types extra-verbal sans doute mieux.
· Non (7/20) Si non, sous quelle forme souhaiteriez-vous quelles soient abordées ?
Articles de journal (8/20)
Documentaires de télévision (12/20)
Informations télévisées (7/20)
Films de réalisateurs cambodgiens (12/20)
Autres. Précisez (6/20)
FF3 : jeux de rôle, mise en situation, discussion.
FF6 : rencontre dans le milieu purement khmer.
FF8 : Expériences personnelles : professeur de français et de cambodgien établissent parallèles/différences cultures + surprises au 1er abord du pays liées à ces mêmes différences.
FF10 : Je ne suis qu'en 1ère année, cela me paraît normal. Ceci dit, j'apprécie beaucoup que ces textes que nous étudions comportent beaucoup d'éléments culturels. Les explications de textes (vocabulaire + syntaxes) y font aussi beaucoup référence, ce qui est une bonne chose.
FF12 : Les légendes ou les contes que l'on raconte aux enfants, ce qui fait partie de la culture de l'Asie du sud-est ou plus précisément du Cambodge sur quels principes repose l'éducation des enfants cambodgiens ?
FF16 : sur l'analyse des manuels scolaires cambodgiens, je pense que les manuels scolaires peuvent apprendre beaucoup sur la gestuelle, les comportements, les mentalités puisque les enfants apprennent par ces livres à lire, à écrire. Les présences de la culture passent par les manuels scolaires donc je pense que l'on peut voir à travers cela l'évolution, les changements de mentalités, l'éducation, l'évolution du vocabulaire.
FF18 : le maximum de visuel.
Les motivations de lapprentissage de la langue khmère
Avant vos études de khmer, par quel biais aviez-vous abordé la culture et/ou la langue khmère ?
- la littérature (7/20)
- le cinéma (4/20)
- des documentaires (7/20)
- les journaux (7/20)
- des contacts avec des amis cambodgiens (12/20)
- des voyages au Cambodge (7/20)
- autres. Précisez (8/20)
FF1 : J'ai commencé à apprendre le khmer avec une Cambodgienne.
FF4 : les productions artistiques.
FF5 : Le vécu de mes parents, frères et surs plus âgés.
FF6 : photos de famille , livres d'art, souvenirs familiaux.
FF7 : la musique traditionnelle et les divers orchestres qui la composent.
FF8 : Secrétariat / archivage dans une association de parrainage d'enfants au Cambodge et karaoke.
FF12 : L'envie de travailler et vivre dans un pays au passé et à l'actualité à la fois riches et parfois difficiles.
FF17 : livres sur l'histoire récente du Cambodge.
FF19 : RAS
Est-ce que vous vous considérez comme bilingue ?
· Oui (2/20)
FF5 : mais pas à partir du cambodgien.
FF18 : non en khmer.
· Non (18/20)
Pourquoi étudiez-vous le khmer aux Langues Orientales ?
- pour parfaire votre connaissance en langue (11/20)
- pour parfaire votre connaissance de la culture khmère (11/20)
- pour avoir un diplôme (5/20)
- pour utiliser cette langue en France dans votre profession (1/20)
- pour compléter votre cursus universitaire (5/20)
- pour utiliser cette langue dans votre projet de recherche ou détude (8/20)
- pour accéder à la culture cambodgienne (11/20)
- pour aller travailler au Cambodge (10/20)
- pour des raisons familiales : époux / épouse cambodgien(ne), (1/20)
enfants adoptifs cambodgiens, parrainage (2/20)
- Autres. Précisez (6/20)
FF3 : Parce que le sud-est asiatique m'intéresse en général et le Cambodge en particulier, sous arguments plus précis.
FF4 : Vie en concubinage avec un cambodgien.
FF7 : Apprendre toute sa vie durant. C'est une bonne gymnastique pour l'esprit.
FF4 : Pour des raisons religieuses.
FF15 : Passer le concours de secrétaire cadre d'Orient des affaires étrangères.
J1 : Pour travailler en tant que spécialiste du Cambodge au Ministère des affaires étrangères au Japon.
Êtes-vous plus attiré par la langue khmère que par la culture ?
· Oui (2/20) Pourquoi ?
FF5 : Parce qu'elle pourra être un moyen indispensable de communication et ainsi de connaissance plus profonde des gens.
FF18 : Oui, pour pouvoir "me débrouiller" seule là-bas et avoir des contacts directs.
· Non (18/20)
FF1 : Je suis attirée par la langue et la culture. Toutefois, bien que les cours de civilisation expliquent l'histoire, la géographie je pense que la culture est aussi dans les gestes, les réflexes, comportements, et cela ne se découvre pas en cours, mais au contact des Cambodgiens.
FF4 : Parce que la langue et la culture forment un tout cohérent et à mes jeux indissociable.
FF6 : Pour moi, c'est un tout : la langue est belle, la culture aussi.
FF8 : les deux sont aussi intéressants et nécessaires pour communiquer réellement.
FF9 : Je suis attiré par les deux.
FF10 : Je suis également attiré par l'une et par l'autre qui sont intimement liées.
FF11 : La langue est certes importante, surtout avec le khmer qui est une langue de "référence" pour cette région, mais je m'intéresse principalement à la sociologie, aux civilisations, à l'histoire,
FF12 : C'est un ensemble. La langue seule ne permet pas de connaître le Cambodge et son peuple.
FF14 : Les deux m'intéressent autant. L'étude de la langue permettant également une étude de la culture khmère.
FF15 : Culture très intéressante et attirante (Angkor, )
FF16 : Je ne peut pas apprendre une langue sans connaître la culture et inversement. Si j'apprends une langue, je souhaite apprendre la culture de la langue pratiquée.
FF17 : C'est un tout.
FF18 : Car culture et langue pour 1 pour moi.
FF19 : L'une ne va pas sans l'autre : cela semble être particulièrement vrai pour le khmer : textes classiques, religieux, contes (sans doute les plus intéressants)
J1 : Je suis attiré par les deux. On doit avoir des connaissances étendues sur les deux pour analyser le Cambodge précisément et aussi profondément.
Voudriez-vous apprendre uniquement la langue ?
· Oui (1/20) Pour quelles raisons ?
FF17 : Je pourrai faire plus de langue et étudier par moi-même pour le reste (au niveau du DULCO).
· Non (19/20)
FF1 : Car la civilisation du Cambodge m'intéresse aussi, et le fait que les cours de civilisation concernent souvent quelques autres pays du Sud-Est asiatique, cela me fait un peu connaître d'autres pays, ce qui est intéressant aussi.
FF2 : On n'étudie jamais la langue pour la langue mais comme un instrument de découverte et de connaissance de la culture.
FF3 : Si je vais plus tard au Cambodge sans connaître la culture khmère, la civilisation, l'histoire du pays, il me sera plus difficile de rentrer en contact avec les gens. De toutes façons ce qui est histoire, civilisation, etc. m'intéresse.
FF4 : Parce que la langue n'est qu'un aspect de la culture et que la connaissance de la langue seule ne met pas en lumière certaines particularités culturelles.
FF5 : Parce qu'il me semblerait trop "osé" et irrespectueux d'avoir le désir de rencontrer, d'approcher les gens sans un minimum de connaissance du cadre et de leur mode de vie.
FF6 : Pour la même raison culturelle et gratuite que la question précédente (pour moi, c'est un tout : la langue est belle, la culture aussi).
FF7 : Il n'y a pas de culture qui ne s'exprime aussi pas les mots.
FF9 : Je m'intéresse à la langue et à la culture cambodgienne car cela me permettra de mieux comprendre le mode de vie des personnes khmères.
FF10 : Mais je reconnais ne pas avoir le temps de suivre les cours de civilisation. Dans le cadre de l'Inalco, je donne la priorité à la langue. D'une forme générale, j'éprouve beaucoup de plaisir à suivre les cours de langues (CAM), tant en ce qui concerne la substance que la forme. L'ambiance est très bonne, à la fois décontractée et instructive. C'est très stimulant.
FF11 : Cela ne sert à rien, si l'on ne sait pas quand, comment utiliser cette langue. Un apprentissage exclusif de la langue pourrait me paraître ennuyeux.
FF12 : Ca paraît presque impossible. Que ce soit dans les cours de M. Daniel et de M. Yiseang, chaque fois que l'on parle, on se situe par rapport à la culture khmère, à l'imaginaire cambodgien et aux habitudes de vie du pays.
FF14 : Cela me semblerait insuffisant car la connaissance de la culture khmère est essentielle pour mon futur travail. Et la langue ne donne qu'un aperçu de la culture.
FF15 : la langue est inutile dans la culture autour.
FF16 : Parce que pour moi, la langue et la culture ne peuvent être séparées. Rien que dans l'emploi de certains mots, dans la formation de mots, cela dépend de la culture également. Si la culture est différente, les propositions, les réactions seront différentes.
FF19 : Cette approche me semblait hasardeuse. A ce titre, l'étude alternée de textes modernes et classiques est une bonne solutions : références culturelles nombreuses dans les textes littéraires classiques, contes
J1 : Pour être spécialiste du Cambodge, je dois avoir connaissance pas seulement sur la langue mais aussi sur la culture, la politique, l'économie etc.
Réponses au Questionnaire
destiné aux étudiants de khmer dorigine cambodgienne de lInalco
1. FC1, étudiante, 19 ans, 1ère année
2. FC2, étudiant, 25 ans, 2ème année
3. FC3, étudiante, 19 ans, 2ème année
4. FC4, étudiant, 22 ans, 2ème année
5. FC5, étudiante, 29 ans, 2ème année
6. FC6, étudiant, 23 ans, 2ème année
7. FC7, étudiante, 19 ans, 2ème année
8. FC8, étudiante, 28 ans, 3ème année
9. FC9, étudiante, 35 ans, 2ème année
10. FC10, étudiante, 27 ans, 4ème année
11. FC11, étudiante, 24 ans, 4ème année
12. FC12, étudiante, 19 ans, 1ère année
Profil sociologique
Tranches d'âge : moins de 20 ans : 4/12 (F)
Entre 20 et 26 ans : 4/12 (1F et 3H)
Plus de 26 ans : 4/12 (F)
Nationalité : Française : 7/12 (6F et 1H)
Cambodgienne : 4/12 (2F et 2H)
Canadienne : 1/12 (F)
Exercez-vous une activité professionnelle parallèlement à vos études ?
· Oui (3/12) Si oui, laquelle ?
FC4 : Je travaille pour la mairie de Paris.
FC5 : Surveillante
FC12 : Surveillante école maternelle.
· Non (9/12)
Le khmer est-il votre cursus principal ?
· Oui (6/12)
· Non (6/12) Si non, quel est votre cursus principal ?
FC3 : DEUG LEA
FC6 : études de thaïlandais
FC7 : DULCO de chinois en 2ème année
FC 10 : études de japonais
FC11 : Sociologie
FC12 : LLCE Anglais Paris III Sorbonne-Nouvelle
Avez-vous encore de la famille au Cambodge ?
· Oui (11/12) Si oui, quels sont les liens familiaux et quels rapports entretenez-vous avec ces personnes ? (correspondance régulière, aides financières, etc.)
|
FC1 : Il me reste une tante et beaucoup de cousins. Jai déjà rencontré une fois ma tante et un de mes cousins. FC2 : Tante, oncle, cousins et cousines. Aides financières. FC3 : Tante et cousins, correspondance, appels téléphoniques. FC4 : Correspondance régulière. FC5 : Lettres, aides financières. FC6 : Aucun rapport si ce nest que des voyages au Cambodge. |
FC7 : Cousins et cousines des parents, avec qui ils communiquent par lettres. FC8 : Oncles, tantes, cousins, cousines, téléphoner occasionnellement. FC9 : Cousins FC11 : Cousins, correspondances et visites. FC12 : Oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et familles éloignées.
|
· Non (1/12)
Etes-vous déjà allé(e) au Cambodge ?
· Oui (7/12) Si oui , quand et pendant combien de temps y êtes-vous resté(e) ?
FC1 : 3 semaines (décembre 1996)
FC4 : Eté 1998
FC5 : Une semaine en 1991
FC6 : Un mois en 1995
FC8 : 2 ans à Phnom Penh (divers séjours dont un de 4 mois)
FC9 : 15 jours (4/10/1998)
FC11 : Un mois en 1995 et un mois en 1998
· Non (5/12)
Lors de votre séjour au Cambodge, séjourniez-vous dans votre famille ?
· Oui (2/12)
· Non (7/12)
Situation familiale
Père : Quel âge a votre père ? ans (10 réponses/12)
· 47 ans (FC1), 48 ans (FC7, FC12), 49 ans (FC2), La cinquantaine (FC6), 58 ans (FC9), 52 ans (FC3), 55 ans(FC4), 60 ans(FC8, FC11)
Quel est son niveau détude ?
· Bac (FC9, FC12), Bac + 4 (FC4), 2ème cycle (FC8), Master Degree (FC11)
Quelle était sa profession au Cambodge ?
· Etudiant (FC1), Agriculteur (FC2), Lieutenant colonel ( FC4), Travailler au magasin détat (FC8), Militaire(FC9), Ingénieur mécanicien(FC11).
Et sa profession actuelle ? ..
· Expert comptable (FC1), Artisan, chauffeur de taxi (FC2), Retraité (FC4, FC6), Vendeur (FC7), Ambassadeur (FC8), Sans profession (FC9), Traducteur (FC11).
Mère : Quel âge a votre mère ?
ans (11 réponses/12)
· 39 ans (FC3), 41 ans (FC7), 43 ans (FC1, FC12), 47 ans (FC2), 49 ans (FC8), 50 ans (FC4), La cinquantaine (FC6), 55 ans (FC10), 57 ans (FC9), 58 ans (FC11).
Quel est son niveau détude ?
· Primaire (FC9), 3 ans de scolarité (FC10), 5ème au Collège, Bac (FC1, FC8)
· Vendeuse (FC4), Sans profession (FC8), Femme au foyer (FC9), Patronne (FC10), Professeur de français (FC11)
Et sa profession actuelle ? (9 réponses/12)
· Mère au foyer (FC1), Sans profession (FC2), Retraité (FC6), Couturière (FC7, FC12), Assistante dentaire (FC8), Employée de maison (FC9, FC10), sacristine (FC11),
Habitez-vous chez vos parents ? Oui (6/12)
Non (6/12)
Avez-vous des frères et des surs ?
· Oui (12/12) Si oui, indiquez leur âge
(FC1 : 22, 19, 9), (FC2 : 21, 20, 13), (FC3 : 2 surs : 17, 12), (FC4 : 32, 30, 25, 20), (FC5 : Une sur 32), (FC6 : la trentaine et la vingtaine), (FC7 : 13, 11, 6), (FC8 : Une sur de 24), (FC9 : 32, 17), (FC10 : 32, 37), (FC11 : 36, 29, 19, 12), (FC2 : 25, 16, 8, 5)
· Non (0/12)
Etes-vous marié(e) ?
· Oui (2/12)
Si oui , votre conjoint(e) est-il(elle) dorigine : - cambodgienne ? Oui (0)Non(2)
- asiatique ? Oui (0)Non (2)
· Non (10/12)
Langues
Quelle langue utilise-t-on au
quotidien dans votre famille
? française (4/12)
khmère (1/12)
française et khmère (7/12)
Si vous utilisez le khmer, de quelle façon le maîtrisez-vous? Lu (4/12)
Parlé (6/12)
Ecrit (4/12)
- Maîtrise orale : Je parle couramment (5/12)
Je me débrouille (5/12)
Je comprends mais je ne peux pas mexprimer (1/12)
- Maîtrise écrite : Je peux le lire Très facilement (2/12)
Facilement (5/12)
Difficilement (4/12)
Je peux lécrire Très facilement (2/12)
Facilement (5/12)
Difficilement (4/12)
En dehors du français et du cambodgien, quelle(s) langue(s) connaissez-vous ?
( très bonne maîtrise , bonne maîtrise?, passable ? )
Citez les principales :
|
Langues occidentales |
Rudimentaire |
Passable |
Très bonne maîtrise |
|
Anglais |
1 |
8 3 1 |
4 |
|
Langues occidentales |
Rudimentaire |
Passable |
Très bonne maîtrise |
|
Chinois Cham |
|
2
1 |
1 |
Si vous avez des frères et des surs, dans quelle langue, communiquez-vous le plus facilement avec eux ?
française (6/12)
khmère (0/12)
française et khmère (6/12)
Sil vous arrive dutiliser le français et le khmer, dans quel contexte utilisez-vous (à la maison, avec les amis, etc.)
· le khmer ? . (11/12)
FC2 : avec mon grand-père et la famille extérieure (tante, oncle, )
FC3 : à la maison, chez la famille .
FC4 : à la maison, devant les amis quand cest privé.
FC5 : à la maison, dehors.
FC6 : avec les potes ou des vieilles personnes.
FC7 : à la maison, avec la famille
FC8 : avec mon fils et surtout quand je ne veux pas que lentourage français comprenne.
FC9 : à la maison avec les parents.
FC10 : Avec les amis.
FC11 : à la maison, avec certaines copines.
FC12 : De temps en temps à la maison.
· le français ? (11/12)
FC2 : Mes frères et surs, les amis, mes parents de temps en temps.
FC3 : avec les amis, en dehors de la maison.
FC4 : à la maison, avec les amis.
FC5 : à la maison, dehors
FC6 : Avec les potes.
FC7 : avec les amis.
FC8 : en général, je parle français.
FC9 : avec les amis.
FC10 : à la maison, dans les loisirs (danse, école )
FC11 : avec tout le monde
FC12 : tout le temps.
Enseignement de la langue et de la culture
Eprouvez-vous des difficultés particulières :
- en phonétique
· Oui (2/12) Si oui , lesquelles ..
FC10 : Je prononce les consonnes finales. Le r est difficile à dire. Je narrive pas à construire les phrases des redoublements de la même consonne. Je ne fais pas bien la différence entre la 1ère et la 2ème série. Certaines sonorités sont maîtrisées parce que cest ma langue maternelle : reconnaissance passives des voyelles.
FC11 : Car certaines mots sont prononcés dune certaine façon par les gens de mon entourage et quà lécriture, ce nest pas la même façon de prononcer.
· Non (9/12) Si non, pourquoi ?
FC1 : Parce que je pense que mon oreille a été habituée depuis que je suis née à entendre du cambodgien tous les jours. Pour moi, lorsque jai commencé cette langue, il ny avait rien de bien nouveau au niveau de la phonétique.
FC2 : avec lhabitude dentendre parler mes parents. Mais, jai encore « un accent français ».
FC3 : Jai déjà la maîtrise des sons car je parle la langue à la maison.
FC4 : je parle cambodgien depuis toujours.
FC6 : bonne mémoire visuel et auditive.
FC7 : Car les sons me sont familiers.
FC8 : Pas de difficultés particulières pour les mots dorigine khmère mais en ce qui concerne les termes dorigine sanscrite, je trouve quil est plus difficile de les prononcer à cause de la longueur des mots et de leur lecture (ou déchiffrage).
FC9 : Jai appris la langue depuis ma petite enfance et jai vécu au Cambodge jusquà lâge de 17 ans.
- en syntaxe
· Oui (6/12) Si oui , lesquelles
FC1 : Au niveau de la place des adjectifs (surtout quand il y en a plusieurs pour un seul nom : exemple, la jolie petite maison).
FC2 : Je confonds encore de temps en temps la syntaxe française avec la syntaxe cambodgienne, cest-à-dire que jai encore tendance à prononcer des phrases en cambodgien qui sont typiquement française. Mais ces phrases restent compréhensibles.
FC7 : Certains mots sont nouveaux pour mois ; beaucoup de différences entre la langue parlée et écrite.
FC8 : Etant donnée que la syntaxe est différente de la syntaxe française, il me semble difficile de former des phrases correctes, cest-à-dire avec les bons mots de liaison.
FC10 : Impossible de construire une phrase longue sans traduire du français. Certaines locutions de temps ou de lieux ne sont pas claires. Problème pour trouver le sujet de la phrase.
FC11 : Certaine structure ne se situe pas dans les mêmes ordres en français et en français ou en anglais.
· Non (4/12) Si non, pourquoi ?
FC3 : Pour la même raison quen phonétique [Jai déjà la maîtrise des sons car je parle la langue à la maison.]
FC6 : Bonne mémoire visuelle et auditive.
FC9 : Pour la même raison quen phonétique [Jai appris la langue depuis ma petite enfance et jai vécu au Cambodge jusquà lâge de 17 ans.]
A propos de la culture courante :
Si vous êtes déjà allé(e) au Cambodge, avez-vous été étonné(e) par les
manières dagir et les comportements des Cambodgiens ?
Oui (7/12) Si oui ,
· quest-ce qui vous paraît particulièrement étonnant ?
FC4 : Lorsquon va là-bas, les Khmers nous regardent avec rancur car pour eux, nous sommes des privilégiés.
FC8 : Le nouveau vocabulaire utilisé comparé à celui que jai lhabitude dentendre et le manque de « bonnes manières ». La crainte, la peur, toujours présentes, réactions aux rumeurs de coup détat, danger. Limportance de la famille , le respect des personnes âgées.
FC11 : En 1995, très aimable, ils étaient étonnés du fait que je parlais encore cambodgien. En 1998, beaucoup plus hostile vers les Cambodgiens de létranger.
· quest-ce qui vous paraît particulièrement différent de ce qui se passe en France ? ..
FC1 : Les Cambodgiens sont beaucoup plus aimables et attachants que les Français. La vie est beaucoup plus simple.
FC4 : Les murs ne sont pas les mêmes, le niveau de vie est différent. Les gens sont plus rattachés aux traditions quau modernisme.
FC5 : Quasiment tout, rien nest comparable (langue, tradition, façon de vivre ) ou semblable entre les deux pays et cela me convient parfaitement.
FC6 : Les gens qui vous regardent différemment et ne comprennent pas les nouvelles mentalités, des nouvelles générations asiatiques.
FC9 : Les Cambodgiens sont plus accueillants et plus souriants.
FC11 : La façon de cuisiner, je narrive pas à cuisiner au feu de bois, question dhabitude avec lélectricité.
Non (4/12) Si non, pourquoi ?
FC1 : Car je connaissais déjà la culture et les murs cambodgiens par mon père.
FC5 : Parce que quand jai quitté ce pays, javais 13 ans, de ce fait, jétais imprégnée, baignée par la culture cambodgienne. Je la connaissais suffisamment pour ne pas être étonnée.
FC6 : Jai vécu en Asie.
FC9 : Jai connu ces manières et ces comportements.
Pensez-vous quil serait intéressant détudier des spécificités culturelles :
- de type extra-verbal (la gestuelle, les comportements, etc.) ?
Oui (12/12)
Non (0/12)
- de type verbal (salutations différentes en fonction de linterlocuteur, différences dans les remerciements, etc.) ?
Oui (12/12)
Non (0/12)
Pensez-vous que ces spécificités culturelles sont suffisamment étudiées en cours ?
Oui (1/12) Si oui, précisez lesquelles et sous quelles formes ?
FC4 : Il est toujours intéressant détudier la caractéristique dun peuple, cest ce quil fait son authenticité.
Non (11/12) Si non, sous quelle forme souhaiteriez-vous quelles soient abordées ?
Articles de journal (4/12)
Documentaires de télévision (9/12)
Informations télévisées (6/12)
Films de réalisateurs cambodgiens (9/12)
Autres. Précisez .. (5/12)
FC1 : Ce serait bien que le professeur nous en parle avec son expérience personnelle.
FC4 : Le Cambodge est toujours synonyme de guerre et misère. Il faut montrer la richesse culturelle de ce pays.
FC5 : faire venir des intervenants cambodgiens pendant une journée ou un cours.
FC6 : introduire ces notions dans les cours de cambodgien sous forme de textes.
FC11 : Publicité en cambodgien. Les images véhiculées par les différentes sociétés.
Les motivations de lapprentissage de la langue khmère
Quand votre apprentissage de la langue khmère
a-t-il commencé ?
- dès la toute petite enfance avec lecture et écriture Oui (2/12)
Non (10/12)
- plus tard, lorsque vous en avez exprimé le désir Oui (10/12)
Non (2/12)
Est-ce que vous vous considérez comme bilingue ? Oui (6/12)
Non (6/12)
Pourquoi étudiez-vous le khmer aux Langues Orientales ?
- pour parfaire votre connaissance en langue (9/12)
- pour parfaire votre connaissance de la culture khmère (10/12)
- pour avoir un diplôme (4/12)
- pour utiliser cette langue en France dans votre profession (2/12)
- pour compléter votre cursus universitaire (2/12)
- pour perfectionner une langue que vos parents parlent à la maison, langue familiale (9/12)
- pour accéder à la culture cambodgienne (4/12)
- pour retourner vivre au Cambodge (3/12)
- pour aller travailler au Cambodge (1/12)
- Autres. Précisez (6/12)
FC1 : pour faire du tourisme au Cambodge.
FC3 : pour pouvoir travailler en Asie.
FC4 : A long terme, devenir directeur dans compagnie internationale pour les échanges import-export franco-asiatiques.
FC10 : par curiosité : connaître une deuxième langue asiatique et en déduire la façon de penser les phrases, de penser la vie en Asie.
FC11 : pour pouvoir mieux mexprimer avec ma famille .
FC12 : devenir interprête/traducteur.
Etes-vous plus attiré(e) par la langue khmère que par la culture ?
· Oui (0/12)
· Non (12/12) Pourquoi ? .
FC1 : Parce que ça ne sert à rien, daprès moi, de parler une langue et de lapprendre si on ne connaît pas la culture du pays. La culture a des influences directes sur la langue.
FC2 : Je suis autant attiré par la langue que par la culture.
FC3 : La langue est indissociable à la culture : la culture se reflète dans le langage donc il faut la comprendre pour bien parler.
FC4 : Je suis autant attiré par lune et lautre.
FC6 : un minimum permet ensuite de se perfectionner dans cette langue.
FC7 : Car langue et culture se complètent dans lapprentissage dune langue vivante.
FC9 : La langue et la culture sont liées pour bien comprendre la langue et il faut connaître la culture aussi.
FC11 : Je ne suis pas attiré par la linguistique.
FC12 : Jadore la culture khmère en elle-même et il serait bête de vouloir juste connaître la culture et pas avec la langue.
Voudriez-vous apprendre uniquement la langue ?
· Oui (1/12) Pour quelles raisons ? ...
FC12 : Parce que ma famille au sens large parle autant khmer que cham et parce que je veux savoir le parler.
· Non (11/12) Pour quelles raisons ? ...
FC1 : Si japprends le cambodgien, cest en partie pour lappliquer lorsque je me rendrai là-bas. De toute façon si on apprend le khmer, on est obligé den savoir un minimum sur la façon de vivre et de voir les choses des Cambodgiens afin de pouvoir appliquer correctement les appellatifs selon la hiérarchie et tout plein dautres choses qui nexistent pas en France.
FC2 : Lhistoire, léconomie, la géographie, les coutumes, etc. sont aussi très importants quand on veut connaître son pays dorigine.
FC5 : Cest parfaire la langue khmère par ce biais, je peux facilement accéder à la culture, laquelle reste encore floue pour moi.
FC6 : Culture est importante pour permettre détablir relation entre les peuples dAsie et européens.
FC7 : Car langue et culture se complètent dans lapprentissage dune langue vivante.
FC8 : la langue et la culture forment un tout indissociable.
FC9 : Je ne voudrais pas apprendre uniquement la langue mais aussi la civilisation.
FC10 : Langue et culture, ainsi que la civilisation sont liés et complémentaires dans lapprentissage de la langue en elle-même. Parler, cest aussi dire. Pour comprendre et se faire comprendre, les mots sont insuffisants.
FC11 : Une langue se comprend avec sa culture aux certaines expressions et unique à la cette culture.
Annexe n°2 : Le texte de la chanson intitulée « Veuf sans avoir été marié »
eBaHm:ay xan;søa
[pu«h maùj kHan slaù]
[veuf sans les fleurs darec]
« Veuf sans avoir été marié »
q¶aj; Nas; eTAb¤ TwkR)ak; bI lan ePøc l¥ Rtdr cg; man
[cHNAø| nAh t«® r®ù t«k|prA/ bei li«n| pHlic l/Aù tradAù cAN mi«n|]
/savoureux très ou non ? somme trois million oublier bon faire semblant vouloir riche/
« Est-il souhaitable de recevoir 3 millions pour oublier ce qui (nous) est cher et de faire alors semblant dêtre riche ? »
eXIj R)ak; eRsk Xøan han lk; kUnRsI ekatNas; RkLas; ERb pøas; sMdI
[kHÎùø pra/ sreùk| kHli«n| hi«n| luo/ koùnsrei kaot|nah kraùlah praE pHah sAmdei]
/voir argent soif faim oser vendre fille incroyable tourner changer remplacer parole/
« Après avoir vu largent, (la famille de la fille) a soif de richesse et ose vendre sa fille. Cest incroyable de retourner sa veste,
Gs©arü eragkar sg; fµI [ ePJóv Rbus RsI cMGk LkLWy
[/Ahcaù roùN|kaù sAN tHmei aoj pHøi«B| proh srei cAm/A/ lA/lÎùj]
/fantastique tenture construire nouvelle PART. invités masculin féminin se moquer/
A quoi sert la tente qui venait dêtre montée ? Laisser les invités se moquer (de nous) »
xM Eck sMbuRt GaBah_BiBah_ ehA Gs; jatimitþ mIg ma GYt R)ab; eK fa
[kHAm cAEc sAmbot| aù pi« pipi« ha® /Ah øi«tm®t miN mi« /u«t| prab keù tHaù]
/efforcer distribuer lettre mariage appeler tous amis tante oncle vanter dire on PART./
« (Je me suis) efforcé de distribuer les invitations de mariage et dinviter les amis et la famille , (jai) vanté à tout le monde que
kar ´ FM Nas; éf¶ elIk CMnUn eK CUn edrdas
[kaù kHøom tHom nah tHNaj lÎùk| cumnun keù cun deùdah]
/mariage mon grand très jour apporter dots on accompagner grand nombre/
mon mariage serait très grand. Le jour où le cortège apporta la dot, beaucoup mont accompagné. »
´ edIr bJk dUc GgÁm©as; sb,aycitþ Nas; eK )aMgq½Rt [
[kHøom da« r®k| doùc /aNmcah sabaùj| c«t| nah keù baNcHat /aoj|]
/je marcher comportement comme prince content très on ombrer de parapluie pour/
« Je marchais comme un prince, (jétais) très content dêtre protégé du soleil par un parapluie. »
k,ÜnEhr dl; pÞH xagRsI rwtEt rMePIb hbJT½y nwkeXIj BrC½y éf¶ )ac páa søa
[kbu«n haE dal pHteah kHaùN srei r®t|taE rumpHÎùb ha/ratei n®k|kHÎùø pùcei tHNaj baùc pHkaù slaù]
/cortège arriver maison fille de plus en plus ému cur rêver vux jour lancer fleur arec/
« Quand le cortège arriva chez la mariée, (je fus) de plus en plus ému, (javais) déjà rêvé de la cérémonie du lancer des fleurs daréquier »
BueT§a ¡ Rsab;Et pÞúH ehtu Gs©arü eK sg éfø
[put|tHoù srab|taE pHtuh haEt| /Ahcaù keù sAN tHlaj]
/mon dieu soudain exploser fait extraordinaire on rembourse prix /
« Oh, mon dieu ! un fait extraordinaire survint soudainement : on (la famille de la mariée) me
bNþakar eK fa Elg kar kUn [ ´ ehIy GWeGIy ///
[bAndaùkaù keù tHaù lEø kaù koùn /aoj kHøom ha«j /Îù/Îùj
/dot on dit ne plus marier enfant avec moi plus interjection /
rembourse le prix de la dot en me disant quon ne donne plus la fille en mariage »
mÄÚs dl; bcäa eK fa min dut ekrþ× ´ Rbus Na min søút
[mcHuh dAl pac|cHaù keù tHaù m«n dot| keù kHøom proh naù m®n slot|]
/cercueil arriver crématorium on dit ne pas brûler réputation ma homme quel ne pas paralysé/
« Le cercueil arrivé au crématorium, on dit de ne pas le brûler. Quel homme ne verrait pas ainsi sa réputation compromise ? »
exµac Ehr eTA dut Ehr exµac mk vij twg RTUg esÞIr Føay niyay min ecj
[kHmaoc haE t«® dot haE kHmaoc mk Biø t«N truN stÎù tHli«j ni ji«j m«n ceø]
/cadavre emmené aller brûler emmené cadavre de retour serré poitrine presque explosé parler ne pas sortir/
« Le cadavre a été emmené pour être brûlé et a été ramené intact. (Jai) le cur gros et reste muet de stupéfaction »
xµaseK eBj Rkug PñMeBj eTamñijnwg eQµaH eBaHm:ay xan;søa
[kHmah keù piø knroN pHnum peø toù mniø n«N cHmu«h pu«h maùj kHan slaù
/honte toute ville Phnom Penh malheureux de nom veuf sans fleurs daréquier/
« (Jai) honte dêtre à Phnom Penh et (je suis) malheureux dêtre désormais veuf sans avoir été marié. »
Annexe n °3 : La comparaison entre le programme du cours depuis 1986 et le programme nouveau.
Le programme de cours depuis 1986
|
Code Module |
Code U.E. |
Intitulé |
|
CAM 101 |
Initiation au cambodgienPhonologie et théorie de lécriture du cambodgien (18h) Apprentissage de la lecture du cambodgien (27 h) |
|
|
(14 semaines) |
CAM 102 CAM 103 |
Cambodgien élémentaireEtude de textes élémentaires cambodgien (36h) Pratique orale élémentaire du cambodgien de base (54h) |
|
CAM 200 CAM 201 |
Théorie du cambodgien IGrammaire du cambodgien (27h) Compréhension écrite du cambodgien (27h) |
|
|
CAM 202 CAM 203 |
Pratique du cambodgien IPratique orale du cambodgien I (41h) Expression écrite cambodgienne I (41h) |
|
|
CAM 301 |
Théorie du cambodgien IILa traduction cambodgien-français (27h) Textes de civilisation cambodgiens (27h) |
|
|
CAM 302 CAM 303 |
Pratique du cambodgien IIPratique orale du cambodgien II (41h) Expression écrite cambodgienne II (41h) |
|
|
CAM 400 CAM 401 |
Méthodologie du cambodgien avancé (1er semestre) Méthodologie de la traduction en cambodgien (21h) Méthodologie de loralité en cambodgien (20h) |
|
|
CAM 402 CAM 403 |
Pratique du cambodgien avancée (2ème semestre) Pratique de la traduction avancée cambodgien-français (21h) Pratique avancée de loral cambodgien (20h) |
|
|
CAM 404 CAM 405 |
Expression cambodgienne moderne (1er semestre) Sélection darticles de presse en cambodgien (41h) Littérature romanesque moderne cambodgienne (41h) |
|
|
CAM406 CAM407 |
Expression cambodgienne contemporaine (2ème semestre) Champ lexical des termes techniques cambodgiens (20h) Littérature romanesque cambodgienne contemporaine (20h) |
Le programme nouveau
|
Module |
Intitulé |
|
1ère année (1er semestre)
|
Initiation au cambodgienPhonologie et théorie de lécriture du cambodgien |
|
1ère année (2ème semestre) |
Cambodgien élémentaireInitiation au cambodgien de base à loral et à lécrit Initiation à la pratique du cambodgien de base |
|
2ème année (1er semestre) |
Cambodgien intermédiaire IInitiation au cambodgien intermédiaire à loral et à lécrit Initiation à la pratique du cambodgien intermédiaire |
|
2ème année (2ème semestre) |
Cambodgien intermédiaire IIPratique de lécrit en cambodgien II Pratique de loral en cambodgien II |
|
3ème année (1er semestre) |
Cambodgien avancé ICambodgien avancé à loral et à lécrit Analyse de textes de civilisation en cambodgien |
|
3ème année (2ème semestre) |
Cambodgien avancé IIPratique de lexposé oral en cambodgien Expression écrite cambodgienne |
|
4ème année (1er semestre) |
Cambodgien de perfectionnementExpression écrite et orale Etudes de documents audiovisuels authentiques |
Expression cambodgienne moderneLecture de la presse écrite cambodgienne Littérature romanesque moderne cambodgienne |
|
|
4ème année (2ème semestre)
|
Pratique du cambodgien de perfectionnementProblématique et pratique de la traduction Perfectionnement de la pratique de loral en cambodgien |
Expression cambodgienne contemporaineLangue et vie quotidienne au Cambodge Littérature romanesque cambodgienne contemporaine |
Annexe n° 4
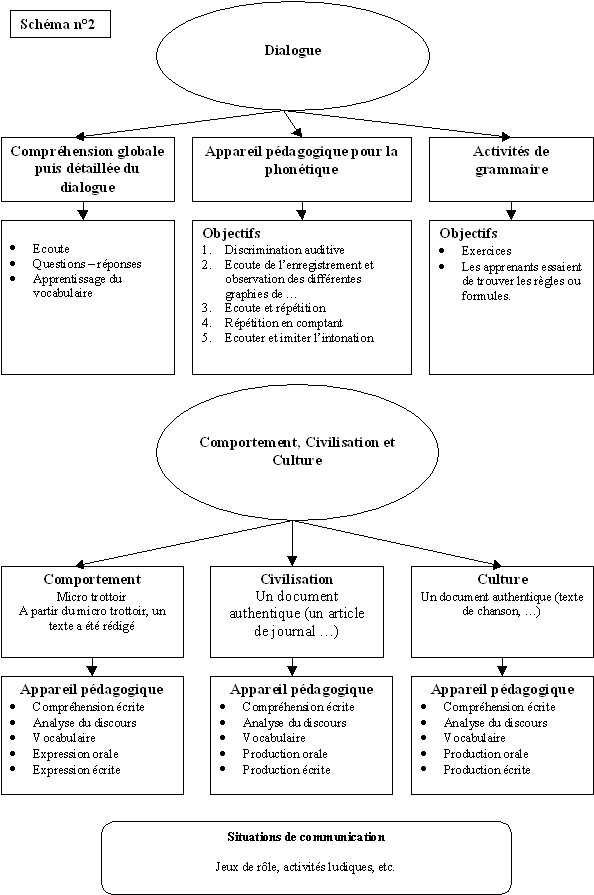
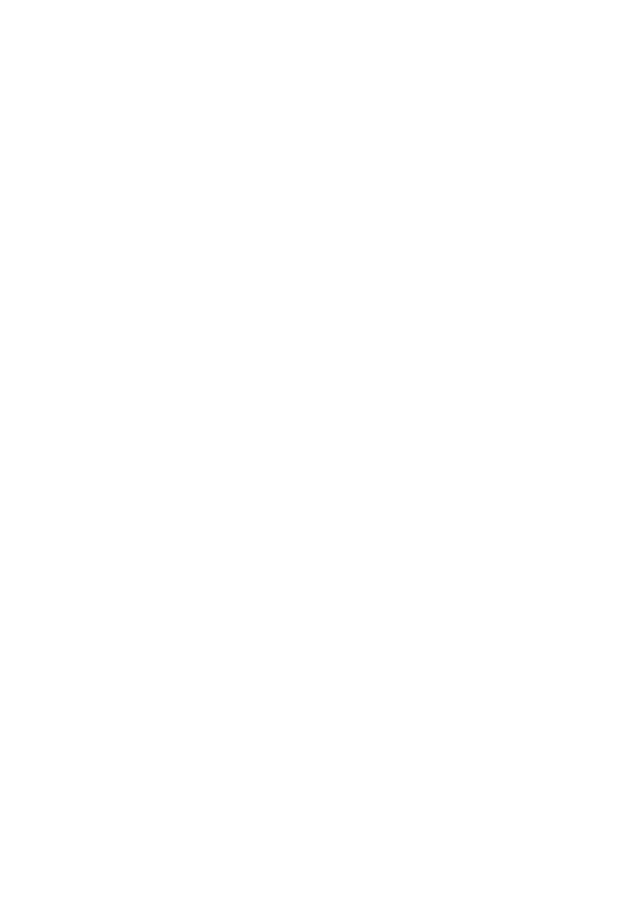
Annexe n° 5
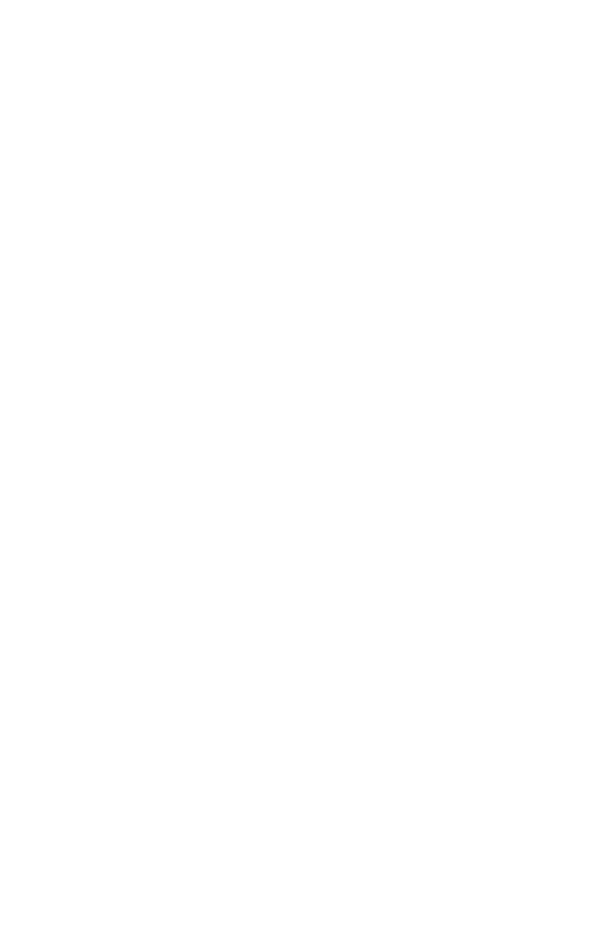
Annexe n° 6 : Tableaux récapitulatifs des voyelles et des consonnes des deux langues khmer-français
Tableau comparatif des voyelles des deux langues
|
Orales |
|
Nasales |
||||
|
khmer |
Français |
|
khmer |
Français |
||
|
Série [α] |
Série [1] |
|
|
Série[α] |
Série[1] |
|
|
|
[i] |
[i] |
|
|
|
[ã] |
|
|
|
[y] |
|
|
|
[õ] |
|
|
[u] |
[u] |
|
|
|
[Ì] |
|
|
|
[a] |
|
|
|
[¤] |
|
[a] |
|
[a] |
|
[om] |
[um] |
|
|
|
[e] |
[e] |
|
[αm] |
[um] |
|
|
|
[e] |
[e] |
|
[am] |
[oam] |
|
|
|
[ø] |
[ø] |
|
|
|
|
|
|
|
[æ] |
|
|
|
|
|
[o] |
|
[o] |
|
|
|
|
|
|
[1] |
[1] |
|
|
|
|
|
[2] |
|
[2] |
|
|
|
|
|
[w] |
[w2] |
|
|
|
|
|
|
Diphtongues (longues) |
|
Aspirées (brèves) |
||||
|
khmer |
Français |
|
khmer |
Français |
||
|
Série [α] |
Série [1] |
|
|
Série[α] |
Série[1] |
|
|
[ei] |
|
|
|
[ah] |
[eah] |
|
|
[ñ2] |
[ñ2] |
|
|
[Áh] |
[ih] |
|
|
[ª2] |
|
|
|
['h] |
[uh] |
|
|
[w2] |
[w2] |
|
|
[Âh] |
[ih] |
|
|
[Ì2] |
[Ì2] |
|
|
[αh] |
[ñ2h] |
|
|
[ªe] |
|
|
|
|
|
|
|
[ªj] |
[ej] |
|
|
|
|
|
|
[ªo] |
[1o] |
|
|
|
|
|
|
[ªw] |
[1w] |
|
|
|
|
|
Source : MAO Bunneang, Les interférences phonétiques dans lapprentissage du français par des apprenants cambodgiens, Mémoire de DEA, Université de Rouen, 1998, p. 26
Tableau comparatif des consonnes des deux langues
|
|
Sourdes |
Sonores |
Nasales |
|||
|
|
khmer |
français |
khmer |
français |
khmer |
français |
|
Vélaires |
[k] |
[k] |
|
[g] |
[ì] |
[ì]* |
|
Palatales |
|
|
|
|
[?] |
[?] |
|
Prépalatales |
|
[=] |
|
[ò] |
|
|
|
Alvéolaires |
[s] |
[s] |
|
[z] |
|
|
|
Apicales |
[t] |
[t] |
[d] |
[d] |
[n] |
[n] |
|
Labiodentales |
|
[f] |
|
[v] |
|
|
|
Bilabiale |
|
|
[v°]** |
|
|
|
|
Labiales |
[p] |
[p] |
[b] |
[b] |
[m] |
[m] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hors systèmes |
|
|
||
|
|
|
khmer |
français |
|
|
|
|
|
|
aspirées |
normales |
|
|
|
|
|
|
[kh] |
[l] |
[l] |
|
|
|
|
|
[ch]/[c] |
[r] |
[R] |
|
|
|
|
|
[th] |
|
|
|
|
|
|
|
[bh] |
[h] |
|
|
|
|
|
|
|
[Y]*** |
[j] |
|
|
|
|
|
|
|
[4] |
|
|
|
|
|
|
|
[w] |
|
|
* : [ì] français nest pas identique à [ì] khmer car cest un phonème que lon ne trouve que dans les mots demprunt à langlais et ne se place quen finale de mots. Par exemple, parking [paRkiì], camping [kãpiì]. Alors que [ì] cambodgien se trouve dans toutes les positions : initiale, médiane et finale de mots.
** : A noter la différence entre [v] français et [v°] khmer [v°] nest pas du tout fricative alors que [v] lest.
*** : [Y] khmer est une véritable consonne, elle peut se placer à nimporte quelle position de syllabe dans un mot.
Comme dans le système vocalique, voici les phonèmes consonantiques qui nexistent pas en khmer : [g], [f], [z], [R], [ò], [=], et les semi-consonnes [4] / [w].
Les consonnes du cambodgien
|
|
Sourdes |
Sonores |
Nasales |
|
Vélaires |
k K [k] |
|
g [ì] |
|
Palatales |
c C [c] |
|
j [?] |
|
Alvéolaires |
s [s] |
|
|
|
Apicales |
t T [t] |
d D [d] |
|
|
Bilabiales |
|
v [v°] |
n N [n] |
|
Labiales |
B [p] |
b [b] |
m [m] |
Les hors systèmes
|
Apico-avéolaire (voisé) |
Dentale-vibrante |
Palatale (sonore /non- aspirée) |
Laryngale (soude) |
|
l L [l] |
r [r] |
y [Y] |
h [h] |
Les aspirées
|
x X [kh] |
q Q [ch] |
z Z f F [th] |
p P [bh] |
Source : MAO Bunneang, Les interférences phonétiques dans lapprentissage du français par des apprenants cambodgiens, Mémoire de DEA, Université de Rouen, 1998, p. 17
Annexe n° 7 : La liste des intervenants de « La
table ronde »
Emission de « la table ronde » diffusée par TVK, le 10 juillet 1999
sur « les problèmes de frontières »
Les intervenants sont :
- Son Excellence PEN Thol, conseiller du gouverment
- Son Excellence KEP Chutéma, Gouverneur de la province de Takéo (cette province a une frontière commune avec le Viêt-nam)
- Son Excellence SAY Hak, 1er Vice-Gouverneur de la province de Koh Kong (cette province a une frontière maritime avec la Thaïlande)
- Son Excellence HUON Savang, Directeur de la Géographie du ministère de lAménagement du territoire, de lUrbanisme et de la Construction
- Son Excellence PRAK Doeun, 3ème Vice-Gouverneur de la province de Battambang (cette province a une frontière avec la Thaïlande)
- Son Excellence VA Kim Hong, Conseiller du gouvernement, Président de la commission mixte pour les affaires de frontières nationales
- Son Excellence LONG Visalo, Sous-Secrétaire dEtat aux Affaires étrangères
|
Le khmer est une langue parlée par dix millions de Cambodgiens et par une diaspora disséminée dans les grands pays d'Amérique, dans quelques pays d'Europe et en particulier en France. Il s'agit de voir, à travers cette étude, à quels problèmes spécifiques se heurte son enseignement dans une institution comme l'Inalco. Des problèmes liés à la langue, aux méthodes d'enseignement, aux apprenants eux-mêmes et aussi à l'institution.
Ce travail de recherche propose des pistes didactiques qui pourront servir de bases de réflexion aux enseignants actuels et futurs.
|
![]()
[1] DANIEL A., 1992, op. cit.
[2] MAO B., Les interférences phonétiques dans lapprentissages du français par des apprenants cambodgiens, Mémoire de DEA, Université de Rouen, 1997-1998,
[3] MAO B., op. cit., p. 68
[4]guimbretiere e., Phonétique et enseignement de loral, Didier/Hatier, Paris, 1994 : « Linterférence phonétique est un transfert en langue étrangère (L2) les caractéristiques de L1. Il sagira du transfert négatif ou interférence phonétique quand lapprenant va servir en L2 dun élément de L1 quil croit identique alors que celui-ci est différent », cité dans MAO B. id., p. 66
[5] guimbretiere e., id.
[6] MAO B., op. cit., p. 72
[7] Le crible auditif de chaque individu se stabilise à lâge de dix ans. Pour ceux qui apprennent une langue étrangère au-delà de cet âge, il devient alors très difficile pour eux dentendre et de produire un son qui leur est inconnu. De ce fait, lapprenant tombe en général dans linterférence phonétique.
[8] Voir p.103, ligne 2 /tourner, changer, remplacer parole/ se traduit en français par : « retourner sa veste ».
[9] Par exemple, RtLb;eTApÞHvij [trù l/b t«® pHteah Biø] /retourner aller maison de retour/ « retourner à la maison »
[10] Par exemple : dara Føab;Et ebIk Lan
[dara tHlb|tE bOk laùn]
/Dara avoir lhabitude de conduire voiture/
« Dara a lhabitude de conduire une voiture ».
Un même verbe peut être utilisé seul ou comme auxiliaire. Dans certains cas, cette différence dutilisation implique deux significations bien distinctes.
[11]CAMBEFORT G., 1950, op. cit. p.6
Ä Si certaines questions paraissent toucher trop à votre vie privée, vous pouvez ne pas y répondre.
Ä Si certaines questions paraissent toucher trop à votre vie privée, vous pouvez ne pas y répondre.
[12] Nous avons transcrit textuellement les réponses des enquêtés.
This site was last updated 05/18/04